Aby Warburg d'Ernst Gombrich par Philippe De Georges
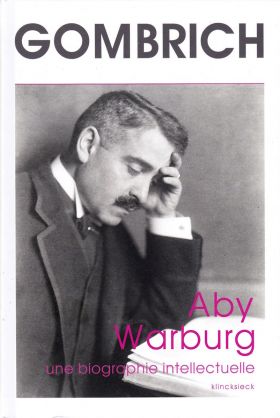
La solution d’Aby
Pour la première fois, quarante ans après sa publication originale, la formidable « biographie intellectuelle » d’Aby Warburg par Gombrich1 est accessible aux lecteurs français. Un bonheur ne venant jamais seul, je viens de m’y plonger après avoir lu l’ensemble des documents laissés par Binswanger2 sur l’hospitalisation de Warburg dans sa clinique psychiatrique. Un thème précieux frappe par la place qu’il occupe dans l’œuvre de ce grand historien de l’art - considéré comme l’un des initiateurs de l’iconologie moderne - et dans son expérience personnelle, y compris sa folie : celui de bipolarité.
Quand Warburg arrive chez Binswanger après une première hospitalisation à Iéna, il est encore aux prises avec les démons qui se sont agités en lui au moment de la défaite de l’Allemagne : c’est en effet en 1918 qu’apprenant la chute du Reich, il est soudain convaincu d’en être responsable et menace de tuer avec un pistolet sa femme et ses enfants, avant de se tuer lui-même, « pour leur éviter le pire qu’il voit venir ». Les comptes-rendus réguliers de l’hospitalisation le montrent chaque jour en proie à la terreur et à la fureur qui se disputent son âme. Il frappe, il mord, il insulte et il hurle. Son corps en sera marqué à jamais, sa voix brisée par les cris. La schizophrénie (dite alors démence précoce) est le diagnostic retenu par Binswanger. On est frappé de voir dans la chronique des soins que ceux-ci sont des plus « classiques » (hydrothérapie, contention couchée, enfermement, traitements opiacés…) et que jamais celui qui a la réputation d’avoir inventé une psychothérapie existentielle compréhensive ne cherche à l’utiliser avec son patient. (Il est vrai, parmi d’autres contradictions, que Binswanger, réticent aux électrochocs naissants, trouve pleine d’espoir la lobotomie en cours d’expérimentation). Il le juge d’abord incurable et c’est étonnamment Kraepelin, appelé en consultation par la famille, suspicieuse à l’égard des médecins de la clinique, qui posera le diagnostic de psychose maniaco-dépressive et le pronostic de curabilité qui en découle pour lui. Binswanger ne se rangera à cet avis qu’à contre-coeur, parlant à la fin, à juste titre sans doute, d’état mixte, l’agitation maniaque accompagnant un fond qui reste constamment mélancolique.
Lorsque la guérison survient, elle ne manque pas d’étonner les soignants. On est surpris de voir les échanges amicaux qui s’en suivent, avec une correspondance dont le ton est aussi charmant que le contenu riche, après les observations aussi froides et peu empathiques de la période d’hospitalisation.
Gombrich a décidé de ne tenir aucun compte de la période d’effondrement de Warburg, qu’il semble considérer, par élégance et par pudeur, comme une parenthèse. Du coup, le lien entre l’idée que Warburg se fait de l’histoire, de la politique, du rapport entre la création artistique et le contexte social et sa propre vie comme ses propres épreuves est-il refoulé. Or, si nous prenons le temps de lire l’œuvre de Warburg, sans effacer l’homme Aby, si nous lisons Gombrich mais aussi Binswanger et Didi-Huberman3 par exemple, nous ne pouvons pas ne pas faire le lien entre le drame intime du sujet et les idées qu’il développe savamment.
Warburg théorise la « bipolarité des images ». Il souligne que de nombreux mots ont des significations antinomiques, à la façon dont Freud parlait peu de temps avant « Des sens opposés dans les mots primitifs ». Il souligne aussi, autant dans la vie publique que dans les œuvres culturelles, ce qu’il qualifie d’ « inquiétante dualité » (unheimliche Doppelheit). Tout cela traduit selon lui l’existence de forces hétérogènes, antagonistes et interdépendantes (comme le sacré et le profane ou l’ancien et le nouveau) entre lesquels il faudrait parvenir à un équilibre ou un compromis, nécessairement précaire mais fécond. Pas de réconciliation à attendre, d’harmonie à espérer. Pas de résolution du conflit, non plus, dans l’effacement de la tension, la résorption de la contradiction, le triomphe d’un terme sur l’autre. Les opposés le restent irrémédiablement, mais il s’agit de les tenir ensemble. La solution – qui lui a fait défaut lors de son effondrement de plusieurs années – tient donc de l’oxymore et du paradoxe, nouant les entités contradictoires qui déchirent le sujet en vue d’un effet de création.
Une figure particulière revêt une importance notable dans les travaux d’Aby Warburg : celle qu’il nomme « la Nymphe ». Il en décline les occurrences diverses et les variantes, depuis « Le Printemps » et « La Naissance de Vénus », de Botticelli jusque dans des œuvres obscures et peu marquantes du Quattrocento. Il s’agit généralement d’un personnage secondaire de la scène, qui semble danser ou fait irruption dans ce que décrit le tableau, contrastant par son attitude avec les personnages principaux, comme dans « La Nativité de Saint Jean-Baptiste », de Ghirlandaio. Elle s’élance, et porte ici un plateau de fruits superbes, détonnant avec les autres femmes, dont la donatrice, aux costumes empesés. Son pas est léger, glissant et aérien et ses pieds nus font signe de son origine : elle vient directement de l’Antiquité triomphante, chargée de la beauté des corps hellènes et de la joie païenne. Son irruption déplace les lignes, bouscule les ornements et les apprêts. Ses voiles volent (même si rien autour n’indique le moindre souffle de vent) et son drapé traduit le mouvement de la vie même.
Mais si elle est la vie, elle est aussi désordre et violence. Cette figure féminine vibrante d’Eros, telle que Warburg en fait d’abord l’interprétation, est sœur de la Gradiva de Jensen4. C’est un avatar des grâces du Parthénon comme de la « femme nouvelle » qui émerge dans ce début du XX° siècle où Warburg étudie l’art et y cherche des thèmes récurrents et des constantes. Elle condense sous cet angle la libido et porte ce qui, à la Renaissance, marque l’émancipation humaniste secouant le joug de l’Eglise médiévale. Mais elle a aussi à l’occasion la vigueur inquiétante des Bacchantes. Warburg frémit et tremble. Il frémit, de cette poussée vitale, et tremble devant cette menace d’excitation : l’autre face de cette sensualité sans bride, c’est la fureur des Ménades.
La Nymphe est selon lui sur le versant dionysiaque, dont il parle en se référant explicitement à Nietzsche5. Mais l’idéal d’Aby Warburg est apollinien : c’est la Sophrosyne, la tempérance et la mise à distance que la raison permet en jugulant la fougue dévastatrice de la passion ou de la pulsion. Or le combat entre pulsion et raison, déchire l’homme - l’homme Warburg, comme spécimen d’humanité – comme un autre combat qui oppose en lui la pensée apaisante et la folie saturnienne de la mélancolie.
La référence à l’antique Sophrosyne permet à Warburg de définir son idéal tel qu’il joue un rôle essentiel dans son analyse de l’art. Ainsi parle-t-il de ce qu’il qualifie tantôt de distance et tantôt de détachement, qui est alors une variante du juste tempérament des choses. Il s’agit en somme de ne pas s’impliquer totalement, de ne pas être soumis aux démons qu’on agite. Or c’est là selon lui ce qui arrive à Nietzsche dans sa mésaventure de Turin, après laquelle les forces obscures qu’il a suscitées ont fini par le vaincre.
Se détacher, c’est n’être ni fasciné ni impuissant. C’est se désengluer du monde magique et primitif, dont on ne se défend que par la terreur et ce qu’il appelle « la phobie ». La distance est dite parfois explicitement « métaphorique ». C’est pour Aby la clé du symbole et le fondement du courant de réforme rationnel, de l’effort d’élucidation qui permet à l’humanité de passer de l’esprit primitif et païen à celui de l’homme libre et des Lumières. La distance résulte ainsi de la conscience claire de ce que le mot n’est pas la chose, que le signe n’est pas vraiment ce qu’il représente et que le symbole n’est pas non plus identique à son référent ordinaire.
L’Hostie comme corps vivant du Christ plutôt que comme symbole de celui-ci est en ce sens la part magique qui subsiste dans le catholicisme, qu’Aby Warburg crédite par ailleurs d’un formidable effort de spiritualisation, contrairement au judaïsme, par l’abandon de toute forme réelle de sacrifice. (Ce thème a des échos profonds pour cet auteur qui s’est construit dans une rupture violente avec le judaïsme rigoureux de son père). La distance métaphorique ouvre l’espace de la civilisation et de la création artistique. Son absence conduit à une « identification à l’objet » qui peut être le retour de la tendance orgiaque, mais qui est aussi un des pôles de l’oscillation de l’humeur que subit douloureusement Warburg (ce qui est rejeté par la raison pure fait retour dans le réel : la terreur). La métaphore conjure l’identification immédiate et mortelle : les démons restent enfermés dans le cercle magique – de la sublimation – qui permet leur maîtrise.
On peut voir dans la Nymphe décrite par Warburg une figure de la jouissance féminine, débridée et libre. Mais les associations qui s’imposent à Aby suscitent vite une tout autre lecture : il s’agit en fin de compte pour lui d’une forme déguisée et atténuée des Ménades et des personnages des scènes orgiaques et bachiques. Il montre habilement comment tel personnage du Quattrocento est directement copié d’un sarcophage étrusque. Ainsi, il y a toujours en perspective le corps démembré d’Orphée et sa tête roulant aux flots, ou celle de quelque Holopherne ou de quelque Jean-Baptiste. Même cette corbeille de fruits, que porte cette surprenante servante (précisément chez Ghirlandaio, pour la naissance de ce saint), n’est-elle pas celle de la suivante de Judith, ou le plateau sur lequel Salomé baise la face du supplicié ? La forme moderne de la Nymphe est pour Warburg « une chienne errante ».
La raison et la lumière luttent sans cesse chez Warburg contre le mal qui ne demande qu’à l’envahir. Sa lucidité est telle que peu de temps avant sa mort, il commente son travail de toute une vie pour ses collaborateurs en parlant d’autobiographie. Il sait qu’il n’a jamais travaillé en scientifique que ce qui le hantait au plus intime. C’est alors l’occasion pour lui de nommer les deux images qui l’ont toujours habité : « La « Nymphe » extatique (maniaque) d’une part, et d’autre part la divinité fluviale en deuil (dépressive) ». Cette clairvoyance dénuée de toute complaisance rend d’autant plus précieux son parti pris jamais pris en faute d’être de « la communauté de ceux qui se tournent vers la lumière ».
1. Ernst Hans Gombrich, Aby Warburg, Une biographie intellectuelle, Klincksieck, 2015
2. Ludwig Binswanger, La guérison infinie : Histoire clinique d'Aby Warburg, Payot 2007
3. Georges Didi-Huberman, L’image survivante, Minuit 2002
4.Sigmund Freud et Wilhelm Jensen, Délire et rêves dans la Gradiva de Jensen, Gallimard 1976
5. Frédéric Nietzsche, Naissance de la Tragédie, Pléiade