Fabienne Raphoz, La saison des mousses par Aurélie Foglia
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
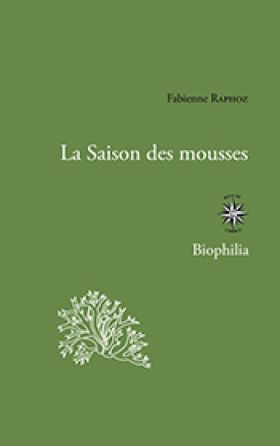
La nature à la loupe.
Je voudrais relater mon expérience de lectrice, qui me paraît devoir être rapportée au dispositif de ce livre, La saison des mousses. Je me suis trouvée dans un jardin début mai, en pleine éclosion de tout, au moment de ce débordement où la terre recrache tout son vert, l’invente et lance en l’air des salves d’oiseaux, avec ce livre sur moi. Chose étrange, j’ai senti d’abord le besoin de déambuler dans cette amitié, de le tenir contre moi pour m’en pénétrer par quelque porosité mal explicable, de sorte que je l’ai ouvert ensuite comme naturellement.
Quand je me suis plongée dans ce petit livre vert, tout mousseux de mots, j’étais devenue déjà plus familière de « ce monde », et tout de suite je me suis aperçue qu’il me frayait un chemin et m’invitait, dans ce qui était mon cadre, à en percevoir avec plus d’acuité la vie cachée. Car ce léger pullulement tout bas, qui monte humblement du sol, tout en restant le plus souvent à ras, traversé çà et là par un oiseau qui ne prenait pas le temps de dire son nom, me semblait servir de transition entre le paysage et l’espace du papier. « Soudain une simple apparition me donne l’impression d’être des leurs, non pas dans un devenir illusoire, mais dans une approche sensible de leur territoire. »
C’est ce que Fabienne Raphoz appelle « entrer en nature », dans une belle méditation sur ce vivant qui nous fait vivants. Et nous voici tout de suite dans « l’hyperprésent », que ce soit par le procédé quasi-magique de la réminiscence, ou encore grâce à la vivacité des couleurs, en particulier la palette solaire des jaunes au sol : quand tout refleurit dans les sous-bois, « par temps de pluie, la lumière, absente du ciel, semble jaillir des pas ». La lumière qui émane des mousses, en revanche, est inverse aux saisons : la phosphorescence étonnante qui les prend est plus forte en hiver, tandis qu’elles ternissent provisoirement l’été. La poète n’hésite pas à décrire ce rapt, ce ravissement, devant « ce monde-là, qui m’arrachait soudain les yeux et les oreilles ».
Les courts chapitres sont tantôt narratifs, tantôt descriptifs, et toujours la parole s’appuie sur l’observation, se laisse guider par le souci de la justesse. Le petit « singe » de l’intellect saute de branche en branche et s’éclipse : ce qui a lieu, c’est cette invasion heureuse du réel qui rend la pensée secondaire, quand il faut avant tout « n’être plus qu’une traque, oreille tendue, regard acéré ». La poète décrit une posture, et elle y tient, elle s’y tient, car c’est une éthique. L’écriture pour elle n’est pas un geste de domination, ne pourra jamais l’être, mais d’attention, qui ne peut pas faire l’économie de cette dimension mélancolique qui nous saisit au spectacle de la nature, quand nous sommes ramenés au constat du saccage et à l’urgence de la sauvegarde. « Ce papillon surgit avec la force fragile d’une assurance-vie ». Sommes-nous minés par la conscience que ce monde va finir, comme l’écrivait Baudelaire ? La poète vise à replacer l’homme parmi les autres espèces et réinscrit par là même le grand prédateur-destructeur dans son monde, notre monde. Ainsi les « haies » qu’il arrase sans faire de sentiment esquissent l’image parfaite d’un « microcosme commun » dans lequel une multitude d’espèces peuvent vivre en symbiose, pour donner la formule visible d’un « nous ».
Cette démarche écopoétique n’est jamais pédante, parce qu’elle repose fondamentalement sur une « philia » : elle se fait écoute, auscultation empathique, jusqu’à l’abandon de son poste par le « moi » pour se fondre dans le « grand dehors ». Elle a ses temps, ses étapes, qui passent par la sensation, volontiers ressaisie dans l’enquête et la connaissance. Comme la poète le raconte non sans cet humour discret dont elle ne se départit jamais, « au retour, j’use d’autres attributs de mon espèce et poursuis l’entrée en nature par un surcroît d’amitié que permettent les guides. » Le grand livre de la nature se double d’outils textuels et numériques pour entrer en contact avec le détail des espèces, leur mode de reproduction (celui des grandes libellules dites Empereurs) ou le travail tenace des araignées. On en apprend de belles sur « Pisaura l’admirable », que décrivit en premier un naturaliste danois du XVIIIème siècle, si vous voulez savoir – et vous le voulez, dans cette « sympathie » qui s’éveille si vite avec la merveille du vivant.
Souvenons-nous de ce qu’écrit María Zambrano dans son essai Philosophie et poésie, quand elle distingue le poète du philosophe. Tous deux, au contact du monde, sont d’abord saisis par le thaumazein, l’étonnement. Mais le philosophe s’extrait méthodiquement, voire s’arrache de la fascination des phénomènes pour tendre vers le vrai, tandis que le poète est celui qui refuse le dépassement. Il choisit de rester dans cette immédiateté initiale, au plus près de la vie, toute dispersée qu’elle est, car elle lui suffit et le nourrit : « quelques-uns de ceux qui ont senti leur vie suspendue, leur regard pris au filet de la feuille ou de l’eau, n’ont pu passer le second moment où la violence intérieure oblige à fermer les yeux en quête d’une autre feuille ou d’une eau plus vraie ». Le « merveilleux » des contes n’est autre ici que ce tissu fin et inimaginable du réel même, dans sa diversité fabuleuse. Les taxinomies scientifiques se mettent à chanter sous la plume ailée de l’écrivaine, fidèle à sa poétique de la nomination : dans « Les étoiles », on trouve la liste mondiale des espèces d’écureuils, dont les syllabes incantatoires se poursuivent entre les feuilles du livre. On éprouve un plaisir profond à entendre sonner le nom latin de la thiratoscirtus mirabilis, ou de papillons aussi rares que géants tels que le Vulcain, qui hanta Nabokov.
Le dernier temps est celui de la mise en mots, récit, poèmes en prose. Ce qui reste : parfois, quelques vers seulement ont condensé des pages noircies de notes. L’écriture aussi a ses saisons, comme le corps et la nature : elle est ce regard qui se dépose sur le papier, ce pas souple et souvent son rapt. Pendant trois ans, le texte de Fabienne Raphoz a enregistré, accompagnant le temps animal-végétal, avec ses migrations et ses dormances, ses propres temps de latence et ses poussées verbales. Après Ce qui reste de nous (éditions Héros-limite, 2021), en écho, et avec une cohérence totale qui est sa signature, on retrouve la poète, dans une prose souple et rythmique qui ressemble à la marche, « à la recherche de cette langue, pour le simple plaisir d’approfondir une amitié », de « muer cet objet-langue qui nous a séparés du reste du vivant, en rapprochement, par le poème, c’est-à-dire grâce à cette drôle de langue-protée qui rend possible, par sa porosité, le détachement. » Quel sera à la fois son instrument et l’objet de cette « traque » ? « La langue du poème comme loupe, grand angle et écho ». Cette loupe, elle la promène avec elle dans l’herbe et sur les troncs, c’est le matin, « en cette saison où l’on croirait entendre les feuilles pousser », et elle vous la tend.