Henri Droguet, Grandeur nature par Alexander Dickow
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
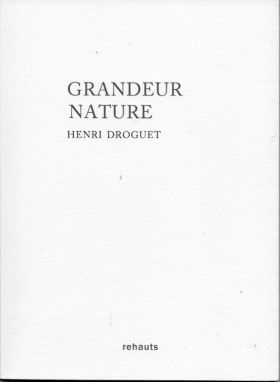
Je ne peux recenser le nouveau livre d’Henri Droguet, Grandeur nature, comme on recenserait l’ouvrage d’un simple confrère estimé. Non : soyons très clairs, Henri et moi sommes maintenant de vieux amis, des correspondants à peu près constants depuis bientôt vingt ans. Même si c’est la poésie, et la sensibilité littéraire, qui nous a d’abord rapprochés, vers 2004.
Droguet écrit de la poésie depuis à peu près un demi-siècle, principalement publiée chez Gallimard. J’ai recensé des ouvrages d’Henri Droguet trois fois – Off (2007), Maintenant ou jamais (2013), Faisez pas les cons ! (2016) – et j’ai désormais traduit une bonne centaine de ses poèmes, de la plaquette Boucans à certains poèmes du nouveau-né Grandeur nature, traductions réunis en volume Showers and Bright Spells, à paraître chez Spuyten Duyvil (Clatters, la traduction de Boucans, a déjà paru ; Minneapolis, Minnesota : Ohm Press, 2015).
Cette œuvre évolue continuellement et de manière insensible ; à la lire d’aussi près sur une vingtaine d’années, on croit discerner seulement les eaux et l’écume aimées et telles qu’elles ont toujours été. Il n’y a pas de changement par étapes, pas de révolutions ; on constate ce qui a changé après coup, quand ces nuages n’ont plus la même forme que dans notre souvenir. Ce sont des tableaux de Constable, fort apprécié de l’auteur d’ailleurs : toujours le même tableau, et pourtant infiniment différent dans les nuances, dans l’infini du détail. Toujours le ciel et la mer, la lande, les corbeaux, le genêt et la bruyère et les ajoncs, les rochers, les vagues, les vagues, les vagues. J’ai cette chance, la Bretagne a inscrit ces paysages-là en moi. Pour moi c’est une matière toute en émotion ; pour Droguet aussi, pour qui la mer évoque une activité régulière de navigateur ainsi que maint moment vécu, baigné parfois dans le sacré.
Grandeur nature, poèmes écrits en 2013 et 2019, ne se départ pas du paysage austère et aimé de la côte. Henri Droguet, malouin d’adoption, est un poète de son environnement. L’épigraphe met déjà en scène les grands acteurs de cette poésie : « Sans la mer, le ciel et le soleil sont une erreur » (Daniel Morvan). En l’occurrence, pas d’erreur possible, les trois y sont, mais sans la sérénité que la citation de Morvan semblerait suggérer : c’est sur un ciel « Tout en chaos croustillé » que le recueil commence, avec la concaténation de noms et d’adjectifs croquants que tout lecteur de Droguet reconnaîtra avec jubilation, comme une signature sonore : « chancreux bouillu cuivreux / seuil feuilleté touillis » (9)… On remarquera la densité avec laquelle certains phonèmes reviennent : bouillu…seuil feuilleté touillis, c’est ce qu’on nomme (d’une manière très à propos pour ces marines) des l mouillés. Autres phonèmes récurrents chez Droguet : les désinences en -asse, en -ard et en -eux qui rapprochent le style du sol même lorsqu’il s’agit de chanter les hauteurs, et les préfixes re- et dé-, les préfixes proprement beckettiens de la répétition et de la dégradation de toute chose.
Malgré le « chaos » de l’ouverture du recueil, de ce ciel décousu qui craque de toute part, il y a toujours un ordre chez Droguet, mais c’est l’ordre organique de ce qui émerge comme de lui-même, de ce qui s’impose peu à peu. Et pourtant, le poème droguétien s’achève presque toujours avec une clausule plus ou moins frappante, une note finale qui tranche souvent d’une manière étonnante sur ce qui a précédé. Dans le poème déjà évoqué qui ouvre le recueil, on remonte le ciel en ébullition pour trouver à la fin une étoile rouge qui reluit bien au-delà du drame de notre atmosphère : « et rouge à mourir Bételgeuse ». C’est un geste sublime – commencer avec les éléments en mouvement qui nous dépassent tellement, pour nous montrer ce qui outrepasse encore ceux-ci : nous sommes au ciel ce que le ciel est aux étoiles, ce qui fait de nous des paquets de molécules bien insignifiantes. Et les êtres humains sont souvent très petits et très dérisoires dans ces paysages de l’obsession ; nous sommes « sans intrigues ni / commencement ni rien » (10). Reste que l’humain y est, petit spectateur au bord du tableau, rabougri et qui chantonne parfois quelque petit air en face de l’immensité.
Alors même que Droguet passe le temps à ressasser et à remâcher la futilité de notre condition d’infimes, le néant de toute cette vaste activité cosmique, sa poésie donne une impression exactement inverse (comme par l’effet d’une sorte de dialectique), d’abondance inépuisable : l’énumération, si fréquente chez Droguet, est la figure même du débordement et de l’excès, et sa tessiture verbale est tout à fait phénoménale ; on retrouve des mots de tous les domaines et de tous les usages et de toutes les époques, littéralement brassés dans une mixture proprement océanique de mots et de choses : « l’océan fabuleux vieux lavoir / béance énigmatique et chansonnière / lassement monte et pousse ses poix / ses encres d’émeraude et de vin / cogne recogne le groin l’enclume / la splendeur hérissée des falaises » (70).
À l’occasion, une citation ou une allusion littéraire, signalée (Georges Perros, Horace…) ou tue (comme le titre « Pluie vent vitesse » qui est le titre en français d’un tableau de Turner ; 22, 32-33). À force de le lire, l’univers littéraire de Droguet devient familier ; Beckett, Celan, et Corbière ont marqué cette poésie. On compare souvent Droguet à Jude Stéfan, mais Droguet est plus terrestre (sinon terreux) et plus sensuel, et n’a pas la morgue voltairienne de Stéfan.
Pourtant, j’insiste trop sur le côté sublime aux dépens du trivial et du quotidien, du bric-à-brac et du banal : avec des titres tels que « Machinerie 2 » ou « Ritournelle », on se doute que Droguet chante aussi la morne monotonie du temps qui nous broie gentiment. En somme, c’est encore, du côté du sublime et de l’ordinaire, ou de l’excès et du manque, un peu le paradoxe de tout langage, doté d’une face pleine et d’une face vide. Paradoxe aussi d’un rapport parfaitement équivoque au lyrisme : « ASSEZ LES MUMUSES ! » gueule le poète, comme pour faire cesser brusquement une élévation lyrique qui serait imposée à sa plume bien malgré lui (47). L’être humain, et le poète peut-être surtout, est « saturé […] d’émotions sublimes quoique / possiblement toujours superficielles » : pas de contradiction, car le superficiel et le sublime vont de pair (51). Même la jouissance et la mélancolie semblent changer subitement de place dans cette poésie héraclitéenne, de contraires en contrepoint perpétuel. C’est un livre de merveilles très désolées, où je vous conseille d’entrer d’un pied allègre, en lançant ce cri de joie : « mourir s’apprend / ça prend / toute une vie » (25).