10 déc.
2013
Portraits d'Amérique de Jonathan Williams par Jérôme Duwa
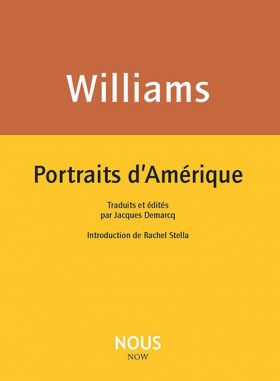
De quelle Amérique s’agit-il avec cette trentaine de portraits carrés, tout à la fois en photographies et en prose ? Nous ne sommes plus au temps de la grande dépression documentée par Walker Evans, mais dans la seconde moitié du XXème siècle, celle que Robert Frank a commencée à nous faire voir avec Les Américains (1958). Au premier abord, les portraits de Jonathan Williams sont difficiles à identifier ; de ce côté-ci de l’Atlantique, la plupart de ces visages d’hommes et de femmes nous sont peu familiers et, contrairement aux Hommes du XXème siècle d’August Sander, leurs apparences demeurent impénétrables ou trompeuses. Qui pourrait dire, en s’en tenant à ces images, que nous avons affaire ici à un échantillon des poètes américains les plus remarquables, nés entre 1873 et 1947 ? À l’exception d’Allen Ginsberg, toujours en communication directe avec William Blake ou dialoguant avec Krishna et Arjuna. aucun n’appartient à la Beat generation, dont l’imagerie mythique a été largement répandue. Dans une seule de ces photographies, le sujet est saisi en flagrant délit d’écriture, le stylo à la main. Il est torse nu et une petite cuillère est placée au premier plan de sa table de travail, parallèlement à son bras ; cependant, cela ne fait pas perdre de sa superbe à son occupation si particulière, mais transfigure sous nous yeux la banale petite cuillère. En l’occurrence, l’homme dénudé est Charles Olson, un de ces poètes américains qui continue à compter le plus avec William Carlos Williams, Louis Zukofsky et Ezra Pound, naturellement. Jonathan Williams confesse sa dette immense envers l’auteur de The Maximus Poems et il écrit, nous convaincant sans peine : « un lascar capable d’insuffler le feu comme personne ». La seconde image d’Olson le présente sous une apparence plus que suspecte, emmitouflé dans son manteau, devant des casiers à homards ! Tous ces poètes ont, du reste, l’air un peu louche. Voyez par exemple Kenneth Rexroth avec son costume d’Al Capone ou Robert Creeley, dont la photographie réalisée en 1955, est titrée non sans humour : « Portrait de l’artiste en assassin espagnol ». Quatre ans plus tôt, devant apparemment le même bâtiment en tôle ondulée du Black Mountain College, Francine du Plessix et Joel Oppenheim jouent à « La Belle et la Bête » ; pour elle, pause de pin-up et pour lui, face grimaçante.
Composé par Jacques Demarcq à partir de plusieurs recueils de photographies totalement inédits en France, la force du livre de Williams tient aussi à ses textes lapidaires qui nous placent d’emblée dans un rapport de grande proximité avec les poètes photographiés. Il convient de préciser que Williams, lui-même poète très espiègle, aborde tous ces auteurs comme éditeur de Jargon Press, ce que nous précise fort utilement l’introduction de Rachel Stella. C’est à une double concentration bien carrée qu’il aboutit par le texte et l’image. À chaque fois, on a le sentiment que Williams interroge sa propre photographie et se demande : « Qu’est-ce que j’ai fait apparaître et quels mots, quelles anecdotes ou quels souvenirs conviennent pour produire un équivalent de ce j’ai vu ? ».
Voyez le regard malicieux de Mina Loy ! Et le profil de Pound à Venise, l’esprit vraiment ailleurs ! On a envie d’y croire quand le vieil Elijah Pierce, devant l’enseigne de sa boutique de coiffeur, raconte que la voix de dieu lui parle, qu’il la connaît parfaitement.
Williams note aussi à propos de Jack Spicer, si vulnérable au milieu d’énormes troncs d’arbres abattus : « son œuvre n’est pas devenue une farine académique moulue par des cerveaux désespérés ».
C’est l’impression finale qu’on emporte en fermant ce livre : Williams nous offre une belle galerie de portraits d’inclassables.