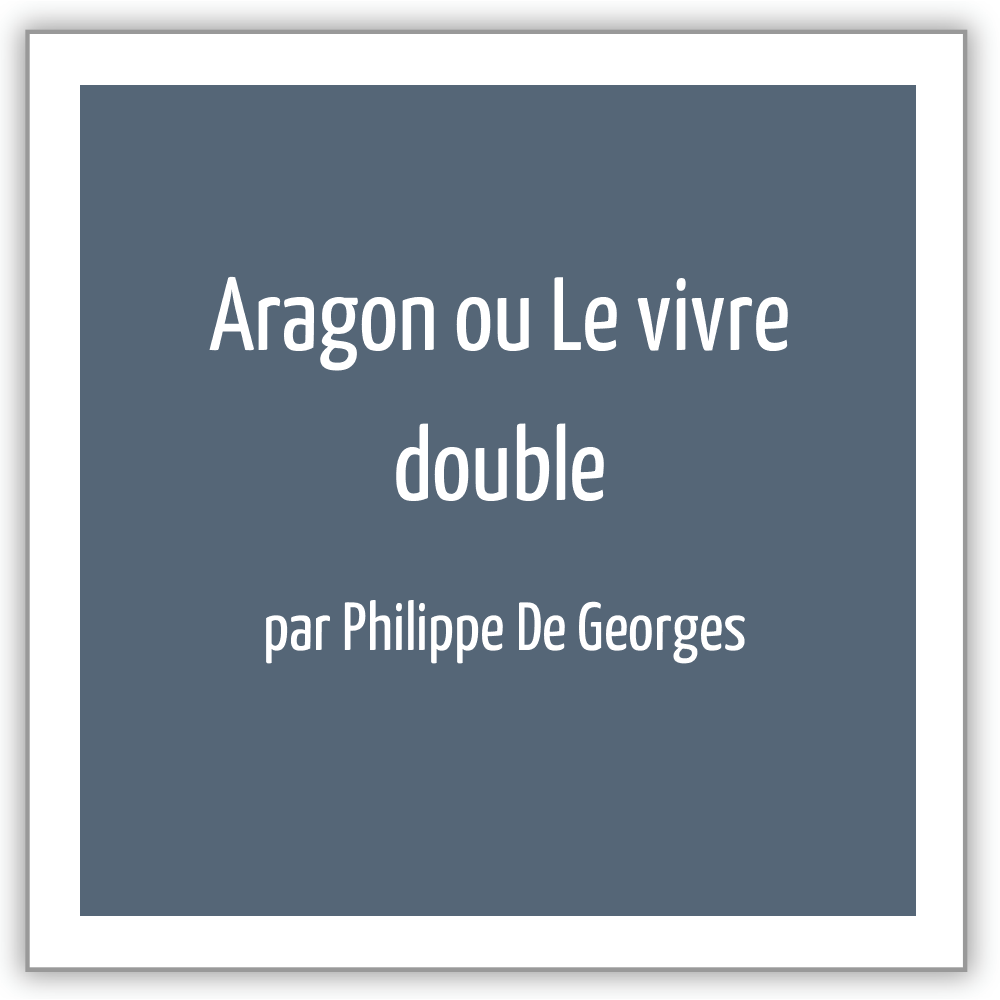Aragon ou Le vivre double par Philippe De Georges
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Il n’est plus terrible loi qu’à vivre double
(Œuvres poétiques complètes, La pléiade, Gallimard, Tome II page 147)
Raisons d’un choix
Prétendre apporter un éclairage psychanalytique à la vie et l’œuvre d’Aragon nécessite d’abord de poser les limites d’un tel exercice. Rien n’est plus redoutable et inepte que les tentatives de psychobiologie ou les prétentions à l’application de la psychanalyse aux génies qui n’ont rien demandé de tel ! Aragon n’est pas un analysant. Il n’a demandé, je pense, une cure à personne et il est donc impossible de faire entrer ce « cas » dans ce qu’on peut appeler une « clinique sous transfert ». Il ne cherche pas sa « vérité » à travers une expérience analytique. Donc : la voie de l’interprétation est close. Mais il y a une œuvre monumentale, adressée de bout en bout au plus large public et prenant l’univers à témoin ; et il y a une vie, où l’auteur se met en scène.
Une œuvre est un objet distinct de son auteur. Proust, au début du XX° siècle, a assez dénoncé le travail de Sainte-Beuve et son intention de lier la lecture d’un texte à une supposée connaissance biographique, et Mallarmé a assez prévenu de la « disparition élocutoire du poète » dans le poème pour que nous n’ayons pas à y revenir…Toutefois, le Contre Sainte-Beuve n’empêche pas tout lecteur de La Recherche de supposer le « vrai » Marcel derrière le narrateur. Quant à Mallarmé, son Tombeau d’Edgar Poe nous livre le sujet Poe lui-même, tel que « L’éternité le change ». C’est ainsi que sa disparition révèle la vérité de ce qui le poussait à écrire, et qu’ignorait « son siècle épouvanté » de n’avoir pas connu « que la mort triomphait dans cette voix étrange ». Soit le deuil impossible et l’énonciation du poète…
Ces réserves définissent les bornes de mon propos. Rien ne viendra éclairer la « compréhension » de l’œuvre d’Aragon. Tout au plus peut-on contribuer à éclairer un cas, que l’on peut élever au rang d’un paradigme, c’est à dire du contraire d’un exemple ou d’un échantillon. La singularité est ici ce qui domine de part en part. Aragon est présent et visible dans chaque phrase ou chaque vers qu’il tisse. Il s’y met en scène incessamment, poésie, roman et politique étant les registres par lesquels il « construit » jour après jours son « personnage ». Vie et fiction se mêlent de ses premiers à ses derniers écrits et tout ramène à ce Je qu’il invente, ou à son double-je(u)…
Résumé de ma construction :
L’œuvre d’Aragon est un fleuve tumultueux. Son bouillonnement impétueux donne facilement le vertige. C’est en fait une écriture du vertige. Celui du sujet Aragon, dont c’est l’affect majeur. Du fait du vacillement de ses repères ; et de sa jouissance qui vise l’infini, l’illimité, la démesure et le sans loi.
Cette œuvre est protéiforme. Elle mêle les procédés les plus classiques, les élans romantiques assumés et les innovations et ruptures de l’époque. On passe sans transition du roman au poème, et la dimension philosophique est revendiquée au moins dans les premiers travaux. Cette philosophie s’écrit en première personne. Il ne s’agit pas de poser des questions théoriques ou abstraites, mais de dire « Je ». La première personne est même le problème lui-même : car tout y revient, tout ramène au narcissisme triomphant et menacé, au risque du sans-Autre. Le narcissisme est sans au-delà autre que la mort.
Les interrogations ont elles-mêmes la couleur du vertige, puisque tout dualisme est refusé, toutes les dualités clivantes, les logiques binaires qu’impose le registre symbolique et qui sont autant d’enfermements qu’il faut défier ou rompre : il n’y a ni bien ni mal, ni vrai ni faux, ni homme ni femme… »Cette cage des mots, il faudra que j’en sorte »…
Le moment tournant que je propose de retenir est la période qui va de 1918 à 1927. Quelques mois avant la fin de la guerre, Aragon (âgé de 21 ans) se porte volontaire pour le front. Sa sœur (Marguerite Toucas) lui avoue alors qu’elle est sa mère, que sa mère légale est donc sa grand-mère et que son parrain et tuteur (Louis Andrieux, homme politique en vue, proche de Clémenceau, Préfet de Paris) est en fait son père biologique. C’est lui, saura-t-on plus tard, qui a exigé cette « vérité », puisque Louis à la guerre peut aussi bien mourir…
L’origine et sa fausseté, l’Autre faussaire et son mensonge, c’est ce qui fera trace indélébile : « Ce que je sais le moins, c’est mon commencement ».
On peut considérer que le monde imaginaire dans lequel il a grandi jusqu’ici, où il a été l’enfant-roi, au cœur d’une tribu de femmes entretenue par un homme influent mais absent, s’écroule. Le petit monde clos et socialement honorable était réglé par une série de mensonges (sur qui est qui) dont on se faisait la dupe. Témoignages et propos d’Aragon seront d’ailleurs contradictoires sur le fait de savoir si il croyait à la farce familiale ou s’il percevait quelque chose des faits. En tout cas, on feignait de croire…
Même les papiers étaient menteurs : à l’état-civil, l’enfant était supposé naître à Madrid, de parents dénommés Aragon, être orphelin et passait pour le fils adoptif de celle qui était sa grand-mère. Le certificat de baptême le 3 novembre à Neuilly le déclarera né le 1° septembre 1897 (il est né le 3 octobre), à Madrid (il est sans doute né à Toulon) de Jean Aragon et Blanche Moulin, qui n’ont jamais existé. Le parrain est en fait son père, qui lui lègue son seul prénom (Louis) et emprunte le nom d’Aragon à…son secrétaire. Un jugement de 1914 établira qu’il est né dans le XVI° arrondissement, de parents non dénommés…On notera comme essentiel pour la suite comme pour la personnalité de Louis Aragon qu’il écrit très tôt des « romans ». Dès 5 ans, écrire est une passion solitaire et secrète (voir : Je n’ai jamais appris à écrire ou Les Incipits, collection « Les sentiers de la création », Skyra éditeur).
La période du front est vécue comme une découverte de la liberté (« Une délivrance », « il me fallait à tout prix cet air pur ») et une expérience enivrante et trouble (« Nous avons aimé cette guerre comme une négresse ». « cette vie, cette guerre, je n’ai jamais été aussi heureux »). Il y fait montre d’un grand courage et d’une indifférence certaine au danger. Enseveli sous des obus, il passe pour mort… « Je suis mort en août dix-neuf-cent-dix-huit ». Sur la guerre elle-même, y compris dans les correspondances, Aragon fait silence : « Notre silence nous semblait un moyen de rayer la guerre ». Volontaire au feu, Aragon ne participe pas à l’élan patriotique et au discours antiallemand. Dans Strasbourg repris à l’ennemi, il se rue dans les librairies pour acheter les livres originaux des poètes romantiques (Novalis, Hölderlin…) qu’il adore et des philosophes germains, Kant et Hegel particulièrement. Cela choque. Comme il choquera Barrès quand il aura avec lui un entretien, en soutenant que « L’histoire est toujours écrite par les vainqueurs »…
Dès le lendemain de la guerre, alors qu’il fait partie des troupes d’occupation en Allemagne, il écrit son premier roman, Anicet, ou le Panorama. Cette période est riche d’expériences nouvelles, de la vie sexuelle, notamment auprès des prostituées qu’il doit sélectionner pour les troupes. Ce qu’il écrit dans sa correspondance traduit la frénésie de découverte. « Je n’ai pas faim. Je suis la faim ! ». Il est avide, rapace, ogre de chair fraîche et d’expériences. Léo Ferré a mis en chansons quelques belles pages érotiques et canailles de ce moment. L’excitation s’affole, qu’on retrouve dans le côté « perversion polymorphe » de ce que vivent ses personnages, chez qui dominent le voyeurisme. Ses grandes correspondances ont commencé, avec André Breton et Pierre Drieu la Rochelle, qui sont ses alter-ego.
De retour du front, il essaie de se faire publier, commence à l’être et tâche de se faire reconnaître comme poète et écrivain. C’est une période de très grande fécondité intellectuelle et de création, en même temps qu’un moment de désarroi et d’égarement. « Je ne suis qu’un moment d’une chute éternelle ». Ses repères ont vacillé, il s’éloigne de son milieu et interrompt les études de médecine dans lesquelles on le poussait. Parrain-papa cesse de payer…Les enjeux de ses textes sont cruciaux et structurent son œuvre du moment : « Suis-je seul ? » La question est à prendre au pied de la lettre. « Y-a-t-il de l’Autre » est en effet le corollaire d’une authentique et profonde tentation solipsiste. « Chaque jour je m’estompe/En moi-même/Et je désire enfin si peu/Qu’on me comprenne ». Tout est vécu sur ce mode où rien ne permet d’échapper à la relation au double, à quoi tout et tous se réduisent, et au fait que, dans l’amitié comme dans l’amour, « La deuxième personne, c’est encore la première » (Le paysan de Paris). « Le langage quoiqu’il en paraisse se réduit au seul Je ».
Logique spéculaire des relations amicales, qui ont un tour passionnel et clairement homosexuel. Miroir aussi dans les relations aux femmes, chez qui on retrouve au mieux son idéal de soi. « Une glace lui présentait comme son reflet le fantôme d’autrui ». Le double conduit inévitablement à la tension rivale et à la jalousie. Les objets de l’autre (ses femmes entre autres) sont convoitées, mais l’affrontement menace toujours, où l’autre peut vouloir votre mort ou vouloir qu’on le tue ; à moins que les objets en tiers s’évanouissent et qu’il n’y ait qu’à « conclure » (« Il faut en finir », « une ceinture se défit ». Cette évocation d’une relation sexuelle entre deux jeunes rivaux semble directement inspirée de ce qui a été vécu, un jour, avec Drieu). Dans le miroir, l’image de l’autre peut se dissoudre, et soi-même, lorsqu’en toute logique on ne finit que par y rencontrer la mort. « Ravages dans la pose classique de la mort qui vient de faire tomber son suaire. Ô mon image d’os, me voici ».
L’amitié amoureuse envers Breton (« Mon ami et mon horizon ») déroute ce dernier, qui plus que tout abhorre l’homosexualité : « Je t’aime tant que tu ne sais pas à quoi tu t’engages ». « Je ne suis pas cet être sans sexe qu’un autre rêvait ». Les tiers sont une menace et un objet de jalousie féroce : « Je suis jaloux même des morts » ; « Je voudrais te battre comme l’ont fait les femmes rebelles ». L’aimant est prêt au sacrifice de soi et l’aimé a tous les droits, même de vie et de mort : « Je sais bien que tu peux me tuer. Je voudrais que cela te fût encore plus aisé ». Cette touche masochiste se trouve aussi engagée dans les relations amoureuses féminines. Breton comme Drieu y voient l’identification féminine d’Aragon, ce que Drieu appellera méprisamment « cette chose femelle ».
Cette période aboutit à deux passages à l’acte dramatiques : D’abord Aragon détruit le volumineux manuscrit d’un livre auquel il tient par-dessus tout : Défense de l’infini. Il le brûle à Madrid, et seule une partie (publiée longtemps après) est sauvée des flammes par Nancy Cunard. Puis il tente de mettre fin à ses jours à Venise.
Les choses sont lucidement énoncées : « Je suis le suicide vivant ». « Le long désir de désirer m’accable » (Notons la consonance avec ce qu’Eluard appellera plus tard « Le dur désir de durer »). Mais alors, comment vivre ? Deux voies se dessinent, qui apparaissent comme des horizons, des au-delà du duel et de la solitude : l’engagement politique et l’amour. Les deux sont des moyens de donner consistance à l’Autre et de rompre par une médiation tierce ce qui est une solitude désespérante et mortelle (« Croire à l’existence d’une femme/Il n’y a pas que moi au monde »). A l’engagement - après les agitations nihilistes et anarchisantes qui colorent de radicalité un fond de dandysme bourgeois et de mépris du prochain (« J’aime infiniment mieux le jeu que les gens ») - Aragon est poussé par Breton, qui veut s’ériger en mentor et en maître. A cette volonté de domination explicite et tyrannique, Aragon oppose un refus résolu quant à ce qui soutient son être : l’écriture et la littérature. (« Ecrire est ma seule méthode de pensée »). Breton demande s’il est prêt à le suivre. « Soupault dit oui. Moi, non ». Mais la pression vers l’engagement communiste est fort. Il est très douloureusement vécu : Il écrit à Simone Breton : « Ce que je tue de moi »… « Il n’y a plus qu’une idée là où j’étais assis ». Se conformer au groupe est une amputation.
Du côté de la recherche de l’amour, on ne peut que penser qu’Aragon essaie désespérément de retrouver quelque chose du bain d’amour inconditionnel et sans limite qui était celui de son enfance. Ce qu’il y a de puissant dans son narcissisme et qui alimente la séduction irrésistible qu’il exerce sur tout le monde trouve là son origine. Être aimé d’une femme qu’on adore est une aspiration massive. Le désir est violent, teinté de transgression nécessaire et jamais sans ravage : « Il y a dans l’amour un principe hors la loi, un sens irrépressible du délit, le mépris de l’interdiction et le goût du saccage ».
Trois femmes viennent s’y inscrire successivement, trois femmes aimées dont on peut dire qu’elles ont des points communs : Eyre de Lannux (maîtresse de Drieu), Nancy Cunard et Elsa Kagan (dite Triolet) sont des « Maîtresses ». Il s’agit à chaque fois d’une femme étrangère, qui prend clairement l’initiative et garde la tête froide. Nancy le « viole » dans un taxi. Eyre le « déshabille » sans qu’il puisse opposer de résistance... Leur apparition est à chaque fois presque irréelle et idéalisée. Elles ont quelque chose de divin, comme « la Reine blanche », où se retrouvent la déesse et la mort. Elles sont érigées comme des idoles, des figures de La Femme. Leur regard est le support de ce qu’il y a d’hypnotique et de fascinant dans la relation. Aragon est subjugué et soumis : « J’étais son chien, c’est ma façon ». Il est crucifié, offert en croix et meurt d’aimer. Mais l’objet aimé comme le sujet sont menacés dans la surface spéculaire : « elle part dans le miroir » et l’être se dissout. Comme on l’a dit dans l’amitié, la composante de masochisme érotique est ici bien présente : « Que je m’écroule, bats-moi, effondre moi./Je suis ta créature, ta victoire, bien mieux ma défaite ».
Cette double quête (engagement et amour) aboutit, en 1927 avec l’adhésion au Parti communiste (celle de Breton est refusée) et en 1928 avec la rencontre d’Elsa Kagan à la Coupole (Maïakovski y est présent). Aragon fixe dans son ciel les deux repères qui l’ancrent au-delà de l’axe imaginaire. C’est d’un côté une figure de père de qui il se fait adopter, qui jouera pour lui le rôle d’un surmoi féroce jusqu’au bout. En 1954 il écrira encore « Salut à toi Parti ma famille nouvelle/Salut à toi Parti mon père désormais ». Thorez sera son mentor et sa parole sera pour lui indéfectible, comme son soutien. (« Je me suis toujours demandé : que penserait Thorez ? » Il fallait « Être digne de lui »). Il couvrira allégrement tous les crimes du stalinisme dont il sait tout ou presque : apologie du pacte germano-soviétique, idéalisation de l’URSS comme construction dressée vers le ciel, excitation de l’ambiance de Moscou lors de son séjour de 1925 : « Moralement, il y a quelque chose d’exaltant, dans l’air d’ici, de très Fouquier-Tinville ». Il souhaite une « Grande Terreur ». Exultation devant les chasses à l’hommes : « On est en train de détruire vraiment, de traquer », « La dictature du prolétariat commence. Au loin retentit le bruit de la fusillade : ce sont les saboteurs qui crèvent ».
Cet aveuglement, si c’en est un, continuera presque sans fin. En 1930-1931, il dénonce le freudisme et fait son autocritique, écrit « Feu sur Léon Blum » et appelle à tirer sur la police et les socialistes. En 32-33, période des grands famines et de crise, il vente le « rêve de rééducation » (c’est-à dire le Goulag !) et en 1972, dans son histoire de l’URSS, il soutiendra encore la « foi bouleversante dans les infinies possibilités de l’homme » que représentait l’époque stalinienne. C’est paradoxalement Elsa qui lui ouvrira les yeux sur les grandes purges : ce sont les juifs qu’on assassine ! Dont le Général Brick, mari de Lili, la sœur d’Elsa…Aragon n’aura pas un mot et continuera de parler des « saboteurs ». Plus tard, Simone Signoret dira sa souffrance devant son refus d’intervenir contre les ignobles procès de Prague (voir L’aveu, de Costa-Gavras, et La nostalgie n’est plus ce qu’elle était, de Simone Signoret) où sont liquidés massivement les combattants de la guerre d’Espagne, les anciens résistants, les juifs, et tous les témoins gênants. Aragon justifie le pire et s’assure, dans la glace du salon, du maintien impeccable de sa belle apparence…
En filigrane, on aura droit à quelques regrets de s’être tant trompé. Au moment de Budapest et du rapport Kroutchev : « Un poignard sur mes paupières/Tout ce que je vois est ma croix/Tout ce que j’aime est en danger » ; et d’avoir tant joué avec la vie des autres : « On sourira de nous comme de faux prophètes/Qui prirent l’horizon pour une immense fête/Sans voir les clous perçant les paumes du messie »…
De l’autre côté, Aragon voit dans l’Autre féminin la possibilité d’une sorte de rédemption et de renaissance. L’élue (ou celle dont on est l’élu ?) a nécessairement une nature exceptionnelle, à l’égal de soi-même. Les grandes figures de l’amour sont présentes en arrière-plan, sur fond de légendes et de fables. Car ce qu’on écrit avec sa vie a la force du mythe (« Je me mis à concevoir une mythologie moderne »). Beaucoup ont interrogé voire douter de la sincérité et de la réalité de ce couple ou de l’intensité de cet amour. Drieu - qui a beaucoup plus à se faire pardonner alors, ou qui se sait impardonnable - écrira encore en 40 qu’il pardonne tout à Aragon, parce que c’est un amoureux. Tristan et Iseult comme toute la légende celtique rejoignent ici les personnages de l’amour courtois, et Laure et Béatrice sont convoquées par « Les yeux d’Elsa », comme Dante et Pétrarque auprès de leur frère en poésie. Le beau roman à l’eau de rose, les effusions lyriques et l’amour éperdu ne dissimulent cependant jamais que « l’amour est à douleur », qu’on aime « à perdre la raison », que « la vie est un étrange et douloureux divorce », soit que puisse être « heureux celui qui meurt d’aimer », soit qu’ « il n’y (ait) pas d’amour heureux ». Car « On vit ensemble séparés »…
Elsa et le Parti sont deux termes de la constellation mise en place par Aragon à partir de 1927, qui dominent cet incessant travail d’invention de soi dont l’écriture est, depuis l’âge de 5 ans, le principe et l’outil. Il ne s’agit pas d’être un homme parmi les hommes (malgré le bavardage pseudo-prolétarien et les lendemains qui chantent), de rejoindre ses semblables et de faire humanité. Car les semblables sont précisément ceux par qui on est toujours ramené au duel (« Abel et Caïn, le sabre toujours levé des guerres de cent ans »), à la solitude de soi et au maître absolu qu’est la mort.
C’est le hors-pair, qui est visé, quelle que soit la facticité (dans tous les sens du terme) de cette composition : comme Aragon l’écrira deux fois : « Je suis un personnage hors-série ». Phrase où il faut entendre l’artificialité que désigne le mot personnage, comme sur une scène et dans une fiction, et le statut extra-ordinaire que définit le hors-série…
La constellation (ou la tresse) permet aussi de soutenir un nom : Aragon, qui est sa signature, sans prénom, ce nom, pure invention arbitraire de l’Autre parental, qui est le nom-de-l’auteur d’une œuvre magistrale ; d’une œuvre qui s’inscrira résolument dans une tradition où elle revendiquera sa filiation : la longue lignée des poètes français, depuis les troubadours et l’amour courtois, avec le sonnet, la rime, les vers pairs, l’alexandrin. Toutes ces formes classiques rejetées depuis Mallarmé, Lautréamont et Rimbaud, par tous les modernes dont il se réclame en même temps. L’invention stylistique trouve à se loger dans ce moule, dans cet ensemble de codes et de signes qui fait une généalogie et une chaîne.
Une clé du rapport d’Aragon à son œuvre et à l’écriture trouvera sa définition rigoureuse dans un texte tardif qui dit en même temps son rapport à l’origine et à la vérité, à la réalité et à la fiction : « Le mentir-vrai ». Ce titre est en lui même une méthode et un principe éthique. Sa logique est celle de la vérité menteuse de Lacan, de la varité, de la vérité qui a structure de fiction. Aussi, on ne parle jamais de soi tel qu’on est, des faits tels qu’ils sont, ou ont été : on construit une fiction, qui est le seul moyen possible d’approcher un vrai qui se dérobe et qu’on peut au mieux faire exister par l’imagination. « J’imagine à plaisir », tel est le programme du personnage qu’on se fait exister. Aussi, pied de nez au réalisme socialiste qu’on a voulu lui imposer et qu’il a fait mine contre toute évidence d’adopter : « Les réalistes de l’avenir devront de plus en plus mentir pour être vrai ».
Le mentir-vrai s’est imposé à Aragon. C’est la solution qu’il a trouvée pour traiter le mensonge familial, la tricherie permanente de son enfance, la légende des origines dans lequel on l’a emprisonné et où rien n’était dit vraiment. « Tout serait / Mensonge illusion moi-même / et toute mon histoire après ». Aussi, le choix forcé pour faire avec cet Autre biaisé, faussé, truqué », postiche conduit à broder infiniment un mensonge plus vrai que le vrai.
Le mentir vrai est la clé, aussi fictive que tout le reste, de ce qu’Aragon appelle sa théorie des « hommes-doubles ». Sa capture incessante et jamais totalement réglée dans la relation à ces doubles comme autant d’objets de passion se reflète à nouveau dans la duplicité de son être. C’est bien la dure loi d’être double qui règle son destin. Quant au goût de la souffrance et aux affinités indélébiles, il en sera question jusqu’au bout ; comme en octobre 1972 dans « La valse des adieux », alors que le Parti le prive des Lettres françaises, son journal sacrifié : « Je crois au pouvoir de la douleur, de la blessure et du désespoir ».
Reste ce qu’habille d’étoffes élégantes le mentir-vrai qui est la clé d’une vie et d’une œuvre : la trame d’imposture, qui est la seule chose que Louis Aragon s’est vu transmettre par son père.