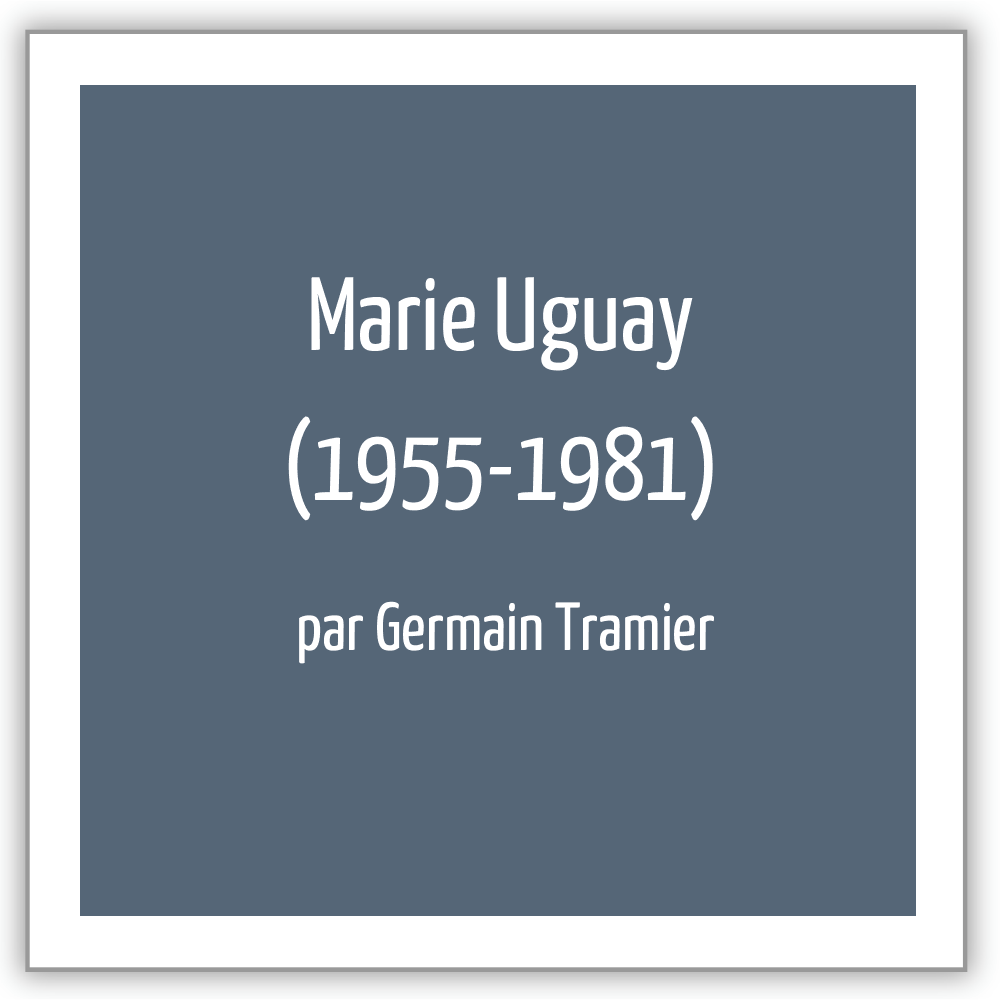Marie Uguay (1955-1981) par Germain Tramier
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Le soir ils ont suivi l'exode des foules
dans les bras bleutés des couloirs et des ponts
vers la périphérie du monde
comme pour un départ final
Marie Uguay, si ce nom ne nous dit rien, ou presque, il faut traverser l'Atlantique, se rendre au Québec, pour en entendre les premiers échos. Elle qui s'était tournée très tôt vers l'écriture, à 15 ans commençait de rédiger des poèmes, qui paraîtront à ses 20 ans, dans un premier recueil : Signe et rumeur, tout un programme. Elle n'a que 22 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer des os, quelques mois d'hôpital, une jambe amputée, d'autres traitements suivront. Existence tronquée brutalement : elle a le temps de rédiger deux autres recueils, quelques poèmes en prose, s'éteint à 26 ans. Des trois poétesses que je me propose d'évoquer, c'est celle qui a joui de la postérité la plus large. Ainsi est-il peut-être temps de découvrir ce que faisait la poésie en 1970, ailleurs.
22 mars 1980, Marie Uguay lit quelques uns de ses textes lors de la Deuxième Nuit de la Poésie à Montréal. Dans un film on la voit seule sur une estrade nocturne, la face lumineuse, corps adolescent et voix d'adulte aux immenses lunettes ; elle a 24 ans, vient de finir la lecture d'un poème, entame le suivant :
« Il existe pourtant des pommes et des oranges/ Cézanne tenant d'une seule main/ toute l'amplitude féconde de la terre/ la belle vigueur des fruits/ Je ne connais pas tous les fruits par cœur/ ni la chaleur bienfaisante des fruits sur un drap blanc [...] ».
Elle continue encore quelques minutes, sévère et timide, un silence, à peine, et puis quelque chose : on applaudit sa fragilité brutale, son émotion lucide, au fond de la nuit, c'est un poème qui vient de naître. L'extrait est visible à la fin du documentaire de Jean Royer, où Uguay énonce tout ce qui sera sa poétique ; il y aura des couleurs, beaucoup de couleurs, senties, sobriété féconde comme un haïku qui s'allonge, les revendications aussi :
« Des femmes n'en finissent plus de coudre des hommes/ et des hommes de se verser à boire ».
Et devant la mort, la recherche d'une Outre-vie (titre de son deuxième recueil) : existence verbale et sensitive, refonte de la vie par l'imagination (non pas la fuite du monde, mais sa mise en images étendues, l'ouïe, l'odorat, la vue bien sûr) afin de remotiver, peut-être, l'éternité des saisons perçues dans l'enfance, ces longues années où tout durait, brûlait d'une vie sereine, ce que le cancer est venu briser :
Mais les barrières les antichambres n'en finissent plus
Les tortures les cancers n'en finissent plus
les hommes qui luttent dans les mines
que l'on fusille à bout portant en sautillant de fureur
n'en finissent plus
de rêver couleur d'orange.
Dans tous ses poèmes, Marie Uguay attache une attention particulière à la saisie des impressions, comme des photographies verbales rendues évidentes par un lent, laborieux, travail de la langue, touchant souvent l’indicible par un jeu subtil de la synesthésie :
(Derrière une fenêtre le dos détendu
d'une chaise de paille
évoque le tressage heureux
d'un quelconque voyage au soleil)
Et de vers en vers, la sensualité du monde n'en finit plus de jeter l'être au dehors ; peut-être a-t-elle senti plus que quiconque cet appel de l'extérieur, perdue dans sa chambre d'hôpital, se laissant dissoudre dans le monde et la parole :
« l'esprit s'ouvre/ quand nous longions les vagues/ l'air avait des lèvres » ou bien : « un oiseau chante dans le store/ et la brise de mes cheveux me lie au goût de pomme/ et de poussière. »
Comme Maurice de Guérin, Marie Uguay plonge dans l'atmosphère, se détache de Marie Uguay pour nous lancer des expériences collectives. Non pas des redites de nos vies, mais le rappel de ce qui nous frappait autrefois, ce que l'esprit construit perd ; cet émerveillement d'enfance tantôt fécond, tantôt mélancolique, le jeu du monde sur le corps :
« Nous ne ferons rien/ dans l'ombre métamorphosée des vignes blanches/ ces grappes de givre que l'hibernation accroche à nos cœurs ».
Cette poésie des saisons nous rend une chair d'enfant, densifie notre ancrage au réel, nous sert ses boissons colorées, ses odeurs de temps ; tout un art de la nuance comme une épure de Verlaine.
Et, peut-être pour mieux soutenir la violence de vivre, cette brutalité sans freins :
« toutes les saisons ont été froissées comme de mauvaises copies/ nos ombres se sont tenues immobiles/ c'était le commencement des destructions. »