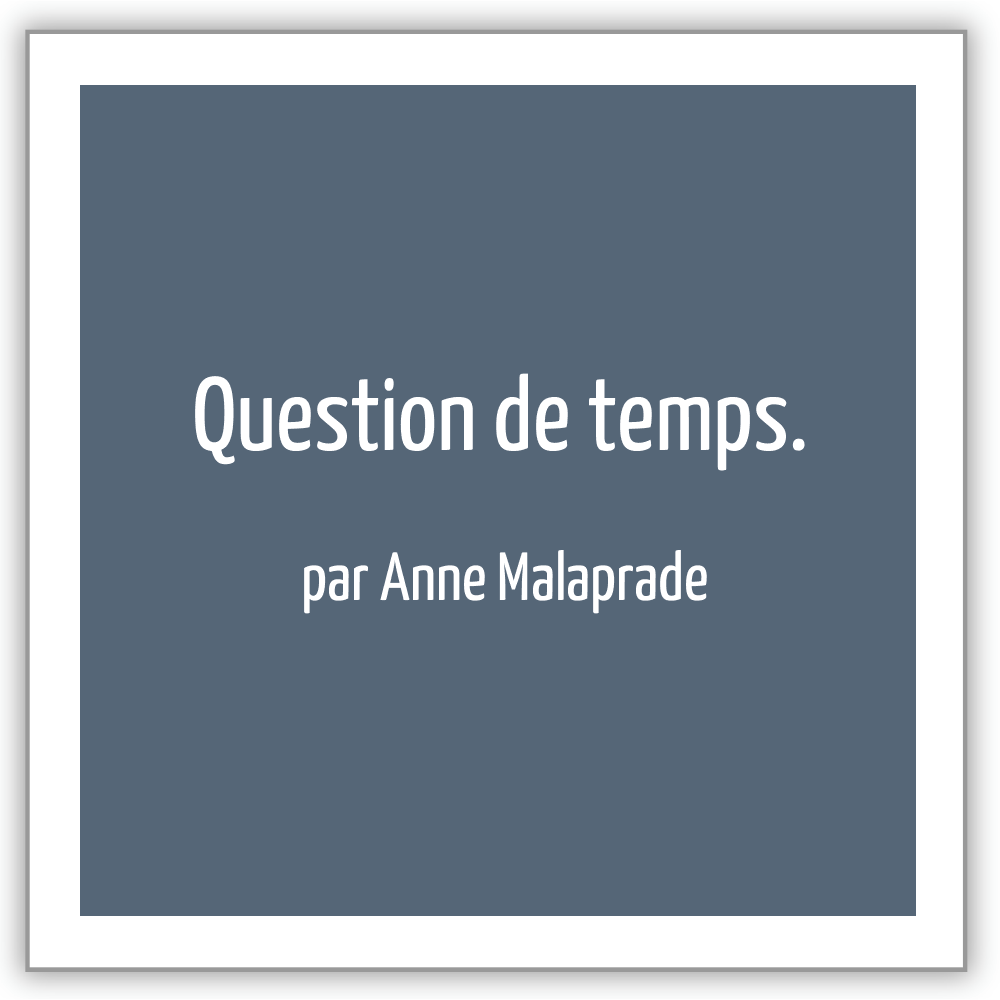Question de temps. par Anne Malaprade
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Le temps passe est le titre d’une nouvelle de Virginia Woolf datant de 1926 qui constitue aussi le fragment central de La Promenade au phare. Redécouvrir ce texte marque le passage du temps, aide à passer le temps, et temporalise, dans tous les sens du terme, ce que vivre pourrait signifier quand la Vie passe aussi par le corps des mots : l’électrise, l’aimante, le parcourt, tel un courant qui intensifierait le verbe jusqu’à la beauté, de celle qui se découvre dans la douleur, lorsque la perte survient. Celle qui désarme, console et dénude. Celle qui accomplit la dure tâche de vivre et de survivre aux fragments de bonheur que la conscience a oublié de fêter.
Que dire du temps qui passe, sinon ses effets sur les choses, les décors, les paysages, et les rares humains qui les habitent ? Comment dire la vie du temps à partir des éléments et de la Nature ? Pourquoi renoncer à l’hypothèse humaine, au témoignage des sens et des émotions ? Comment observer l’invisibilité du temps à l’œuvre depuis un point de vue lui-même disséminé, comme si la perception humaine, défaite, avait investi le marbre et le ciment, le vent et l’obscurité ? Qu’est-ce que voir avec des yeux nyctalopes matières et choses, végétaux et masses inertes ? Qu’est-ce que sentir à partir des passions muettes ? De quelle façon décrire un monde délaissé, quitté par les vivants, un espace rendu à la nuit et à la sauvagerie, à un temps cosmique qu’aucune montre, aucune horloge ne peut compter, aucune durée intérieure ne peut aimer ? L’écrivain adopte un point de vue qui est celui du vent, de la lumière, des embruns, des matières, de l’eau sous toutes ses formes : la vie est aussi dans ces plis et replis silencieux qui investissent les lieux aimés, colonisent les volumes, colorient un présent sans énonciation. Ce parti pris radical édifie une scène superbe qui se déploie sur plusieurs pages : toute chose, toute contenance, toute densité est progressivement recouverte par la matière du temps qui dépose sur le monde des hommes la lente pesée de l’oubli, la consistance du changement, l’incorporation de la variabilité au cycle.
Virginia Woolf est celle qui, humaine trop humaine, a su trouver la voix capable de décrire la montée régulière et continue de l’invisible sur le visible, cette marée sonore qui entoure, célèbre et protège les tissus et les substances, les murs et les matières devenus transparents. Quel nom donner à cette force, à cet élan qui, ni prose ni poème, trouve le moyen de composer l’enfance retrouvée du monde alors même qu’est chanté un deuil pour lequel n’existe pas encore de nom ?
Tout lecteur repose dans un corps qui vieillit : toujours plus fragile, toujours plus sèchement exacerbé, il flotte parce qu’il faut bien vivre, soutenir les enfants dessinant certaines étoiles de mer. On offre sa volonté à la diction des vagues. Dans la lecture s’engouffrent le souffle et l’histoire, le souffle de l’histoire. Comme si la traversée des phrases invitait à rejoindre le vent qui les porte. Time passes. Il s’agit d’une aventure du temps : non plus la répétition d’un destin et d’une destination, mais une détermination d’autant plus affirmée qu’elle accepte la portée de nos temporalités. Celles-ci conduisent la vie dans la mort pour autant que la mort réalise aussi nos vies. Ainsi le temps dans le texte est au monde tout en faisant le monde : il réalise un tempo qui ne connaît pas la perte, un crescendo qui engouffre et dévore sa propre énergie. En lisant et relisant le phrasé de Virginia Woolf, on s’empare d’une éternité à l’avant du temporel. Elle importe, emporte, exporte : déporte la souffrance, celle-là même qui grise le corps renaissant à la première lumière du jour. Le temps passe le temps, le corps du temps repasse tout corps : il lie plus qu’il ne sépare, réunit plus qu’il n’éloigne. Dans ce texte-passage, la littérature devient ce qu’elle est : la conduite de la Vie dans la vie, le mouvement par lequel s’expose ce que la liberté doit à l’acceptation, qui n’est pas résignation, et encore moins renoncement. Le flux soulève l’angoisse : elle n’est plus dans la prise de l’inquiétude, dans l’emprise du non-dit, celui du matin trop matinal ou de l’insomnie envahie par la culpabilité. Ce flux accorde une autre puissance à la conscience : l’abandon à la seule aimantation du texte, qui déchaîne la raison, la réarticulant au songe d’une veille attentive. Proposition troublée, accent déplacé, ponctuation vibrée. Les personnages se fondent dans le décor, le fond caressant la surface, le contenant épousant le contenu : le temps n’est plus un cadre mais le mode même du devenir de l’être. A cette échelle la vie déplace la mort comme la mort dépose la vie. Le lecteur, dont le « je » s’éparpille, se noie tout en sachant que cette vague-ci le déposera jusqu’à la dernière page d’un livre qui accomplit ce qui s’écrit : en passer par le temps de l’écrire et du lire, délier les crispations et les habitudes, convenir que l’on meurt d’attendre alors qu’il faudrait vivre pour accompagner.
Le temps n’a jamais passé. Il est le futur de toute littérature.