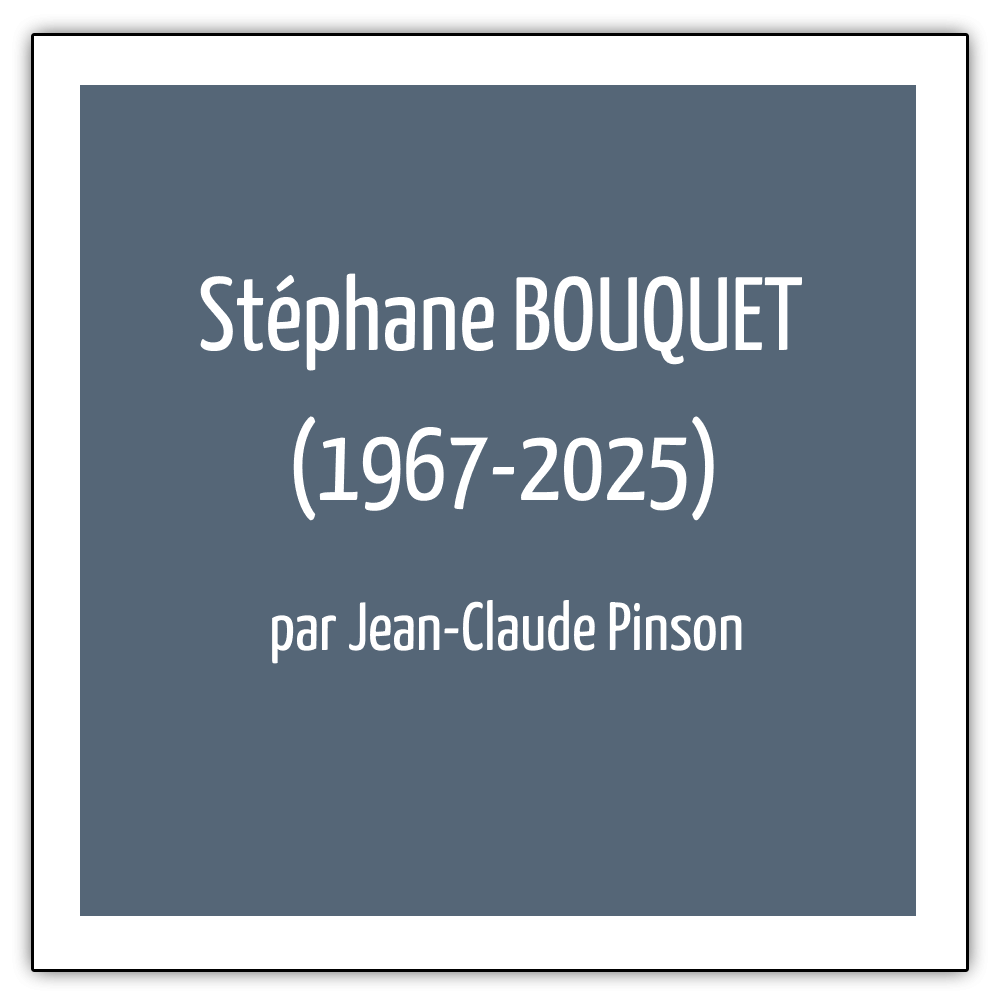Stéphane BOUQUET (1967-2025) par Jean-Claude Pinson
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
In anno aetatis
(57 ans)
Touchés, nombreux, très nombreux, nous le fûmes à l’annonce de la mort de Stéphane Bouquet, survenue le 24 août dernier. Tout sauf tapageuse, sa poésie touchait beaucoup plus de lecteurs qu’on aurait pu le croire, et les touchait au plus profond. Que « toucher » soit un verbe essentiel à un poète qui aura été un fleurettiste d’exception, chacun de ses livres, chacun de ses poèmes, chacune de ses phrases, prose ou verset, en administrait la plus sensible preuve.
Le toucher, mais le tact également. Comment en effet ne pas parler d’abord de la personne du poète ? Mieux qu’à quiconque, « Juste de vie, juste de voix », l’adage de Philippe Jaccottet, semble convenir à Stéphane Bouquet. De sa présence, de son visage, tous ceux qui l’ont connu en conviendront, émanait une lumière singulière, presque enfantine, mélange de bienveillance et de gravité, de sérénité et de pensivité toute en retenue. D’emblée, quand il me fut donné de le rencontrer, c’est à un portrait célèbre du jeune Hölderlin, un pastel de Franz Karl Hiemer datant de 1782, que je pensai.
Si son œuvre a eu autant d’écho, c’est d’avoir su renouer avec un grand nombre de thèmes essentiels à la poésie et cependant délaissés par elle depuis quelques décennies. Elle ose ainsi parler de la vie ordinaire et de ses bonheurs les plus communs, n’hésitant pas par exemple à remettre en circulation un mot aussi frelaté que celui de « tendresse ». Surtout, elle le fait en usant, non pas tant d’un langage nouveau, que d’une démarche poétique nouvelle, inventant des formes où peuvent cohabiter allègrement dans un même livre le poème, le récit et la pièce de théâtre. Poésie poïkilos, bariolée, qui créolise de la plus rafraîchissante des façons vers longs et vers courts, prose narrative et prose dialoguée. Poésie qui est aussi, à rebours des poétiques de la stase, de l’arrêt sur le mot, affaire de flux, de rythme : « J’ai une passion pour les mots en fl – fleuve, flux, fluide, flotter et flocons, fleurir, effleurer, effluves, melliflu et mêmes pantoufles – et toutes les consonnes liquides. » Car les mots, loin d’être des isolats, des monades sans portes ni fenêtre, sont déjà des amorces de phrases. À leur façon, ils sont des « formes de vie » qui « plantent leurs racines très loin dans le vécu de chacun ». Au-delà de ce qu'il dénote, chaque mot est « un petit récit intime – un petit paysage, un puits de sensations et de significations ». Ainsi le mot « neige ». Pour quelqu’un qui vit « dans un pays désormais à jamais privé de neige », il n’est pas simplement synonyme de blancheur ; « il veut dire quelque chose d’élégiaque ». Et pour l’auteur lui-même, plus spécifiquement, le mot neige « tombe encore sur une maison dans le Grand Nord, il tombe sans arrêt et doucement et comme une caresse sur des enfants qui jouent et il inclut les pas craquants de quelqu’un de très grand qui viendra, chaussé de raquettes peut-être, qui arrive et qui trouve le moyen de nous relever et finalement de nous consoler. »
En somme, les mots sont déjà des phrases en puissance et le travail du poète, s’il est lui-même « un verbe d’action », est de se faire sage-femme et de les mettre au monde. Et Stéphane Bouquet de raconter comment, « spectateur passionné de danse » (il a travaillé avec la chorégraphe Mathilde Monnier), il en est venu à comprendre que « l’unité de base de [ses] poèmes devait être la phrase et non le mot ». Écrire un poème, ce sera désormais pour lui avant tout inventer entre les mots des rapports syntaxiques semblables à ceux qui se peuvent nouer entre les corps sur un plateau de danse. Alors peut naître un ordre prosodique qui sera aussi bien un « désordre fraternel » (Stéphane Bouquet emprunte cette belle formule à une proclamation édictée en l’an III de la Révolution française).
Flux – et foule, aussi bien. Baudelaire parlait de « l’ivresse » qu’on éprouve à se perdre dans la foule des grandes villes. C’est cette grandeur extensive, celle du nombre innombrable, du peuple ordinaire, que le poète « démocratique » Stéphane Bouquet entreprend, à la façon de Whitman, de chanter. Mais la grandeur de l’ordinaire est aussi intensive, dans la mesure où le regard du poète, sa pulsion scopique, conduit à une érotisation généralisée du réel qu’il appréhende. Un furet, celui du désir (cet autre nom pour la vie), semble ainsi courir tout au long des livres de Stéphane Bouquet, conférant la plus grande vivacité à une écriture cursive, « américaine » (par sa façon pragmatique de couper au plus court). Pour mieux saisir la prose du monde et les épiphanies qui y palpitent, c’est au prosimètre que le poète a recours, alternant narration fragmentée, bifurquante, conversation à plusieurs voix, et chorus de « vers projectifs » à la façon d’Olson.
À rebours des poétiques du manque, du trop peu de réalité, c’est ainsi à une poétique de l’excédence que nous convie Stéphane Bouquet : « Il sent simplement que le monde déborde et lui coule dessus et le noie de présence […], il ne peut jamais vraiment lui faire face entièrement ». Poétique de l’affirmation donc, qui ne s’emploie à « noter soigneusement toutes les affirmations du néant » que pour aussitôt « y adosser les contreforts affirmatifs du poème » et produire ainsi « un éloge toujours recommencé du monde ».
S’il est possible, sans tomber dans la grandiloquence et la vieillerie poétique, de relever ainsi le défi de l’hymne, d’en conserver l’élan, c’est à une double condition. Celle d’abord de s’immerger dans la prose du monde contemporain (un monde où le ciel est vide et les héros des produits marketing) et d’y faire provision, pour nourrir le « cœur bête », de ce « pur curare de beauté » que peut offrir, par exemple, un visage entrevu sur un site. Celle ensuite d’inventer un phrasé neuf, à la fois sobre (dépouillé du ton oraculaire) et cependant capable encore de chant (de louange, de célébration), quand bien même enfuies sont les anciennes croyances.
Singularité d’une voix, mais aussi d’une réflexion sur la poésie. À quoi bon des poètes ? – Sempiternelle question ; plus que jamais brûlante cependant. Stéphane Bouquet à son tour l’aura reposée. Mais c’est pour en modifier assez radicalement le sens en même temps que la tonalité. Car ce n’est plus une poésie « en temps de détresse » qui lui chaut, mais une poésie « pour temps d’appétit ». Si poésie pensive il y a (et il y a bien), elle sera donc placée sous le signe d’une « déclinaison heureuse des choses sans frontière ». Sous le signe par exemple de ce fragment où Empédocle déclare : « et je fus autrefois garçon et fille, oiseau et buisson, poisson dans la mer ». Que peut être le poète quand il n’est plus ni prêtre ni prophète – ni même cet « instituteur de l’humanité » dont rêvait Hölderlin ? Peut-être « une sorte d’avocat » : « – oui c’est vrai je suis avec vous et pour vous ». Entendons que, mêlé à la conversation ordinaire, à son brouhaha multiforme, il s’en fera l’écho. Plus de vocation d’exception qui ferait du poète un être hors du commun et le placerait en position transcendante. Si du chœur général il fait s’élever son chorus singulier, c’est pour mieux reconduire sa voix individuelle dans la cohue des voix ; c’est pour être avec d’autres ce « caresseur de vie » dont parlait Whitman.
Il n’y a pas lieu, dans cette perspective, de sacraliser l’objet textuel ou la page. Les poèmes sont comme une sorte de monnaie dans le commerce des êtres et des corps. Guère plus. « Le poème a pour vocation d’être entre deux personnes plutôt qu’entre deux pages. » La poésie comme « commerce » (ou même « prostitution au sens large », n’hésite pas à écrire Stéphane Bouquet dans un article consacré à Pasolini, une référence majeure pour l’auteur) ; commerce contribuant à créer une urbanité politique, sentimentale et économique (au sens où l’économie est d’abord habitation de la maison humaine qu’est le monde).
L'œuvre de Stéphane Bouquet, on s'en apercevra de plus en plus, est tout à fait essentielle par ces chemins nouveaux qu'elle a ouverts à la poésie contemporaine, sans souci des postures et chapelles.
Tout se tient est le titre du dernier livre de l’auteur, paru quelques mois seulement avant sa mort. Et en effet, relisant la 4e de couverture du premier livre (Dans l'année de cet âge), je ne peux que constater que dans l’œuvre de Stéphane Bouquet, tout se tient. Elle est d'une grande cohérence, en même temps que les formes y sont les plus variées, n'hésitant pas à s'écarter de ce qu'ordinairement on attend d'un poème.
Cette 4e du premier livre commençait ainsi : « In anno aetatis est l'inscription que les Romains gravaient sur les tombes. Cela veut dire : il est mort dans l'année de cet âge, par exemple vingt-trois ans. D'une certaine façon, ce titre convient à ce livre, qui est un tombeau. Je tiens le compte, jour par jour, de la mort et comment elle progresse. »
Ces phrases résonnent évidemment aujourd’hui avec une particulière acuité. Je ne voudrais pas toutefois qu'on oublie combien la poésie de Stéphane Bouquet est capable, en contrepoint de cette gravité, de donner à sentir ce qui fait que la vie est aussi allégresse. C'est toute la palette des émotions et sensations qu'elle sait communiquer, et elle le fait sans se départir d’une « ligne claire » qui aura distingué l’auteur de la plupart de ses contemporains. Là est aussi sa capacité hors du commun à nous toucher.