Stéphane Bouquet, Tout se tient par Jean-Claude Pinson
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
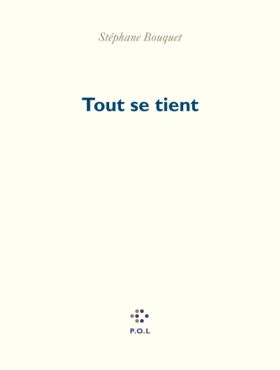
Qu’attend-on d’un livre de poésie ? Des choses assez diverses sans doute. Mais peut-être d’abord qu’il nous donne le plus vif sentiment du présent, de la vie. Qu’il la saisisse en cette centralité cardiaque, cordiale, qui la fait vivante et palpitante. Sentiment du présent : le charme puissant de la poésie lyrique, notait Arno Schmidt, est lié, pour une part essentielle, à l’emploi du présent, parce qu’il est « le temps de la vie » et ainsi « exerce sur l’esprit du lecteur une fascination infiniment plus directe que le plus-que-parfait, faussement retenu, en fait poussiéreux et bavard » qu’on trouve dans tant de romans.
Voilà ce que j’écrivais, il y une quinzaine d’années, à propos d’un livre antérieur de Stéphane Bouquet (Nos Amériques), ajoutant : « C’est bien un tel sentiment que suscite, éminemment, le dernier livre de Stéphane Bouquet. Par son énonciation vibrionnante, la jeunesse et la vitesse de sa langue, il atteint à cette piqûre au plus vif de la vie, qu’on attend du poème ». Ces mots, aujourd’hui que l’œuvre s’est singulièrement affirmée, je ne peux que les reprendre pour caractériser ce sentiment de la merveille qui naît à la lecture de ce nouveau livre, Tout se tient.
Quelque méfiance qu’on puisse avoir pour toute idée d’une mission qui serait celle de la poésie, on conviendra que si elle est quelque peu ambitieuse, elle cherchera à dire son temps et pour cela se mettra en demeure d’inventer une langue apte à une telle diction. Mais le « temps », l’« époque » qui est nôtre, cela peut s’entendre (et se dire) diversement – et d’abord parce qu’infiniment multiples sont ses ramifications et stratifications. Si on la comprend toutefois, cette époque, à l’aune de la grande Histoire, le poète alors s’emploiera à porter au langage ce qu’elle a de plus tragique. Sans détours, il parlera de la guerre en Ukraine et de celle à Gaza, comme l’a fait magnifiquement et décisiviment Dominique Fourcade dans ses derniers livres.
Autre, mais non moins décisive, est l’approche de Stéphane Bouquet. De l’époque, il s’attache à saisir, à même la quotidienneté la plus ordinaire, les ressorts les plus intimes. Celui par exemple qui fait que pour chacun, tandis que l’enfance est désormais chose plus « ancienne » que jamais, « le futur lui aussi est rempli de tristesse ». D’une indéniable pensivité mélancolique, telles sont les « Méditations de l’ancien jeune homme » qui ouvrent le livre. Même si leur registre, leur façon de « parasiter les grands érables du langage ») en est très éloigné, elles ne sont pas sans faire songer aux élégies rilkéennes quand elles constatent « que nous sommes/plus seuls que les choses qui n’ont besoin de rien ».
Mais si quelque Rilke hante les pages de ce livre, c’est un Rilke qui serait passé par l’Amérique et y aurait acquis le sens du « bas voltage » propre à la poésie du Nouveau Monde – un Rilke qui aurait correspondu, plutôt qu’avec Tsvétaïeva et Pasternak, avec William Carlos Williams. Dans l’article qu’il consacre à l’auteur de Paterson dans le dernier numéro de la revue Europe, Stéphane Bouquet écrit que Williams a voulu « refonder une langue » apte à dire l’Amérique de son temps, à faire sentir « la respiration de sa vie quotidienne » ; et pour ce faire cherché à doter ses poèmes de « tactile qualities » pour mieux « voir, toucher, goûter, éprouver le monde alentour ». Et en effet, pour Stéphane Bouquet, comme pour William Carlos Williams, c’est bien « le mouvement, la vitesse, la vivacité, [qui] constituent le Graal ».
Mais si le mot « horizon » est « ce mot qui calmement/déserta nos lexiques de la maturité », si, « recroquevillées d’effroi comme/ devant un film d’horreur », les feuilles ne peuvent plus, par temps de canicule, tenir leur promesse de sieste bucolique, donnant crédit plutôt à la fameuse prophétie baudelairienne affirmant que « le monde va finir », « il faut bien que croire continue », que le « principe espérance », cher à Ernst Bloch (cité au détour d’un poème), continue, car la suite des jours, elle, continue (« Je n’ai pas les pensées mais je possède /les jours »). Et quand bien même on aurait « renoncé au concept/ de consolation, à l’idée de hutte/ou d’enclave/nichée sous les arbres, à dans les saules/l’écureuil /de caresse », on n’a pas renoncé au reste, aux saisons, au hamac, au geste appris qui aide faire « le nœud idoine pour nous pour s’allonger/dedans ». On n’a pas renoncé à ce que la vie soit encore « soulèvement de la terre ». Car, comme le chantait Mouloudji, « faut vivre », et l’on peut encore se réjouir qu’une île « nous ramasse/ou recueille sur/son délicat rivage/ pendant que nous sommes/ pour/ le soulèvement même archi plat de la terre ».
Stéphane Bouquet n’a jamais hésité à faire que cohabitent dans un même livre des genres et registres réputés bien distincts. Le fait de vivre, son précédent ouvrage, mêlait ainsi allègrement le poème, le récit et la pièce de théâtre, sans qu’en soient affectées ni la cohérence du propos ni la continuité de la voix. Cette fois, c’est un essai sur Pasolini (« Colloque pisan du centenaire ») et un conte – ou plutôt une courte légende et un conte (« Conte de la fougère et des vagues et du reste ») qu’on trouve au mitan d’un livre écrit en vers libres souvent s’allongeant en versets. Leur prose, plus qu’une rupture, introduit une respiration prosodique qui insuffle de nouvelles dimensions au propos.
L’essai sur Pasolini agit comme un moyeu qui confère à la pensée son centre de gravité (« tout se tient »), en même temps qu’il en favorise la « dialectique » (l’hyperdialectique aurait dit Merleau-Ponty) sans cesse relancée. Stéphane Bouquet distingue « deux grands mouvements » dans la poésie de PPP [Pier Paolo Pasolini] : celui d’une autre enfance « nichée comme un oiseau dans l’âge adulte » et, inévitablement lui succcédant, celui du deuil qu’il faut porter de ce pays d’enfance (Les Cendres de Gramsci étant le recueil qui inaugure ce second mouvement, marqué par le recours à de nouveaux rythmes). Ces deux moments, on l’aura deviné, sont aussi ceux qui traversent la poésie de Stéphane Bouquet : le moment de l’enfance, qui est celui de l’utopie vivante, mais qu’il faut quitter pour « accepter la saleté des choses, les cendres pulvérulentes et noires, les plaintes poussiéreuses de l’excavatrice. Il faut, tant pis ou mieux, accueillir l’odeur de sueur ouvrière du présent non consolé ».
Le conte quant à lui introduit une note discrètement autobiographique. L’enfant qui en est le protagoniste « s’auto-appelle » « Enfant du 31 octobre ». Or, comme nous l’apprend sa fiche Wikipédia, Stéphane Bouquet est né un 31 octobre. Tout conte, sans doute, procède d’un jeu contradictoire où, dans le cœur de l’enfant « seul avec sa chanson », s’entremêlent affects d’effroi, sentiment de solitude et infini besoin de consolation ; où l’aspiration à quelque chose de « trop beau » combat « quelque chose tout recroquevillé de tristesse ». C’est tout cela que raconte en 7 épisodes (7 jeudis) ce conte des plus émouvant, où l’auteur, avec une infinie pudeur, nous fait part sotto voce de ce que fut sans doute son propre « état d’enfance ». Non pas donc par le biais de quelques « biographèmes » sciemment choisis et ciselés, mais par le détour d’un récit où s’invente, sans jamais singer comme trop souvent on le fait un supposé parler enfantin, une langue d’enfant qui sonne avec une parfaite justesse, loin de toute mièvrerie et de tout auto-attendrissement.
« Etat adamique » de la langue est-on alors tenté de dire ; celui où semble s’atteindre, à la limite de la nomination, quelque chose comme cet « âge d’or » du sens dont parle Jean-Christophe Bailly. Mais l’expression devrait alors être étendue au livre tout entier, tant l’invention lexicale aussi bien que syntaxique, qu’il s’agisse de vers ou de prose, est constante dans ce Tout se tient.