Guillaume Artous-Bouvet-Orphant par Jean-Nicolas Clamanges
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
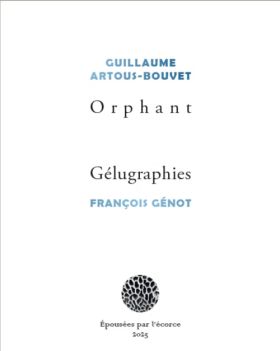
« Le mot d’orphanté (ou orfanté) désignait dans l’ancienne langue l’état d’orphelin. Orphant est ainsi l’enfant qui n’est plus enfant. » C’est ce qu’écrit l’auteur sur le site de l’éditeur. En revanche, le substantif « orphant » n’est nulle part attesté : il s’agit d’un de ces néologismes qu’Artous-Bouvet se plaît à créer pour son propos. En contexte poétique, il est impossible au lecteur de ne pas songer – il ne s’en faut que d’une syllabe –, à la figure d’Orphée, déjà travaillée dans Monologues de la forme (La rumeur libre, 2020).
En ce qui concerne le présent livre, d’autres vocables font résonner ce qu’on pourrait nommer les harmoniques du titre. Ainsi d’« infanté », p. 8 (tercet 3)-9 (tercet 1) :
Abrogeante âpreté
de ciel même :
infanté.
Infanté ce que lèvres
et que lèv
-res foulèrent.
Il ne semble pas que le verbe « infanter » soit attesté en français. Il faudrait remonter au latin infantare signifiant nourrir comme un enfant. L’auteur a voulu en outre que ce 3e tercet de la triade inaugurant le livre clôture celui-ci (avant une sorte de centon récapitulatif en prose d’une sélection de séquences prélevées dans les tercets, où l’on lit dès la première ligne : « N’elle infante lumière, à la lèvre », et à la dernière : « N’œuvre au feu, que le feu d’orphant& »). La récurrence du rapport instauré par le poème entre ce verbe, le mot « lèvre(s) » et la référence céleste/lumineuse suggère peut-être quelque chose de l’expérience première de respirer, bien avant ce qui s’ensuit dans l’allaitement. Une expérience qui peut être dans certains cas mortelle, et qu’on peut en tout cas supposer douloureuse, ou retrouver douloureuse dans l’anamnèse qu’en conduirait le poème, s’ouvrant et se clôturant sur cette « âpreté » de naître d’emblée « orphant& ».
Voici maintenant une autre harmonique du titre, il s’agit du verbe « faonne », aux p. 25-26 :
Faonne, faïencé, l’atterrant.
Œuve,
humus.
Faon de mer, et de sel.
Lécherie là
de bleu.
Dans le contexte du poème, le substantif « œuve » fait forcément résonner celui d’« œuvre » dans l’esprit du lecteur, qui peut d’ailleurs, comme ce fut d’abord mon cas, avant de procéder à une relecture à voix haute de l’ensemble, lire « œuvre » au lieu d’« œuve ». Ce qu’a très probablement souhaité l’auteur, jouant ici sur la possibilité d’une syllepse. Si « faonner », écrit Littré, « se dit des biches, des chevrettes ou femelles de chevreuils, qui mettent bas leur faon », et dénote donc l’accouchement d’un enfant, soit selon Artous-Bouvet dans sa présentation, du commencement d’une « enfance qui n’en finit pas de finir », et si mettre bas, c’est mettre à terre le faon nouveau-né, sur l’humus forestier en ce qui concerne la biche, c’est aussi, par syllepse, l’« atterrer » au sens de sa déréliction annoncée en tant qu’« orfanté », tandis que le jeu sur « œuvre/œuve » en suggère tout autant pour ce qui concerne le devenir problématique d’une création à tous risques – c’est ce que dit explicitement la présentation du poème – dans la langue dite « maternelle ». Ajoutons que « faïencé, selon Littré, « se dit de toute peinture qui est couverte de petites fentes ou gerçures » et pourquoi pas, on verra pourquoi plus bas : blessures à jour.
Le mot faon (prononcé *fan, comme dans « enfant ») revient cette fois féminisé au participe passé, et toujours en compagnie du verbe bleuter dans l’ultime séquence récapitulative, p. 46 : « Oise, que, faonnée : bleute nue. » « Orphant » s’y dissémine ensuite dans « rage ocrée furiant », Ce qui s’annonce peut-être en amont avec « où qu’orpaille ardemment » (p. 16); puis on rencontre « terrière n’ocrant qu’un ajour », ce qui désigne rétrospectivement au lecteur le mot « ocre » ou ses dérivés plusieurs fois rencontré dans les tercets, ainsi p. 19 :
Or, acer
-be dans l’ocre, quarteron.
Ocrant, qu’immémoré.
et p. 38 :
N’arpente nu l’ocreu
-se frondaison de la terre sans terre
atterrant
le seul sol.
N’ocre quoi, vers le seul.
Ainsi chemin faisant passons-nous du bleu à l’ocre, sinon à l’or qui résonne aussi dans « sororant », p. 29. Plus loin, l’alchimie du poème vire au rouge p. 39, où l’on lit « Ore sang » :
Rouge en rouge rougeoie
l’ajourée.
Ore, exsang
-gue soit chair asservie de sang
comme sang soit,
ainsi.
Avec au tercet suivant un effet de paragramme : *orfang
Ore sang,
ore soif,
où feuillole le sang.
Il semble qu’en ces parages le poème remonte au travail antérieur à ce qui précède l’infantement – travail d’enfantement au sens de l’accouchement maternel, ici clairement représenté comme une quasi boucherie peut-être mortelle. J’avais d’ailleurs remarqué en travaillant auparavant sur la rythmique, que cette page et quelques autres attestaient une crise rendant difficile au lecteur la mesure d’une régularité. La couleur du sang est ici la dominante dans les vocables, mais le mot « rouge » s’écoute également quasi anagrammatisé dans « ajourée », de façon évidemment délibérée puisque les vers 1-2 du premier tercet de la p. 39 sont formellement liés par le dispositif général du poème au dernier vers du dernier tercet de la page précédente : « un ajour seulement de lumière », laquelle définie aux vers précédents comme « lumiè/-re, lavée/par la lumière même ». Selon Littré, « ajouré » est un terme de blason : « Il se dit de pièces percées à jour » ; il s’agit d’ouvertures laissant passer la lumière.
Les connotations du terme en littérature sont en général plutôt euphorisées sinon esthétisées. Dans la page d’Orphant en revanche, la lumière d’aube évoquée p. 38 a pris une teinte mortellement crépusculaire. Dans l’ancienne langue « ore » signifiait « présentement » ; c’est ici d’un corps devenant exsangue qu’il est question en une sorte de présent de narration. En langue, le verbe feuilloler signifie pour un arbre commencer à se garnir de feuilles, il renvoie donc au vere novo, au printemps nouveau, à la renaissance de la verdure tant chantée par les troubadours à l’époque de Dante, comme saison de l’amour et du chant d’amour, ainsi que par Apollinaire : « Le printemps laisse errer les fiancés parjures // Et laisse feuilloler longtemps les plumes bleues ».
Mais quant à Orphant, il naît sanglant d’un corps exsangue. Ainsi n’en finit-il pas de finir avant d’avoir commencé. Dans la page consacrée à Orphée dans Monologue de la forme, on lit tout à la fin ceci : « chant de spectre silice, incommencé ».