Audre Lorde-Une merveilleuse arithmétique de la distance par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
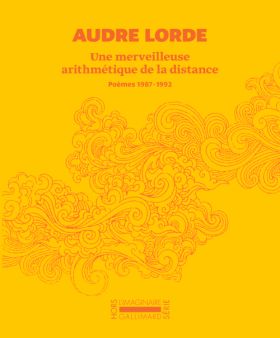
Au début du XXe siècle, des femmes que leur statut social protégeait n’ont pas hésité à écrire à propos de leur homosexualité ; on pense toujours à Renée Vivien et à Nathalie Clifford Barney et il faut relire aussi Lucie Delarue-Mardrus, se souvenir de l’exaltation du corps chez Joyce Mansour, etc. Le militantisme LGBT aux États-Unis, le "mariage pour tous" (2013 en France), le mouvement #MeToo, entre autres, ont favorisé depuis une vingtaine d’années la publication d’une poésie longtemps ignorée. L’œuvre poétique d’Audre Lorde (1934-1992 ; elle avait ôté l’y de son prénom) a commencé à être traduite tardivement en français (La Licorne noire, 2021), d’autres publications ont suivi grâce aux traductions du collectif Cételle (Charbon et Contrechant, 2023). Aujourd’hui, la collection de poche L’Imaginaire, dans un format et une présentation inhabituels, propose un ensemble posthume (1993) de poèmes ; quatre brèves préfaces d’Alice Diop, Fatou S., Kiyémis et Mélissa Lavaux rappellent l’importance d’Audre Lorde aux États-Unis : auteure noire, féministe lesbienne, elle fut jusqu’à sa disparition militante des droits civiques et de la liberté des femmes.
Les traductrices précisent dans une note, qu’elles ont choisi pour se « rapprocher le plus possible du propos d’Audre Lorde », de s’appuyer « ponctuellement sur des stratégies de démasculinisation de la langue française ».
Le titre porte une leçon ; il faut toujours aller de l’avant, partir au moins métaphoriquement, « Pas de place pour régler les comptes / sauf dans une merveilleuse arithmétique de la distance ». Aller de l’avant implique de s’opposer à ce qui est, opprime, empêche d’être soi, nie jusqu’à l’existence : Audre Lorde dénonce le racisme ordinaire qui tue, par exemple en 1984 une femme noire pauvre, Eleanor Bumpurs, refusant son expulsion : la porte de son logement enfoncée, elle est abattue par un policier. Le refus de l’autre parce que noir est chose commune partout, jusqu’à instaurer l’apartheid, comme en Afrique du Sud, où l’on tuait quotidiennement à Soweto. Le racisme ne disparaît pas aisément, toujours présent des deux côtés de l’Atlantique.
Audre Lorde prend l’exemple de son père, né de père inconnu, qui a travaillé toute sa vie pour que ses filles ne connaissent pas le même sort que lui ; il achetait de « vieux livres », rapporte-t-elle, « pour mon univers sans langage », et elle est devenue bibliothécaire. Que pouvait faire son père ? « Noir et sans le sou / sur cette terre où seuls les hommes blancs / règnent par l’argent. » Comment ne pas désespérer de la persistance de la ségrégation ? Audre Lorde, d’abord surprise du visage haineux de sa nouvelle voisine blanche, entend l’enfant qui l’accompagne, « Je ne t’aime pas, braille-t-il, / Tu viens pour me garder ? ».
La vie quotidienne dans une ville américaine des années 1980 était difficile pour l’ensemble des ouvriers, la crise économique de 1975 avait laissé des traces, mais elle l’était encore plus pour la population noire plus vite atteinte par le chômage, « la misère me hurle / dans les rues voisines », écrit-elle, aggravée par les ravages de la drogue et ceux de la prostitution qui conduit des femmes « du trottoir au néant ». La situation est d’autant plus mal vécue par la communauté noire que les "Blancs" ne représentent sur terre qu’une minorité, ce que souligne avec humour Audre Lorde :
La plupart des habitants de cette planète
sont (…) Asiates, Noires, Brunes, Pauvres, Femmes, non Chrétiennes
et ne parlent pas anglais.
Vers qui se tourner pour continuer à se tenir debout ? D’abord vers les femmes qui n’ont pas renoncé à changer leur vie, celle de leur famille. Audre Lorde s’est nourrie des paroles de sa mère, modèle comparable à « une eau libérée », qui l’ont incitée à toujours se battre. Elle évoque aussi un militant noir des droits civiques, Marcus Garvey 1887-1940) qui, à l’origine de la culture rasta, avait une position radicale : il prônait le retour des anciens esclaves en Afrique.
Mais elle exalte surtout dans ses poèmes de la ville le rôle des sens, attentive au timbre de la voix, aux regards, aux odeurs ; elle n’oublie jamais l’importance des rêves et des désirs : elle écrit ce qu’était l’amie disparue avec qui elle passait parfois la nuit à lire des poèmes — « Je n’arrive pas à croire que tu sois sortie / de ma vie. / Alors tu ne l’es pas. » Elle-même succombera à une récidive d’un cancer du sein, active jusqu’aux derniers jours (« comme il est dur de dormir / au milieu de la vie ») et toujours exemple de militante pour la liberté complète des femmes : libres socialement et libres de leur corps.