Laura Tirandaz-J’étais dans la foule par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
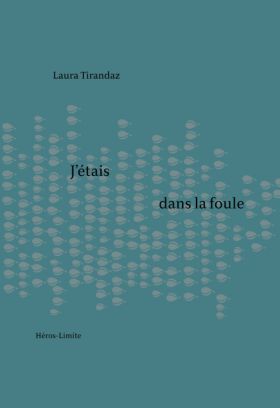
Être dans la foule — « J’étais dans la foule » revient trois fois dans le livre — c’est à la fois être au plus près des "autres" et, en même temps, vivre la solitude, « Solitude aiguisée de qui passe à portée de main ». La narratrice se trouve dans ce lieu provisoire par nature, qui apparaît à la fois « Dédale piège refuge » ; La foule réunit ici des hommes et des femmes qui semblent manifester contre un pouvoir violent ; la narratrice rapporte : « Je passe / un homme glisse une insulte, insulte répétée plus avant, et la mort est présente, « on continue on continue / on s’est mis à ramper / à jeter des poignées de sable pour cacher le sang ». Images de répression collective qui s’exaspèrent quand les femmes sont objet de violence :
Je marchais et me souvenais
des femmes traînées par les cheveux jusqu’au cœur de la ville
l’été écrasé sous les bottes
Le pouvoir tue pour terroriser, choisissant ses victimes, « ce matin deux exécutions », et presque aussitôt « ce matin — une exécution », et les notations ne laissent aucun doute sur la volonté de faire taire toute opposition (« le sang ouvrier », « Quelqu’un à qui on a enlevé la peau et les verbes », etc.). Une des plus tragiques restitutions de la violence mêle les gestes quotidiens à ceux d’une exécution, dont la banalité est ainsi mise en valeur : « Ce que je me suis forcée à finir / la phrase / l’assiette / et sa tombe — je devrais y aller / Il a tourné le dos face au mur ». Cependant, « Plus il y a d’ennemis / plus il y a d’amis » et, dans l’avant-dernier poème, « J’attends la foule / Derrière le paravent / les ombres respirent toujours la même fleur ».
Les citations précédentes pourraient laisser croire que le long poème qu’est J’étais dans la foule est un récit concernant ce qui se passe en Iran, le nom de l’auteure étant transparent ; elles sont relevées et rassemblées parce qu’il y a bien une visée politique dans ces poèmes que l’on met en exergue. Mais autre chose, qui déborde la terrible actualité. Et d’abord une perception de la foule en même temps restituée et devenant objet d’imagination : « (…) Des phrases, des coups de rame / Les corps glissent / Les visages se superposent / Il pleut » ; on lira plusieurs fois ce genre de passage où le réel semble, mais semble seulement, mis à distance et perçu alors avec plus de force. Le dernier vers du poème s’achève d’ailleurs sur une de ces notations qui introduisent un effet de réel, « Des mouches sur mon rouge à lèvres ».
Écrire ce qu’est la foule n’implique pas une description comme on peut en lire chez Zola ou Hugo (la foule comme une mer, une marée). La narratrice regarde et le texte se divise, les éléments vus tous différents, juxtaposés, sans que le chaos du monde soit organisé : tout le contraire d’une description, ce qui donne au lecteur le sentiment d’être aussi devant un désordre impossible à réduire. D’autres séries sont limitées à une suite de mots et tout se mêle, choses vues, bruits, textes lus, toujours pour donner du réel une perception différente : « Les insectes les rumeurs les alarmes / les comptines où l’animal trouve refuge ». La foule est aussi un lieu sonore, dans l’immense confusion des bruits se détache parfois brusquement, la nuit, une voix qui dit, pense-t-on, sa souffrance, « Une femme criait / Qu’on m’emporte / Qu’on m’emporte ». Quand la narratrice écoute une personne, ici un adolescent, dont les mots sont tout autant inorganisés que les paroles saisies dans la foule, « (il) te parle des nuits d’alcool en famille / du silence dans la cuisine / de l’épaisseur de l’air et du velours des voix âpres, rares », ce qui est plus réel qu’une restitution d’une prétendue oralité.
La narratrice n’est pas seule, sans que les personnages introduits soient mieux définis qu’elle. La double injonction qui ouvre le livre — « Abandonne la route », puis « Reviens vite » — peut s’adresser à un lecteur imaginé comme au "vous" de ce début ou au "tu" qui entre dans l’histoire à différents moments ; d’autres pronoms apparaissent, un « nous » et un « ils », qui peuvent renvoyer à des figures diverses : il y a assez régulièrement dans J’étais dans la foule des traces d’un ailleurs, d’un dehors qu’on peut bien appeler le réel. Le seul pronom récurrent, "tu" ("te") joue avec le "je", mais il n’est pas certain, et le lecteur ne le saura pas avec certitude (heureusement !), que le couple formé par le je-tu soit toujours le même. Il y a l’idée d’une fusion totale, mais qui ne peut être qu’imaginée, « qui envahissait le rêve de l’autre ? / Nous avons la même insomnie / la même honte ». Il est fait état une brève conversation entre je et tu et, plus longuement, de la fin d’une relation, mais avec un passage brutal de je à elle : le poème commence par « j’écrirai un jour le récit d’un amour qui s’achève » et se poursuit par « (…) Elle lui tient la main, penche la tête / Lentement elle le massacre ».
On voudrait relever tous les entrelacs d’un poème qui, rappelant régulièrement le contexte, des moments de vie en Iran aujourd’hui, s’échappe des circonstances et, constamment, offre une lecture passionnée du réel, en refusant de présenter une image ordonnée de la violence, du chaos où chacun, qu’il le veuille ou non, vit sa vie, même éloigné des tueries contemporaines ou de la crainte de « tomber dans le vide » — ce sont les derniers mots de ce très beau poème.