Christophe Hanna-Sociographies par Nathalie Quintane
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
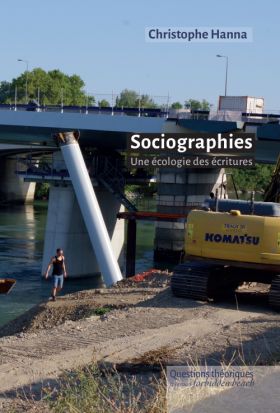
Je reviens sur la performance d’Esther Ferrer le 4 octobre au CIPM : elle consiste à tirer au sort, dans une corbeille, l’une après l’autre, des questions assez typiques de ce qu’on lui demande habituellement ou simplement des questions qu’elle se pose, elle, sur la vie, l’art, le féminisme, la situation politique, etc. Dès qu’elle nous a lu la question, elle se lance à fond dans une réponse semi-improvisée, coupée net au bout d’une minute (et donc souvent en plein milieu d’une phrase) par Michaël Battala, le directeur du Centre International de Poésie Marseille, qui a mis en ligne un chronomètre sur son téléphone : STOP ! énonce-t-il bien fermement, suivant à la lettre le protocole indiqué par Ferrer avant de commencer. Oooooh ! entend-on parfois dans le public (car nous aurions bien aimé connaître la fin de la phrase). À la question : que pensez-vous de l’enregistrement de vos performances ? Esther Ferrer répond qu’elle préfère les photos, même si elle n’a jamais interdit d’être filmée : la vidéo, dit-elle, fait croire à celui ou celle qui la regarde qu’iel assiste à la performance ; elle invisibilise le fait que le public de la performance fait partie de la performance, étant constitué par elle.
Je pense que c’est à peu près ce qu’entend Christophe Hanna par « sociographie », et celle-ci était particulièrement réussie :
— elle constitue un public ad hoc, un public qui devient, le temps de l’action, « un paramètre poétique » à l’égal des autres paramètres en jeu.
— elle contraint l’institution (ici représentée par son directeur) à révéler, ou du moins à rappeler, son existence et ses modalités de fonctionnement (tu ne peux pas faire, dans ce cadre, une performance qui durerait la journée, par exemple ; c’est moi qui décide d’un certain nombre de choses ; je limite, voire j’interdis).
— elle nous sort d’une certaine routine (l’écoute respectueuse d’une lecture de poésie)
— elle nous révèle nos attentes, nos réactions ordinaires (nous supportons mal la frustration ; pour nous, et même si nous sommes a priori un public qui lit de la poésie, familier des « coupes », une phrase a un début, un milieu et une fin et elle ne doit pas s’arrêter arbitrairement n’importe où)
— ainsi elle nous teste, d’une certaine manière, en pratiquant ce «
jeu social perturbateur et désaliénant »
— car l’essentiel est bien la visée émancipatrice et critique de cette performance, et Ferrer y insiste à plusieurs reprises : oui, nous sommes dans un moment fasciste et la seule chose que nous ayons à faire, c’est de résister ; oui, le féminisme est forcément un anarchisme, puisqu’il consiste à se battre contre le patriarcat, qui est une domination, etc.
— enfin, Ferrer a conçu cette performance et elle la fait fonctionner avec nous et avec l’institution invitante, annulant les séparations, les rôles assignés.
À la question fatale, celle qu’on lui pose régulièrement : vous considérez-vous comme un(e) poète ? Ferrer répond clairement : Non, je n’ai pas cette prétention, je suis une performeuse…
C’est aussi là que la lecture des Sociographies est précieuse. Bien sûr qu’elle ne nous a pas lu un poème — pourtant elle était invitée par le CIPM et elle y était parfaitement à sa place, sans doute bien plus que sur une scène de théâtre ou sur une place mal sonorisée où l’on n’aurait pu saisir ses saillies, son humour, sa finesse, sa sagesse aussi. Elle était tout près de nous, avec nous.
Sans doute, rien de nos habitudes ou de notre savoir-faire dans l’analyse des textes ne nous ont servi pour comprendre cette performance, pour la vivre. Les étiquettes auxquelles nous nous référons (et c’est le cas de toute la chaîne-du-livre et des médias) : roman, théâtre, nouvelle, poésie, mais aussi art contemporain ou performance (une étiquette trop grande ici, où se rangent trop de choses différentes), auraient été déplacées — Christophe Hanna a une comparaison très drôle pour le dire : l’espace littéraire c’est comme « l’entrée d’une boite de nuit gardée par un vigile physionomiste ».
Il s’agit de rompre avec ces habitudes littéraires et artistiques que continuent à transmettre l’école et la plupart des institutions culturelles, non pour le plaisir de rompre ou pour se croire du bon côté du manche en « participant » et en étant brossés dans le sens du poil, mais pour sortir de la nécrose et accéder à une vie vivante, une vie politique.
Même si Hanna récuse le « choc » que cherchaient à provoquer les avant-gardes pour lui préférer le mot de « surprise », les sociographies, par leur prise en compte de la totalité de la vie, par leur but affirmé de transformation sociale, sont bien des héritières des avant-gardes historiques.
Ce que sous-entend ce livre terriblement stimulant, c’est que nous n’en sommes même pas au stade de la réforme : ces dispositifs pour voir dans les œuvres enfin autre chose que ce que l’on y voit « naturellement » sont des « réformes à visée critique, partielle, provisoire », dit-il, or nous sommes encore dans des lectures et des postures réactionnaires, nous y tenons et nous nous y tenons.
Il ne s’agit pas d’annuler la relation esthétique que nous avons aux œuvres (le plaisir que nous avons pris, que j’ai pris, pendant la performance d’Esther Ferrer, était en partie de cet ordre et c’est tant mieux, ça n’a fait que renforcer le reste), mais de ne plus en faire la seule approche, la seule garantie de qualité. L’analyse sociographique inclut forcément le travail d’un Guyotat, par exemple, celui de Genet (faut-il aujourd’hui le préciser quand la manière dont il a placé son œuvre devrait continuer à nous bouger le cul et celui de la bourgeoisie si cette même œuvre n’était pas neutralisée en partie par la lecture esthétisante qui domine), et Hanna a des pages éclairantes sur Tolstoï et sur Guerre et Paix. Les écrivain.e.s du passé peuvent être avec nous, nous pouvons les rejoindre, à condition que leurs livres ne soient pas écrasés par les « jubilatoires » et « savoureux » qui continuent à caractériser la majorité de notre pauvre production contemporaine. Français, encore un effort… Cependant, les exemples pris par Hanna sont essentiellement récents. D’ailleurs, comment comprendre Manuel Joseph ou Kati Molnar, Tarkos et Bessette, Lucia Etchart et Antoine Hummel (livre et performance) sans en passer aussi par une lecture sociographique ?