Khalid El Morabethi – Servir par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
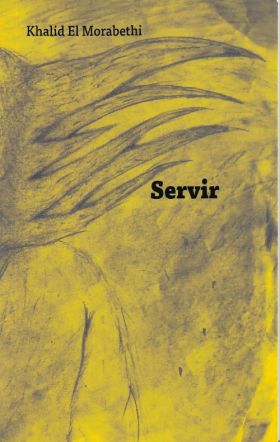
Il y a le sens militaire : servir sous une arme. Il y a les grands serviteurs de l’État. Il y a la restauration : premier, second service. Il y a la messe, que sert l’enfant de chœur, et le service au tennis. Intransitivement, il y a l’utilité (à quoi ça sert ?), et transitivement l’intérêt (qu’on sert). Et puis ailleurs, à côté, on ne sait où, il y a Khalid El Morabethi.
Le verbe, toujours à l’infinitif, est ici transitif. L’objet (le plat ?) qu’on sert est variable, le destinataire non. C’est servi à un cerveau (et non servo à un cervi). Celui-ci « ne comprend pas », « n’a toujours pas compris », « ne comprend toujours pas », est « perdu », « s’écarte », et sa crainte est partagée par celui qui lance un jeu, une blague, des balles qui retombent sans avoir été saisies. « Servir un âge où les autres riaient encore » à « un cerveau qui essaie de me prendre au sérieux », c’est s’inventer « des guerres innocentes ». Mais « on m’a obligé à porter des fardeaux. Pas des jeux, mais des boîtes lourdes ». Ainsi, « je devais me sacrifier pour sauver le monde, avant qu’il ne soit trop tard. C’était au nom du bien, un entraînement pour me rendre fort ». Le semeur de papillons, celui qui déroule les tapis où ils dormaient, n’avait « jamais de réponses », et répondait « par des anecdotes ». Depuis, il « porte (ses) papiers d’innocence comme des accusations ».
Il a toujours « neuf ans, trois fois par jour », et n’arrive « même pas à parler correctement à la manière d’un toxique professionnel ». On lui reproche d’avoir « reçu trop d’amour » qu’il ne méritait pas. Il plaide : « Je suis contre mon âge, il n’y a pas eu d’accord, je n’étais pas présent, je n’ai rien signé, c’était une farce ». Rimbaud n’a-t-il pas écrit qu’elle était « à mener par tous » ? Khalid : « je suis prêt à offrir des fleurs, juste pour que ma face trouve son miroir, juste pour que la farce ose enfin me croire ».
Comment faire « barrage aux questions fermées », que ce soit à l’école où j’allais « pour mourir et non pour m’en sortir » ou au téléphone, en proie aux « appels commerciaux » ? Toujours « les lunes sont des cafés empoisonnés », les soleils « veulent que je meure ». L’enfer est peuplé de « chiens-guides ». Pas « le temps de (se) reposer ». Servir des photos d’oignons comme un « projet d’art », écrire ? « Au nom de leurs jugements, c’est une insulte, un péché ». Les jugements sont « des certificats médicaux, des ordonnances, des chasseurs d’âmes ». L’humour est dangereux. Autocensure ? « À chaque fois que je gagne une bêtise, les coulisses prennent mon stylo et le crucifient (…). Les pages déchirées servent à nettoyer les toilettes ».
Serait-ce comme l’amour selon Lacan : servir ce qu’on n’a pas à un cerveau qui ne le demande pas ? Mais rien à faire, « ma langue sent les ailes » comme une démangeaison, une envie de « courir verticalement ». « Les plumes sortant de mon dos m’empêchent de marcher correctement. Quand je suis seul, je gratte ». Rien à faire, « les papillons se réfugient dans ma gorge comme un orchestre miniature », et « je ne peux pas écraser un concert ». Comment faire comprendre que « s’éloigner de la réalité n’est pas une échappatoire » ?
Une « incapacité de colorier en rouge dans les lignes », une violence, dépasse « les limites », fait « des crises », se « déguise en monstre ». Les phrases « frappent le ventre » avant d’être « pondues par la bouche » et d’ « aller (se) faire voir ». Car « je veux que la violence s’habille en robe, qu’elle se maquille ». Mais « comment expliquer parfaitement alors que mes idées sont perturbées par la façon dont je les écris ? » Tant pis, « j’ai la chance de commettre des erreurs » et peux toujours « remplacer l’erreur par une peinture ». Tant pis « si je tombe, je vole ». Puisque « l’existence est une plume » et que « j’aime flotter ». « Si je tombe, je vis ». Vivre, c’est voler. « La gravité est un crachat ».
Si « les sectes n’ont pas réussi à m’inviter », ce n’est pas étonnant, « je ne veux pas être sauvé ». « Je suis un intrus », ai « toujours été hors cible qualifié par erreur », et « ma zone de confort est une zone de guerre » (plus loin : « de polochons entre moi et les sorcières »), où « je ne suis pas intéressé par la certitude, et je ne cherche aucun repère ». On peut « rassurer le miroir, je suis une reine ». Il suffit « d’être une princesse pour voir la guerre en couleur » et apporter « la paix à l’abattoir » où personne ne lit « pour comprendre, mais uniquement pour passer un examen oral ». Où « les idées sont des chemises posées sur une machine à café » À quoi bon « servir des blagues mal écrites à un cerveau qui ne comprend pas que, parfois, j’écoute des news japonaises pour écrire des textes » ? Tant pis, « j’aime les malentendus comme les éclats à deux balles d’une scène pathétique, et il faut préciser qu’il en faut trois pour forcer le rire dans une scène tragique », où les métaphores sont utilisées comme « des rouges à lèvres ». Tant pis pour ceux qui veulent « que ce soit compréhensible », que c’est une « nécessité », une « mission à accomplir rapidement », et qu’il faut « accepter », qu’il faut « être convaincu ». Tant pis enroulé sur des papillons. Tant pis volant.
La reine dans le miroir veut « être seulement témoin devant un juge en peine. Accepter la réconciliation ». Madame est servie.