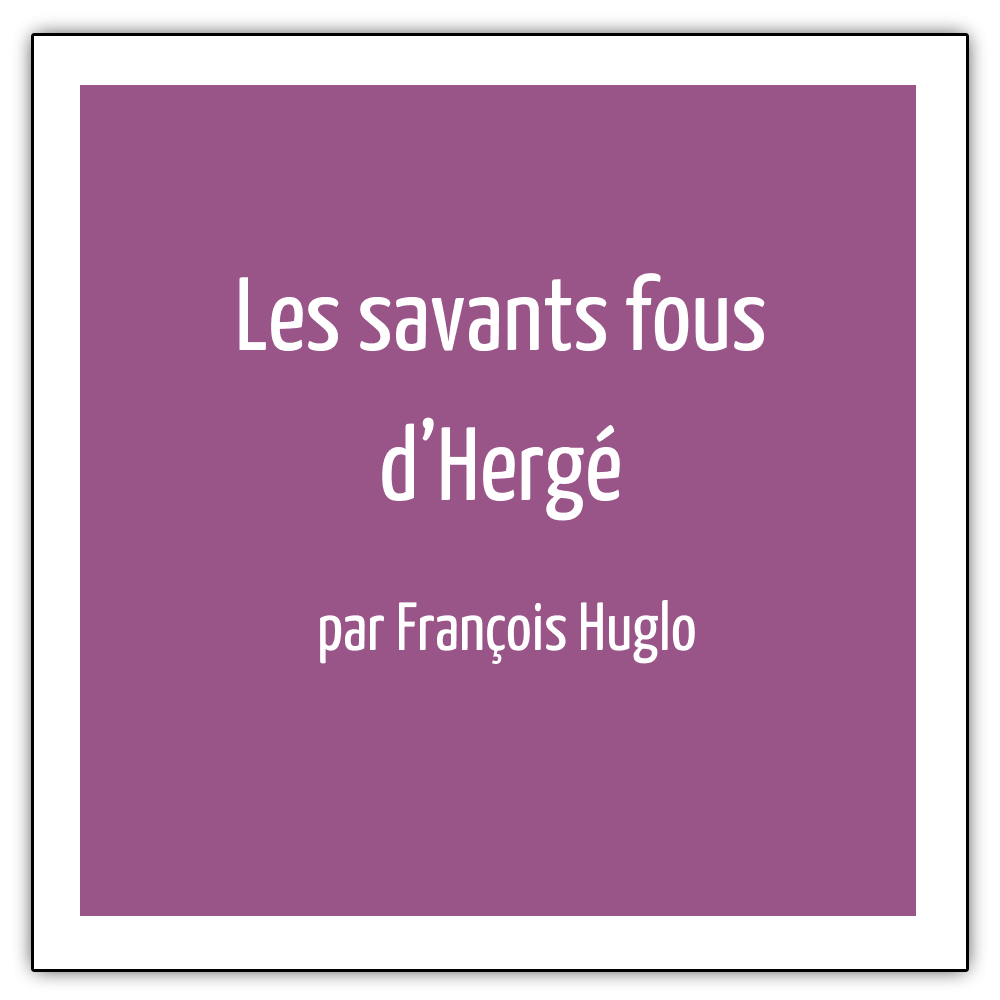Les savants fous d’Hergé par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Depuis Rabelais, « science sans conscience n’est que ruine de l’âme », des sciences diverses ont exploré l’inconscient et l’inconscience. Les dix-neuvième et vingtième siècles ont multiplié les figures du savant fou, malfaisant, ou dénué de conscience morale, de Frankenstein (1818) au Cabinet du docteur Caligari (1920, des Robots d’Asimov (1950) à Docteur Folamour (1964). Hergé, du « Petit vingtième », aussi. Avant lui, le Little Nemo de Windsor Mac Cay (1905-1914) nous plongeait dans le « pays du rêve » (Slumberland), en remontait comme d’une Licorne coulée des trésors d’images dignes du « pays des merveilles » d’Alice. Science et fiction mêlées ont fait du savant un aventurier, et en 1951 Raymond Queneau, Boris Vian, et quelques autres passionnés de science- fiction ont fondé le Club des Savanturiers. Le docteur Jonathan Septimus d’Edgar P. Jacobs (La marque jaune, 1956) pourrait entrer dans cette catégorie. Le Tournesol de son ami et collaborateur Hergé aussi, mais il faut d’abord citer son principal modèle, le professeur Auguste Piccard, et son fils Jacques.
Auguste Piccard, physicien passionné par la stratosphère, a certainement inspiré Tournesol, qui lui ressemble beaucoup, ainsi que l’ingénieur Legrand, père de Jo et Zette. Mais avant la fusée lunaire, Tryphon a conçu et construit un sous-marin en forme de requin, pratique et inoffensif (le sourire des dents de la mer), qui marquait son apparition dans Le trésor de Rackham le rouge. Ce premier Tournesol est plus proche de Jacques Piccard, surnommé Capitaine Nemo, qui avait aidé son père Auguste à construire au milieu des années 50 un bathyscaphe dont la marine américaine achèterait le prototype. En 1960, il devenait « l’homme le plus profond » en plongeant à près de 11000 mètres de profondeur à bord de ce mini sous-marin. Et en 1964, il fabriquait le premier sous-marin de poche touristique.
Le capitaine Nemo de Jules Verne (Vingt mille lieues sous les mers, L’île mystérieuse) a renoncé à la société des hommes, comme le font momentanément le chercheur dans son laboratoire ou le créateur, tel Proust dans sa chambre de liège. Son nom est celui que l’artificieux Ulysse a déclaré pour échapper au cyclope. Le savant à barbe et lunettes noires qui, dans Le Manitoba ne répond plus, capture Jo et Zette dans son laboratoire sous-marin, tient à la fois de Nemo, de Frankenstein (« le Prométhée moderne » selon son autrice Marie Shelley), et du chef des guerres robotiques d’Asimov, devenues réelles et même banales (les drones pleuvent), se présente comme le « génial inventeur » du robot. « Dans mon pays, on s’est moqué de moi et de mes recherches : on a dit que j’étais fou !... J’ai dû fuir, mais j’ai juré de me venger !... ». Il construira « une armée de robots » qui feront de lui « le maître du monde !... ». Mais pour que le premier d’entre eux puisse « penser et agir seul », il doit lui transférer l’intelligence de Jo par un appareillage aussi effrayant que les premiers électro-chocs. Dans Coke en stock, c’est Rastapopoulos qui s’échappe en dissimulant un mini sous-marin dans un canot automobile.
Hergé reste fidèle à Windsor Mac Cay : ses « savanturiers » explorent d’abord le « pays du rêve », les pays de l’ivresse (Haddock, Milou, Tintin dans Le crabe aux pinces d’or) et de la folie (Philémon Siclone dans Les cigares du pharaon, Didi dans Le lotus bleu et les autres victimes du « poison qui rend fou »). Tintin lui-même simulera la folie dans Le lotus bleu, et Tournesol en sera momentanément frappé dans Objectif lune, comme le « fou » geôlier de Jo et Zette l’avait été par un coup sur la tête. La surdité intermittente de Tryphon « juste un peu dur d’oreille » ne figure-t-elle pas le monde sous-marin ou stratosphérique dans lequel le transportent ses travaux, le temps de leur durée, loin de la société des hommes ? « Je n’y suis pour personne », pourrait dire Nemo. Concentration et retrait nécessaires : le professeur Fan Se-Yang, « savant aliéniste », trouvera l’antidote au poison qui rend fou, et Tournesol, dans Tintin et les Picaros, l’antidote à l’alcoolisme. C’est le côté lumineux de la science qui l’emporte, sans triomphalisme : avec Hergé, Michel Serres se moque de l’extension de « moyens de communication » qui, dans Les bijoux de la Castafiore, rendent celle-ci impossible. Le « côté obscur », ce n’est pas Tournesol mais le maréchal Plekszy-Gladz qui, en le faisant enlever, veut détourner ses recherches vers la production d’une arme qui lui donnera « la maîtrise absolue du monde » (L’affaire Tournesol). Ce n’est pas Hippolyte Calys dans L’étoile mystérieuse, mais ceux qui convoitent l’aérolithe et organisent une expédition concurrente. Dans Le sceptre d’Ottokar, ce n’est pas le professeur Halambique mais Müsstler, au patronyme doublement transparent, qui utilise son frère jumeau pour s’emparer du sceptre du roi de Syldavie , avec la complicité de son aide-de-camp, Jorgen, que l’on retrouvera dans On a marché sur la lune, s’emparant cette fois de la fusée. Au-delà de sa construction dans Objectif lune, les pirates qui l’espionnaient visaient celle d’une pile atomique et la transformation de l’uranium. Qui prétendra encore que les albums d’Hergé sont surannés ?
Outre le professeur Piccard, Jacques Bergier est parfois cité parmi les modèles possibles de Tournesol, qui lui ressemble beaucoup moins mais pratique la radiesthésie, art divinatoire qui relève de la croyance plus que de l’esprit scientifique. Bergier apparaît sous les traits du « célèbre Ezdanitoff de la revue "Comète" » (allusion évidente à « Planète »), c’est ainsi que Tintin le présente dans Vol 714 pour Sydney, encore une histoire de pirates (Rackham le rouge pas mort !), de détournement. Il se dit « initié » par les extra-terrestres, et pratique la suggestion par hypnose, à l’aide d’un « transmetteur de pensée » dont les ondes rappellent celles que produisait le savant pirate du « Manitoba » pour balayer ses adversaires. Lui-même ne se voulait-il pas un « transmetteur » de la « pensée » de Jo à un robot ? Piccard et Tournesol pouvaient s’en douter, soucoupes volantes et monstres sous-marins communiquent. Dans les rêves de Tournesol comme dans ceux de Haddock ou de Milou —ou dans les nôtres—, rivalisent sans doute les plaidoiries d’un ange et d’un diable qui lui ressemblent autant l’un que l’autre. S’ensuivra (ou non) la ruine de l’âme.