Juice Casaganthe de Fanny Quément par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
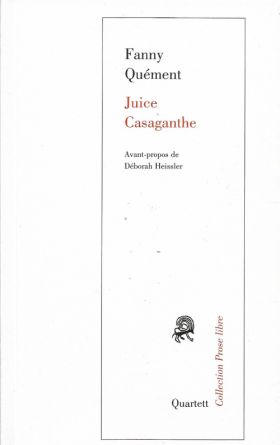
La bastille linguistique reste à prendre ! Et Hernani c’est pas fini ! Quand, en avant-propos de Juice Casaganthe, Déborah Heissler écrit que Fanny Quément « fait du texte un palimpseste vivant », que « la langue elle-même devient un personnage vivant », on pense à Hugo : « Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant ». L’attitude « résolument iconoclaste » de Fanny rappelle le « monstre (…) dévastateur du vieil ABCD ». Il mettait « un bonnet rouge au vieux dictionnaire », elle fait du texte un « champ de bataille linguistique où la subversion des normes est une forme de résistance créative ». Les temps ont changé. Les « garces erratiques » mobilisées par Fanny et sa Juice n’ont rien du Cénacle romantique. Elles ressemblent plutôt à la « petite bande » des jeunes filles en fleurs, mais qui auraient lu Paul Lafargue. La rive « pas dégueu » les incite à « faire la grève de tout, même un peu celle des mots », à offrir « à l’eau comme une gigantesque muqueuse » leur « territoire intérieur » qu’elles décrètent « extime », à se sacrer « reines des branleuses ».
Le texte de Fanny Quément ignore, lui aussi, les frontières entre son intérieur et son extérieur. Comme l’écrit Déborah Heissler, l’intertextualité « y joue un rôle central », les voix de D.H. Lawrence, d’Henri Michaux, et d’autres, se mêlant à celle de l’autrice « pour brouiller les frontières entre originalité et emprunts », et faire du texte un « collage », une « mosaïque de significations ». Que fait d’autre celui qui écrit ces lignes ? Les « fontanelles » des « garces en cavale » en bord de mer « ne se sont jamais refermées », ce qui « facilite la circulation de tout dans tout ». Juice expérimente « un devenir-bivalve tout en flamboyance ». Elle « fait des collages » car elle aime « tout ce qui colle, toutes les glus. Ça goûte l’interdit ».
Un à-peu-près donne à « la lutte des branleuses » une saveur rimbaldienne : elles pratiquent « l’art de rimbranler ». Juice « rimbranle à n’en plus finir ». Leur « grand programme de décroissance » passe par « l’incorrection qui vient » : la prise de la bastille orthographique, facilitée par « l’avancée des moisissures » dans « les sous-bois de papier ». Déjà, « les jambages en putréfaction exultent à l’idée de bientôt faire régner la confusion des n et des m, des f et des l, des i et des u, et ainsi de suite jusqu’à vraiment fondre l’e dans l’o ». Juice les aide à dévaster « le vieil ABCD », comme disait Hugo, en s’accrochant « à ses coquilles », en s’en faisant « des colliers de perles », tout un « thésaur ». L’erreur devient trouvaille, le lapsus invention : « flicaille autoporclamée », « sauce bibiche », « tue-l’amouche », « tomber en déserrance », « langue à pétrole », « chancrer juste », « faire des mots cramés », vider un « panaris fiscal », partir en « croisière au pays des merdeilles », en compagnie de « Guy Déborde », « Doña Quichatte », « Louise Caroll », et bien sûr « James Juice ».
La langue est-elle fasciste ? Sommes-nous embastillés derrière une « herse d’adverbes », dans une « cage à subjonctifs imparfaits », menacés d’ « écartèlement syntaxique », de « flagellation par apodose et clausule », de « déterminants à impulsions électriques », promis à la « potence des subordonnées relatives » ? Les « traductrices », ces « traîtres », s’évadent : « treslater », c’est « traduire librement / d’une langue fantôme / à une langue hantée / ou inversement ». Ce sont des passe-murailles. Celles qui séparent l’originalité de l’emprunt sont franchies par le psittacisme. Juice Casaganthe se tient entre deux silences, « parlée au travers. Ventriloquée. Perroquetée ». Une « séance de psittacisme (ou ventriloquie) entre garces erratiques » semble faire écho à des répliques des Bijoux de la Castafiore page 55. Tintin : « Qu’est-ce qui va se passer ? » Tournesol et le médecin : « Quest-ce qui s’est passé ? » Le « perroquet dangereux » de Fanny Quément : « Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce que c’est que ça ? (…) Qu’est-ce qui se passe ? » Le perroquet, double de Bianca chez Hergé, « vraiment un cas clinique » chez Quément, est contagieux. Les « dossiers de la brigade des mœurs linguistiques » le dénoncent comme « polyglotte ». Donc de glu.
Mangeant « de la soupe aux lettres tant par économie que par superstition », mais refusant le « Travail Famine Pâte-Riz » de l’ordre « pâtriarcal », la « narratrice anarchiviste » marche « allègre détendue bruyante », peut-être pas loin de Jean-Pierre Bobillot, « POête bruYant » pour qui « Poésie C’EST… du bruit dans la pointCom ! ». Juice Casaganthe, « l’avait pas les mots, mais faudrait pas croire quelle s’en plaignait. Les discours vendus sous vide au rayon prêt-à-parler lui semblaient répugnants d’hygiène ». Jean-Pierre Bobillot et Sylvie Nève ont jadis, à Arras, animé la revue « Électre », la collection « Lèpre électrique ». Fanny Quément scotche la langue « sur une pile plate / pour l’amour du jus ».