Corbière le crevant d’Emmanuel Tugny par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
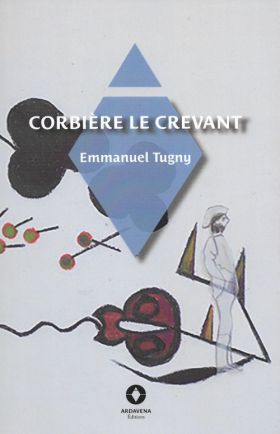
L’homme, l’œuvre : Lagarde et Michard. L’œuvre contre l’homme : le Contre Sainte Beuve. L’homme à travers l’œuvre : le Proust de Painter. L’homme engendrant l’homme engendrant l’œuvre : le Corbière d’Emmanuel Tugny, biographie romancée parue en 2007 ou plutôt « roman policier » selon Ahmed Kaboub qui, en postface, l’inscrit à la fois « dans la veine de la nouvelle critique littéraire qui recourt à différents domaines cognitifs tels que la psychanalyse », et « dans le sillage de la critique biographique d’Alexandre Arnoux, Jean Rousselot et René Martineau », poursuivie dans les années 60 par Albert Sonnenfeld. Trente ans après, le livre de Tugny dialogue avec le Tristan Corbière de Jean Rousselot (Poètes d’aujourd’hui Seghers, 1973). L’un comme l’autre décrivent « le milieu familial et social dans lequel Edouard Joachim voit le jour », et proposent « un questionnement existentiel qui s’appuie sur les Amours jaunes ». L’écriture diffère, la biographie de Corbière par Tugny s’apparentant au « roman en vers » pratiqué par Christian Prigent dans la série des Chino : à la prose de Tugny, les vers de Corbière offrent un contrepoint plus qu’une illustration.
Le « roman » de Corbière par Tugny n’est pas stendhalien : il ne suit pas son héros dans sa traversée de milieux successifs. Plutôt balzacien, il part de la peinture de lieux pour y inscrire, presque en déduire, son héros. Ainsi se succèdent (titres des chapitres) : Morlaix ; Saint Brieuc ; Nantes, Provence, retour ; Roscoff ; Italie pourquoi non ; Roscoff, la guerre, l’amour, Paris. Le paradoxe est dans l’ « auto engendrement » de Tristan, envers et contre ce qui l’engendre. « La vie est construction sur un rien formidable ondoyant, vacillant ». Construction et déguisement : « il a vu que force est à celui qui sait qu’ordure et corruption sont ce qui est, que ce qui est est contre l’ordre, que ce qui est est liberté de la grimace universelle ». Si l’homme est « curieux agrégat », celui de Tristan « n’est pas une réussite, parce qu’il foire comme un frac étroit ». Il merdRe, écrirait Prigent. Il vit « toutes les vies (…) puisqu’elles sont les peaux fantaisie appliquées pour rire sur un ventre qui grouille de vermine ». Le poète est « la garde-robe infinie de ce qui le taraude ». Si son père Edouard « comme Hugo comme Dumas » était « conteur du travail sur le temps », Tristan est « le conteur de la vanité de ce travail ».
La vie d’Edouard est une « aventure où Gombreville le dispute à Cooper : marins, monarques, poètes, journaux, prisons, bâtiments : la Tour de Nesle ! ». Son fils « d’eau douce le dégonflé » cabote « à la traîne. Rien de rien et fille, avec ça ! ». À l’école, il « est lent et pour tout dire nul ». Il « souffre et jouit un peu de souffrir ». Et « souffre de jouir ». Il « pleure autant qu’il rêve », en « Kid Bovary vénal ».
Pour faire le portrait d’un Tristan, portrait littéraire autant que biographique, Tugny use, comme d’une palette, de rapprochements avec d’autres auteurs. « Comme le Sartre des Mots, il grimace pour comprendre devant la glace aux douches ». Comme Céline, il « chinoise et mouline de la jérémiade épistolaire, fait l’intéressant accablé par l’iniquité ». Comme Des Esseintes, il « est des Ethers. Valeurs autres, autres abscisse, ordonnée, tout ». Comme chez Mallarmé, « "rien n’aura eu lieu que le lieu" qui est exception de constellations », et la mort « triomphe dans cette voix étrange ». Comme le chat de Carroll, il « assène son vilain rire (…) promené sans corps sûr sur un monde en fusion ». Mais dans la composition du portrait, dominent les touches rimbaldiennes. Déjà son père a « fait son Rimbaud de Bretagne » et l’honneur paternel lavé, a quitté « la cochonnerie d’écriture » pour « la beauté pratique des voyages sur cette terre ». Comme ceux de la mère du poète de sept ans, les yeux de Tristan « promettent et mentent ». Il a « des cœurs bavant le caporal » comme dans « Le Cœur volé ». L’enfant « est un autre », le nom du père étant « l’entéléchie vraie d’un corps dès lors un peu vidé de sa vie propre ». Il sème « prouts, calembours barbares, refrains idiots, etc. ». Son « front noir » est « livré aux répugnances ». Les masques tombent « sous le vitriol du Chéri-Bibi aux semelles de vent ». Ses poèmes « font floraisons lépreuses des vieux murs de la langue morte ». Quand « les hommes sont partout à la guerre », le vallon « moussera de ça et moussera enfin de tout ».
L’Art poétique de Tristan est « composite et formidablement cohérent ». Langue et prosodie sont « jappements dans le vent, résistance marquée d’une histoire des formes à la corruption aimable des formes ». Poème et roman se dissolvent « dans un paradoxal murmure jaculatoire, un aboiement long et doux », les « hoquets d’un point d’orgue de voix ». Il croise à Paris « les écoles pauvresses qui feront des avant-gardes ensuite et qu’emporteront les cordiaux » : hydropathes, etc. Passons ici de Tugny à Rousselot : « c’est à une rupture absolue avec la notion représentative que nous assistons et c’est là ce que veut dire Corbière quand il prétend ne pas connaître l’art, être un artiste à l’envers ». Corbière-précurseur « mériterait à lui seul tout un livre : on y démontrerait qu’avec lui une façon-de-dire qui permet de tout dire s’est introduite dans la dialectique poétique », par les trous de « tirets, guillemets, points de suspension, alinéas de largeur différente (…) La disposition typographique des Amours jaunes, c’est l’ébauche des cryptogrammes d’Apollinaire, de Birot, de Marinetti ». Il « a influencé très visiblement Verlaine (celui de Parallèlement et des poèmes de la fin, pour la syntaxe surtout) », Laforgue, Maeterlinck, Raymond Roussel « (l’enchaînement automatique, l’humour) », les Surréalistes, Tzara qui souligna « que dans Les Amours jaunes, la "volonté d’expression" atteint à une sorte d’exaspération verbale qui, loin d’être désordre, est, au contraire, le déroulement cohérent de la pensée poétique ».
Retour à Tugny : « il souffre, —voilà ce qu’on dira du fond— et il délire —voilà ce qu’on dira de la forme ». Ce serait, on (pas le même on) l’a compris, un peu court.