Michèle Finck - Vivre, écrire : dialogues sur la poésie par Marc Wetzel
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
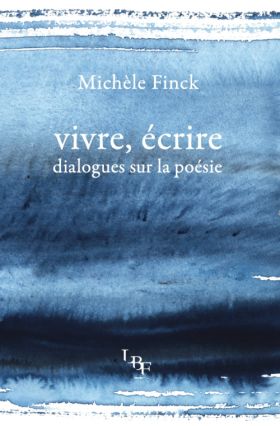
La poète Michèle Finck (née en Alsace en 1960) est par ailleurs musicienne, traductrice et universitaire. Elle a donc de quoi répondre à des questions sur son œuvre (qui est dense, intrigante et émue), mais ce qui vaut qu'on l'interroge est encore ailleurs : dans son hypermnésie (peut-être maladive), son polyglottisme (peut-être thérapeutique), ses capacités (précoces) de synesthésie, sa sorte de vocation acquise d'orpheline (la mort de son père - Adrien Finck - , celle de son "père spirituel" Yves Bonnefoy, et la mort psycho-sociale de son compagnon Laury Granier, l'ont également, et puissamment, marquée), sa faim d'intensité et surtout, peut-être, son souci de tester la partageabilité de l'expérience poétique qu'elle mène et qui la guide.
Pour les cinq dialogues (trois sollicités, deux acceptés) sur la poésie qui forment ce livre (aux thèmes récurrents : la mémoire, la douleur, la mer, la naissance à soi ...), elle sait choisir ses interlocuteurs : l'ouverte autorité de Pierre Dhainaut, la chaleureuse profondeur de Jean-Marc Sourdillon, la libre vivacité de Mathieu Hilfiger, la professionnelle sobriété de Sophie Guermès, la malicieuse pertinence de Frédéric Sounac. On retient deux leçons : d'abord tout y est concret ("Quand j'écris le mot violon, j'entends effectivement un violon, de même que quand je dédie un poème à une œuvre musicale, j'entends cette œuvre dans ma tête par tel ou tel interprète. Rien n'est jamais abstrait. Tout est incarné", p.145). Ensuite, sa caractérisation de la poésie comme musique du sens y est partout respectée et déployée. Comme musique est mélodie, rythme et harmonie, la poésie y est triplement approchée comme mélodie du sens : la poésie est alors vue "comme un corps organique de sons vivants à réinventer sans cesse" p.149, mais, lui, dans le monde verbal ; comme rythme du sens ensuite (qui, en poésie, "peut être défini en termes de retour et de retard", p.160, et vient comme "organisation du mouvement de la parole dans le langage par un sujet", selon Meschonnic, cité p.75) ; comme harmonie du sens enfin (qui fait habiter dans sa "mise en résonance", p.107, le lecteur ou l'auditeur, et l'intègre au juste accord de ses possibilités de vie). Et, bien sûr, la tâche est malaisée, car un "sens" peut-il assumer ensemble ces trois exigences ?!
Mention particulière à l'épatant dialogue (cinquante pages) de Michèle Finck avec Jean-Marc Sourdillon. L'auteur du "Seigneur de la pénombre" (admirable petit livre - 2022 - dans lequel un merle apporte le tact ingénieux, fraternel et lucide de son chant) s'y fait lui-même (par la surprise de ses questions et la justesse de ses commentaires) "cerise pour l'ouïe" de et dans ce jardin du sens. Sourdillon s'y montre le questionneur de la meilleure part, le pacifique complice des renaissances de la poète. Citant Maria Zambrano ("Tout est révélation, tout pourrait l'être si on l'accueillait à l'état naissant"), sachant rejoindre son interlocutrice là exactement où elle sera elle-même, ouvrant des parenthèses qu'il sait ne pas refermer seul, détendant directement en l'autre le ressort serré de sa pudeur, il y montre lui-même le "tact du voisin qui se retient de tousser passé minuit", déposant délicatement l'âme-sœur "à côté du sommeil, mais (pourtant) pas dans la veille" ... Délicatesse et gravité (comme disait Nicole Drano-Stamberg) ensemble, alors, des confidences croisées. Sourdillon : "On écrit, me semble-t-il, pour savoir à qui l'on s'adresse. On écrit mais on ne sait pas à qui on écrit, un peu comme dans un photomaton on ne sait pas à qui on sourit" p.57, ou : "Le cœur du peintre passe directement de son corps au corps des choses (...) Le cœur du peintre bat dans l'autre, et il peint à partir de lui, de ce qu'il devient en le peignant ; le poète, lui, voudrait tellement, mais il se heurte à la part d'ombre ou de vide contenu dans les mots. Il n'a pas part" p.74. Et, en écho, Michèle Finck :"Je partage avec Paul Celan, poète de l'autre s'il en est, l'intuition d'un "singbarer Rest"/ "reste chantable" en poésie, mais, selon moi, la poésie doit tout entière se réparer au contact de ce "reste" musical : il y va de l'avenir de la poésie qui, si elle se sépare de la musique, risque de n'être plus qu'une peau de chagrin qui diminuera et se raréfiera jusqu'à peut-être disparaître. Si la poésie pense la musique, la musique pour moi panse la poésie :
c'est l'une de ses fonctions majeures" p. 79. Leur accord se fait, plus haut, dans la formule, à nouveau, de Sourdillon : "La parole de la poésie nous offre avec son langage les yeux qui nous manquaient pour voir dans le noir..." (p.86).
Mais les autres interlocuteurs de Michèle Finck eux aussi l'amènent à sa vérité. L'impétueux Hilfiger (le poète et dramaturge est ici son éditeur) fera avouer à son mal-être ceci : "Si le corps est une partition, où certaines notes à l'intérieur des barres de mesure sont des traces de douleur, l'interprétation de cette partition par le poème a, dans mon expérience, une vocation salvatrice" p.97, pour conclure plus loin : "La douleur nous apprend à travailler la langue autrement" (p.112). De même la discrète Sophie Guermès obtient de notre poète ce parfait contraste-ci : "Claude Vigée, j'en ai souvent parlé avec lui, n'aimait pas la mer. La poésie n'a pas pour lui de tâche plus urgente que d'accomplir cette délivrance de l'énergie lumineuse enfermée dans la mer", alors que, pour elle, "la mer est dépositaire du sacré parce que (au contraire de la terre) elle reflète le ciel", et est assez pour elle cette "énergie dépositaire du lien entre l'intime et le cosmos" pour lui faire écrire, justement : "Écrire : / Nager jusqu'à devenir mer" (p.129).
Comme Frédéric Sounac (dans leur érudit, mais éclairant, entretien) obtient d'elle un magnifique commentaire, par "l'œiloreille" et la "clairaudience", d'un monostiche de son premier livre (L'ouïe éblouie) : "Les mots sont les larmes de l'oreille" (cité, p.135). C'est en cela que l'effort d'inlassablement ré-écouter ce qu'elle peine à se dire a si pertinemment payé. Lorsque Sounac lui rappelle la formule de Barthes :"Par rapport à l'écrivain, le musicien est toujours fou, et l'écrivain lui, ne peut jamais l'être, parce qu'il est condamné au sens", Michèle Finck approuve, puis nuance : l'écrivain, oui, trouve son parapet anti-folie dans sa condamnation même au sens. Mais le poète, lui, le musicien du sens, justement ? Il risque la folie à entendre, comme lui seul sait faire, "les blancs entre les mots". "À la différence de certains poètes (du Bouchet) pour qui les blancs sont avant tout des catégories visuelles, pour moi ils sont d'abord des catégories sonores. Là aussi, je les entends" (p.159). Mais Michèle Finck, composant avec les dansantes douleurs de ses mots, aura su, de ce non-sens aussi, se faire la musicienne.
Moments enfin, simples et sensés, face à Pierre Dhainaut, des contre-confidences : Michèle Finck avoue connaître la non-naissance, Pierre Dhainaut ne pas connaître la non-mort. La présence des propos ici suffit :
"Pour moi, qui n'ai pas d'enfants, je suis toujours très vigilante pour que ce soit aussi l'enfant, l'autre enfant, qui me fasse don de l'enfance, contre toute absolutisation dangereuse de ma propre enfance. L'enfant hors de soi aide à éviter la complaisance d'un enfermement dans sa propre enfance. Je me dis souvent : Ta mémoire de l'enfance n'est pas en toi ! Elle est dans cet autre enfant, réel, qui joue à côté de toi ou avec toi !" (p.33)
À quoi Pierre Dhainaut répond : "J'étais seul une nuit d'octobre, au chevet de mon père agonisant : d'un coup, quand la tête se renverse, immobile, il existe un avant, un après, j'avais vingt-quatre ans, mon fils aîné venait de naître. Vie et mort sont inséparables, mais pour moi, depuis cette année-là, l'ordre des termes a changé, je dis mort et vie ..." (p.39).
Voilà un tel livre.