Jean-Claude Leroy- Dissipation par Marc Wetzel
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
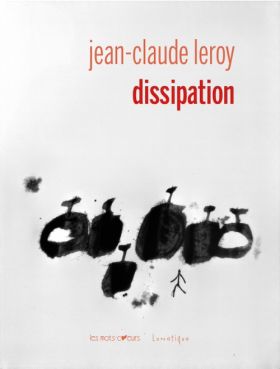
"Se dissiper", pour l'élève qu'on ne tient plus, comme pour la chaleur dégagée (et perdue) par des freins trop sollicités, c'est répandre son agitation. Gaspillage des forces et relâchement de conduite y vont ensemble, et "dissipation" ne paraît pas, même poétiquement, un mot d'ordre engageant ou noble : c'est comme un nomadisme grevé par la déperdition, ou une prodigalité dissolvante. La perte de qualité (dans l'échange ou le trajet) produit sa propre disqualification. Mais ce que dénonce peut-être aussi le titre (la suicidaire dépense de ressources du capitalisme) n'est pas l'essentiel de cette "dissipation", qui (sentiment que chaque page lue renforce) désigne bien plutôt ni plus ni moins que la geste d'une ... révolution intérieure ! Dissipation ne signifie en tout cas, chez Jean-Claude Leroy, ni simple distraction (c'est un homme qui n'attirerait pas volontiers l'attention sur son attention même !), ni diversion (l'auteur est partout d'une massive authenticité, allant peut-être jusqu'à la naïveté), ni dispersion (l'homme est bien plutôt d'une sobriété infinitive, au sens, comme il l'écrit, de la neutralité d'un verbe, du mode nu et mort d'un acte ou d'un état auquel il n'arriverait que lui-même !)
"poésie infinitive
prendre au lieu de j'ai pris
passer au lieu de je passe
tenir au lieu de tiens, tiens !
générique banal
l'infinitif comme épreuve
comme denture élementaire
comme camouflage permis
ou ressort premier" (p.42)
Trois choses frappent tout de suite chez cet auteur. Primo, en effet, une "massive" authenticité : la vie autonome l'est, pour lui, d'abord et surtout au sens physiologique. C'est l'existence assurée constamment par les seuls moyens du bord. Et, bien sûr, c'est plus difficile avec l'âge (Leroy a 65 ans), puisque ces moyens du bord normalement rouillent et périclitent. Tant pis, on vieillira comme ça, avec une autonomie elle-même vieillissante : l'auteur ne va tout de même pas commencer à se mentir, sous prétexte que la vérité ne prend, elle, pas d'âge ! Si la vie perd sur elle les moyens de durer, "dissipe" sa propre persistance, alors tant pis pour le projet même de durer ! Voilà notre homme. Ensuite frappe son humilité strictement technique, ou exclusivement professionnelle : si, sur tout point qu'il s'apprête à évoquer, il connaît (ou simplement imagine méthodiquement) quelqu'un qui le dirait (le formulerait) mieux que lui, il le citerait, lui laisserait la plume, personnellement s'abstiendrait. L'anecdote, qui suit ici, du "jeune libraire" est à coup sûr réelle (et cela va même plus loin : s'il y a à parler, il parle ; mais s'il comprend qu'il y a mieux encore à se taire, il quitte ses mots). La lame de "la nécessité intérieure" (comme disait Kandinsky) n'hésite ainsi pas à trancher net toute inspiration : les formules restées en place sont littéralement des rescapées, et - comme ceux qui souhaitent vivre justement le savent - dans le monde réel, seuls les rescapés sont sincères.
"le jeune libraire m'a demandé :
"lequel de vos livres dois-je lire ?"
j'ai répondu : "lisez plutôt les poèmes de Nanao Sakaki
lisez plutôt son ami Gary Snyder
lisez-les, ça vous fera le plus grand bien, je crois
et votre respiration sera meilleure
et quand vous vous sentirez heureux
prenez mes livres si vous voulez
et asseyez-vous dessus en regardant dehors
car c'est ainsi qu'il faut les lire
en ne les ouvrant pas
et en se moquant de toutes ces pages écrasées
qui dorment sous une paire de fesses
tandis que dehors à cet instant
il se passe quelque chose" (p.60)
Le troisième trait de caractère de l'auteur est comme une insolence fraternelle (qu'on imagine ici un Brassens qui serait, comme Leroy, photographe !), que je ne peux mieux illustrer que par un trait de l'unique rencontre que j'ai eue avec cet auteur - une lecture qu'il faisait à Frontignan, où je l'avais abordé pour, bavardement, commenter et louer sa prestation - où il m'avait répondu ainsi : "je suis intéressé surtout par ce qu'il y a de vrai dans ce que vous dites ...". Ce précis et imparable "surtout" me rappelle une autre répartie, encaissée, elle, depuis un hypokhâgneux de fond de classe, qu'un jour j'avais cru pertinent de littéralement réveiller, et qui m'avait, en s'étirant sèchement, publiquement déclaré : "si vous aviez su ce que mon sommeil cherchait, vous auriez hésité à me secouer". Mais Leroy, qui estime sans excès ses propres excès, a surtout ("laisser tranquille la porte verrouillée" d'autrui !) l'insolence civilisée de comprendre (et faire place à) celle des autres :
"il y a mon côté gentil
il y a mon côté indifférent
et mon côté sombre
j'ai plusieurs côtés
je ne les connais pas tous
je crois même que certains d'entre eux ...
vont d'un côté sur l'autre
toi aussi, tu as plusieurs côtés
et c'est à moi, lorsque j'arrive à toi
de ne pas me tromper
et laisser dormir le côté fermé
laisser tranquille la porte verrouillée
ne pas l'ouvrir
et tout ira bien" (p.56)
Mais une "révolution intérieure" à attendre d'une simple dissipation : pourquoi ? D'abord parce que la sagesse décide d'attendre le réel là où il se passe : ici même, toujours ("rester au même endroit/ ne pas attendre la visite/ la visite a toujours lieu", p.34). Ensuite parce que le vieillissement propre permet meilleure et plus naturelle solidarité avec tous les âges :"ne te laisse pas faire/mais laisse-toi vivre !"/ coincé sur un fauteuil roulant/ dans un couloir de cet ehpad gris/ ce vieillard me livrait sa devise/ je l'ai juste regardé/ il a souri" (p.37). Et puis la simple lucidité psycho-politique ("la mort effraie les possédants" : celui qui ne possède rien dans la vie, que craindrait-il que la mort lui arrache ?) va au-delà de la pourtant salubre ironie ("Pour voyager léger/ Pourquoi ne laisserais-tu pas/ Ton crâne ici ?", écrit-il en citant Nanao Sakaki, p.39) vers l'idée essentielle que l'aliénation tient d'abord aux modalités de la possession de soi par soi (p.61). Dissiper le mal de notre bien ouvre ainsi les yeux sur l'objectif capable de nous rouvrir à la vie. Jean-Claude Leroy le chante tout bonnement ainsi :
"si tu tiens vraiment à ce que le mal existe
alors disons que c'est ton bien qui est le mal
tout ce que tu possèdes
et qui fait de toi un prisonnier
l'ennemi de toute vie
c'est le poids matériel de l'esprit
quand il voudrait plutôt s'envoler" (p. 65)
C'est un auteur net, d'humeur difficile, mais remarquablement important (son recueil "Toutes tuées" - chez Rougerie en 2015 - est un hallucinatoire et tendre chef-d'œuvre). Bien sûr, la leçon de vie de la "dissipation" n'est pas assurée : le deuil se dissipera-t-il dans les cendres mêmes qu'il répand ? Ce "geste du semeur" (p.26) organise plutôt sa propre paralysie ! Et, de même, toute dissipation - qui ne s'éclaire qu'à sa propre ardeur - est risque d'excès ("aujourd'hui/ pour me réchauffer/j'allume un incendie/ j'ai perdu la mesure/ la queue du diable me sert de compas", p.20), mais elle est aussi voie de rares métamorphoses. Aller se glisser, comme l'auteur fait, dans d'autres disponibilités que la sienne est curiosité sans parasitisme et risque généreux : "j'aime devenir la rivière/(car elle veut bien qu'à mon tour/ je sois rivière en son lit)". Drôle de rebelle, c'est vrai, qui aujourd'hui "résiste à la tentation d'agir" (p.54), mais le recueillement reste clairement révolutionnaire ("je me rêve en grain de sable/ et qu'enfin la machine s'arrête/ pour que la vie reprenne", p.44), et l'intelligence, dure au mal, est ici douce aux autres, à celles des autres en tout cas :
"respectant la vie
le sage s'inscrit dans l'immortalité
non pas chargé de lui-même
mais de ce qui le traverse
il ne peut craindre sa propre disparition
sauf que pas un sage
n'est tout à fait un sage
comme l'homme du commun
jamais n'est si commun
c'est pourquoi le détour
vaut quand même le voyage" (p.31)