Gérard Pfister-Un déjeuner en montagne par Christian Travaux
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
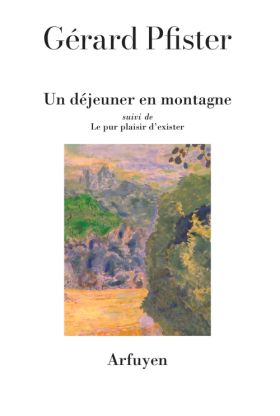
Nous vivons trop peu pour porter loin nos espérances.
HORACE
Est-ce parce qu’on y trouve, seulement, deux paragraphes sur chaque page, qu’il y a, en eux, tant de lumière ? Est-ce par ce qui est dit, ici, dans ce livre, qu’il y a, dans chaque mot, dans chaque phrase, comme un allègement de l’âme, un apaisement ? Les plus beaux livres, pensait Jabès, sont ceux qui retiennent en eux, dans les rets fins de leurs vocables, un peu de la lumière intense de la page blanche. Un Déjeuner en montagne de Gérard Pfister est de ceux-là, tant y irradient les mots simples, lumineux, qui le constituent. Et l’épigraphe d’Épicure qui l’introduit sert de fanal pour avancer dans cette lumière, toujours plus blanche, toujours plus belle, et faire l’ascension – comme Pétrarque, du Mont Ventoux – de ce chemin de montagne qui nous conduit à plus de joie, plus de bonheur, de plénitude, dans l’ascension si difficile de notre vie.
Trois parties. Prologue et Final. 128 pages au total. Et deux paragraphes par page, seulement, parfois d’une phrase, parfois d’une ligne ou deux. Autant dire peu de chose. Mais que de choses, dans ce peu de chose ! Un ami cher est décédé, ami dont on ne saura rien. Qui était-il ? Il n’a ni nom, ni visage. Et tous les bustes, tous les portraits faits de lui sont différents (p. 50). Une « barbe hirsute », un « visage émacié », une « mine sévère » (id.). C’est trop peu pour l’identifier. Et son statut ? Même pas un maître, ni un père (p. 89). De toute façon, ses paroles, nul n’a songé à les noter (p. 28). Il n’en reste que peu de choses (p.27). Ce « il » anonyme, dont on parle si fréquemment parmi ses pages, n’est que « l’ami » (p. 36), si peu connu, si peu compris. C’est cela, sans doute, qui fait de lui une présence si chère, car « il s’est tellement effacé, nous dit Pfister, pour nous laisser toute place pour vivre » (p. 55). Et pour assister, tous les ans, à un repas en son honneur, le jour de sa naissance.
Mais, de lui, il demeure, pourtant, un ton, ou une intonation (p. 29). Ou juste le regard de ses yeux, conservé dans notre mémoire. Douceur. Lumière. Rire de ce regard comme réponse, comme seule réponse à nos questions (p. 31). Et qui console, et qui apaise, au point qu’il se trouve être là, près de nous, même s’il est absent, même s’il n’est plus, dès que nous fixons une étoile où nous croyons l’imaginer (p. 56), ou quand nous sommes en route pour lui. Rien d’autre. Pas d’autre enseignement. Pas de doctrine, que cette sorte de lumière qui émanait de ses paroles, ou de ses yeux, et qui reste dans le ciel noir, le ciel de nuit, lorsque l’on regarde les étoiles.
Ce qu’il voulait ? Que l’on soit ensemble simplement, simplement là, à apprendre à être là, et communier avec le jour, avec la nuit, avec la nature, coïncider avec chaque instant que l’on vit (p. 24), sans chercher d’autre chose qu’ici, être là, et être vivant. Éprouver, comme l’écrit Pfister, le pur plaisir d’exister (p. 95). Vivre un temps de pure existence (p. 89). Pour cela, il nous faut goûter chaque pas de ce long chemin qu’on fait vers lui, dans la montagne (p. 34). Guetter, regarder l’eau qui coule d’un ruisseau, et s’abandonner sans résistance à ce moment de l’eau qui s’écoule devant nous (p. 35). Sentir, sentir, « les pins », « les rochers », « les bruyères et la neige des hivers interminables, nos pas sur les sentiers presque invisibles parmi les gentianes et les genévriers » (p. 87). Nous étendre sous le soleil (p. 106). Et demeurer dans la lumière (p. 98). Revenir au corps que nous sommes (p. 81). Seulement cela.
Aller tout le long du chemin qui nous mène au repas pour lui, c’est aller vers nous, semble-t-il, vers ce que nous avons à vivre, à devenir : des vivants, au sens plein du terme. Des êtres conscients d’exister, et de sentir, et de vivre sous la lumière de ce soleil qui nous éclaire pour un instant seulement, l’instant d’une vie. Aussi faut-il bien éprouver le paysage que nous croisons sur le trajet de notre vie (p. 17), comme la fourmi qui vient marcher sur la paume de notre main (p. 36). On le voit, le but de ce livre n’est pas tant de nous raconter un déjeuner en montagne que de nous faire sentir, en nous, notre besoin d’exister, ressentir, en nous, ce que c’est que de vivre au même instant. Au banquet de notre existence, sur le chemin de notre vie, c’est ainsi que nous devons vivre : goûter, à chaque pas, à chaque heure, ce que nous sommes dans la lumière de la journée, avant la nuit. Apprendre à nous arrêter, pour regarder, tout simplement. Regarder. Ne pas se lasser, comme le disait Paul de Roux, auquel on pense ici, souvent. Et faire un avec notre corps, avec le corps même de toute chose, de tout être, qui vit comme nous, aujourd’hui, ici, maintenant.
Ce serait, alors, cela, être ensemble. Vivre sur une même terre, un même morceau de planète, dans le même court laps de temps que nous laisse l’éternité. En cela, seulement, nous saurons ce qu’est vivre, et ce qu’est mourir. En cela, seulement, nous saurons atteindre à la plénitude qui doit être celle de tout être qui est sur la terre vivant, vivant, et non mort, et non sous la terre. « Réjouis-toi ! », écrit Pfister, est la seule parole rituelle (p. 64). Il a raison. Nous passons. Nous passons toujours. Nous ne faisons que passer. « Tous, nous sommes poussés au même lieu ; pour tous, notre lot est agité dans l’urne, il en sortira ou plus tôt ou plus tard, et nous fera monter dans la barque pour l’éternel exil. », écrit Horace, dans les Odes (II, 3). Nous ne laisserons rien sur terre que ce court passage que nous eûmes. Et, peut-être, un peu de lumière, un peu de jour, un coin de lune, une faible lueur d’étoile, quand, dans le soir, bien après nous, on pensera encore à nous, avec amour, avec tendresse.
Rien ne compte que cette lueur. Rien n’importe que cet amour que l’on laissera en partant, et qui résistera au temps, au passage des ans, à l’oubli. Aussi est-ce, en lisant ce livre, à l’Amyntas qu’on peut penser, du Tasse, au bel « Hymne à l’Âge d’Or » qui termine le premier acte. Et, devant tant de clarté, tant de lumière dans les mots, il n’y a qu’à les laisser parler :
« Aimons-nous, car, sans trêve,
est notre humaine vie, qui passe avec les ans.
Aimons- nous, le Soleil se meurt et puis renaît :
son bref éclat s’efface,
et le sommeil nous mène à l’éternelle nuit. »