Maya Vitalia, Éros-phyton... par Alexander Dickow
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
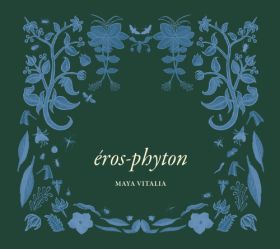
A poet : someone who is never satisfied with saying one thing at a time.
Extrait des carnets de Theodore Roethke.
Maya Vitalia, poète nouvelle, a fait un herbier : un phyton est justement la plante en grec, tandis qu’Éros dit l’amoureuse frénésie des mots du Jardin. Il existe de bons exemples récents d’une approche du végétal en poésie, de Notes sur les noms de la nature de Philippe Annocque (2017) à Sharawadji : manuel du jardinier platonique de Pascale Petit (2010) en passant par Couper les tiges de Virginie Lalucq (2001, ce dernier en particulier a une parenté claire avec Éros-phyton). Ces livres ne manquent pas de vitalité et arrivent souvent à dépasser la joliesse en faveur de séductions et de questionnements plus substantiels. J’admire ces livres. Mais, me surprendre encore sur ces sentiers bien battus ? J’aurais cru l’affaire bien difficile. Maya Vitalia y est parvenue, pour mon bonheur.
On rencontrera en ce livre l’amour des mots rares qui forment les noms communs ou savants du royaume des choses qui germent et qui poussent, comme en témoigne une page constituée presque entièrement de noms de champignons : « lépiote pudique, pézize veinée, lactaire délicieux / ou sanguin, clitocybe odorant, truffe noire, baveux » (52). Il y a un plaisir des mots techniques, parfois doublés d’équivoques possibles : « la cupule de son gland s’horripile de trichomes », écrit Vitalia du chêne (91). On peut ou non avoir recours au dictionnaire, malgré la présence discrète de quelques néologismes. Cependant, les termes mystérieux arrivent le plus souvent avec d’autres plus familiers, évocateurs pour qui reconnaît d’emblée le contexte fongique : « délicieux », « sanguin », « odorant », « baveux ». Les mots de la science ne rebutent pas, mais ajoutent aux charmes de l’écriture comme autant de gemmes insolites.
Poète de l’invention, Vitalia demande une implication de la lectrice ou du lecteur. Chaque passage de cet herbier propose un acte de sa part, en rapport au foisonnement végétal. Aussi les impératifs s’égrènent-ils au fil des pages : « Retrouve, avec René Desfontaines, le Ziziphus lotus / ou jujubier de Berbérie » (55) ; « Méfie-toi du lierre rampant » (66) ; « Détrempe tes couleurs dans ce liquide liant & déliant » (39) ; « Ôte et goûte le poivron sucette de Provence » (27 ; je souligne à l’exception du nom latin). Aussi la lectrice est-elle pour ainsi dire prise à parti et entraînée dans la virevolte.
Vitalia tire en particulier une multitude d’effets d’une technique simple, celle de disjoindre les mots avec art :
Collectionne les cynorhodons de l’é
glantier – gratte-cul – angiosperme : sa semence est conte
nue dans ce réci
pient – (60)
Tout poète sait, ainsi que bien des lecteurs, que dans les mots, il y a d’autres mots, et Vitalia tire un parti extraordinaire de ce fait ; les mots y poussent comme une herbe, par le milieu (Deleuze). La poète fait surgir partout des sens latents, comme ici celui de quelque narration (réci[t], conte) non dénuée d’érotisme (semence, nue). Le titre « éros-phyton » indique déjà la prévalence du rapport amoureux parmi ses couches submergées de la langue ; les fleurs sont après tout des organes sexuels, et il y a dans cette scissiparité des mots quelque chose d’un coït fertile en progéniture – un genre de méiose linguistique perpétuelle. Dans une certaine mesure, le jeu des sens latents privilégie peut-être la sexualité (mais pas toujours : Glantier est le nom d’un fabricant de parfums polonais). On pense aux « Sept épées » d’Apollinaire, où le déchiffrement des néologismes a encouragé le regard lascif. C’est le cas chez Vitalia :
Suç
ote sa tige-puits : une sève laiteuse
s’écoule d’elle à la moindre cass
ure ou bless
ure ; la Brise disperse
ses akènes à aigrettes (31-32)
Le fait de « suçoter » une « tige-puits » où s’écoule une « sève laiteuse » assume tout de même une charge érotique ici, mais c’est « d’elle » que cette sève-semence s’écoule, comme pour souligner l’ambiguïté sexuelle de la « tige-puits » hermaphrodite (le livre de Vitalia est, d’un certain point de vue, pansexuel). Cela assure la présence d’une thématique amoureuse. Mais « bless », comme l’indique les italiques qui servent souvent à le signaler, vient d’une autre langue, l’anglais, où il signifie bénir, terme plutôt religieux qu’érotique (quoique ?), et qui fait un contraste notable avec le sens du mot blessure. Par conséquent, malgré la prégnance d’éros, d’autres latences se font sentir au cours des textes, autant de résonances libérées en tous sens. Au demeurant, elle n’a pas toujours besoin de disloquer les mots pour libérer de telles résonances : le mot « Brise » dégage déjà une valeur homonymique de « cassure » dans le présent exemple. C’est dire à quel point les éléments de ces textes se motivent par reflets réciproques, pour parler comme l’autre.
J’identifie plusieurs opérations – mais il y en a sans doute bien d’autres – dans ces dislocations. Tantôt, il s’agit d’une exemplification du sens d’un mot : « écar late » (23) met en valeur le sens du mot « écart » en en introduisant un au sein du mot, tandis que « late » signifie « retardataire » ou « en retard » en anglais – conséquemment, ce mot arrive seulement après la pause de la césure. Cette exemplification peut prendre le mot à rebours : dans
glandes rouges à la j
onction avec le limbe (37)
Il y a non pas une jonction, mais une disjonction. L’exemplification sémantique n’est pas toujours présente :
onguent d’im
mortalité (44)
ne propose pas de parallèle entre la dislocation du mot et le sens de celui-ci, et « im » n’a pas de rôle sémantique immédiatement sensible.
Tout cela pour dire que la démarche de Vitalia ne se réduit en aucun cas à un procédé mécanique ; il y a une multiplicité d’usages et de résultats qui découle de cette fructueuse réinvention de ce qu’on appelait autrefois la coupe des vers, et qu’il faudrait peut-être rebaptiser la découpe des vers, puisqu’elle n’hésite plus à tailler directement dans la chair des mots. La coupe au milieu d’un mot en fin de vers a déjà été expérimentée, certes ; parfois avec des effets similaires. Mais rarement a-t-on investie cette potentialité technique à ce point, rarement en a-t-on tiré une telle diversité d’effets, un tel feu d’artifice. Au demeurant, puisqu’on est au chapitre de l’artifice, Vitalia a le toucher sûr : une virtuosité certaine l’empêche de tomber dans l’artificiel, l’aide à garder une fluidité séduisante et hautement lisible. Car, malgré les mots rares et la complexité du propos, on ne saurait parler d’hermétisme à moins de chasser tout ce que ce mot connote de laborieux. Chaque geste fait jaillir du sens sans entraves.
Une surprise guette l’heureux découvreur/se de ce volume : un index qui recèle des citations essentielles ainsi que des clins d’œil à l’histoire personnelle de la poète ; aussi Clément Rosset est-il désigné comme un « cher ivrogne ou mon drôle de prof » (129). Par ailleurs, l’index indique de nombreuses allusions à des influences importantes, dont Michaux ou Gertrude Stein entre autres, et renvoie aux pages des textes concernés. La traînée de feu nous entraîne ainsi vers le vaste univers des Lettres.
En incitant tous à se procurer ce splendide courtil d’impossibles foisonnements, permettez-moi de vous offrir ce baume en partant, courtesy of Maya Vitalia herself :
Exp
rime le suc selon Pli
ne l’Ancien : sa plaie laisse couler goutte à goutte un suc
d’une suavité exquise (64)