Victor Rassov, Morosités par Alexander Dickow
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
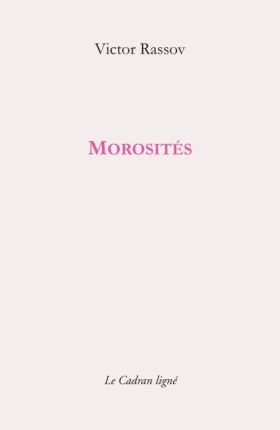
De quelques lectures fort perspicaces de Morosités par Victor Rassov déjà entreprises émerge une sorte de consensus critique qui maintient que ce livre n'a strictement rien de morose. Je pense remettre en cause, un peu et d'une certaine manière, ce jugement. Que la langue de Rassov n'ait rien de terne, personne ne le contestera, comme on le verra ci-dessous par les extraits mis en valeur ; en revanche, l'idée de la morosité a un rôle essentiel à jouer dans ce livre, et dans ce contraste étonnant entre l'idée statique et la forme dynamique, tout se joue.
Déjà, ce titre de Morosités n'est pas sans analogie avec celui d'un livre précédent, chez le même courageux éditeur le Cadran Ligné, L'Oiseux (2021), qui évoque un animal à la fois insolite et indéterminé, voisin décalé de l'oiseau, mais habitant "au bord double [...] du loisir et de la vanité," pris dans un "envol impossible," comme le dit si bien Guillaume Artous-Bouvet à propos de ce premier livre. La morosité serait comme une forme aggravée de l'oisiveté, où la vanité et le loisir ont stagné, sont devenus marasme.
Si la poésie a, comme l'a affirmé Antonio Rodriguez, à faire avec le pâtir et donc la réceptivité affective, la poésie de Rassov semble partir carrément d'un état de passivité. Les poèmes de Morosités évoque sans cesse cet état proche d'une sorte d'abattement : "On entre en phase / de pâmoison. [...] On atteint, / besogneux, la / paresse des / crapauds" (49) ; "On se délabre assez / lentement dans la cuisine" (7) ; "L'état fœtal a ceci / d'avantageux qu'il / est une grande / grande prairie" (30 ; notons l'analogie entre le grand vide d'une prairie et l'existence inefficace de "l'état fœtal"). La morosité -- l'être sans acte ni fonction, sans mobile, n'exhibant aucun trait distinctif, sans relief -- est bel et bien le point de départ de ces poèmes déprimés, mais jamais déprimants.
De même, la morosité explique une des contraintes de la forme que Rassov s'invente : chaque strophe commence par la troisième personne impersonnelle "on," qui, en dépit de son étymologie ("on" dérive de "homo", l'homme), se rapproche le plus de la non-personne, à la fois individuel et collectif, ni nous ni je. On, c'est l'être sans particularité, n'appartenant à personne en propre, le sujet même de l'anonyme. Il vient entre autres choses signifier le rejet implicite du je lyrique, celui d'une première personne singulière et mise en scène comme telle. Ce refus d'un certain lyrisme n'a rien aujourd'hui que de familier, mais Rassov n'en fait pas trop : c'est un point de départ un peu indifférent ; nul besoin de s'appesantir sur l'anti-romantisme fondateur de l'époque.
Plus essentiel est ce que peut faire le on d'un point de vue poétique. Il expose la centralité du verbe dans la phrase. C'est le muscle qui se tend et se distend dans chaque proposition, c'est le pivot du sens. Et là commence le dynamisme propre à Rassov. Le premier élément que l'on rencontre n'est pas tant le "on" qui n'est qu'une donnée uniforme, mais le verbe, toujours fascinant, toujours nouveau : "On arrache [...] / On fournit [...] / On néglige [...]" (21). Le plus souvent, la coupe vient insister sur cet isolement de la formule on + verbe. Cette verbalité de la phrase rassovienne n'a effectivement rien de morose ; elle va en sens inverse de toute passivité, comme pour dire : même lorsqu'on ne fout strictement rien, on fait bel et bien quelque chose, on fait bien des choses à la suite les unes des autres, on "existe" (comme on dirait "on agit" ou "on se comporte") à chaque instant d'une manière toute nouvelle. Jaillissement d'une "création continue d'imprévisible nouveauté," comme le disait Henri Bergson à propos de l'existence.
Morosités est un livre écrit à partir de certaines contraintes formelles : le "on" initial de chaque strophe, trois strophes de six vers chacune. Pourtant, personne ne s'y méprend en n'évoquant jamais l'Oulipo ni une démarche formaliste ; tous comprennent non seulement la souplesse inhérente de ces contraintes d'une part (elles sont minimales et faciles à satisfaire, d'autant plus qu'il n'y a aucune régularité métrique), et la portée existentielle de la démarche de Rassov de l'autre. On n'est pas en présence d'un exercice de style. Rassov est bien plus proche d'Henri Michaux qu'il ne l'est de Queneau ou de Roubaud, notamment par l'imagination débridée dont ces pages font preuve :
On possède un moignon,
une marotte
préhensile.
Chélicères, avant-bras,
trucs suceurs
de cordon. (30)
Voilà figurée en peu de mot notre monstruosité -- les chélicères de l'araignée ou du scorpion -- ensemble avec notre folie (la marotte chercheuse). On songe aux créatures toujours très humaines de Michaux, les meidosems et autres Émanglons.
On grave
nos annonces à la naissance
des plinthes :
jeune blaireau cherche
combles où
jouer les spectres. (18)
L'autodérision de cette "annonce" d'un "jeune blaireau" montre à quel point l'humour tourne rond partout dans Morosités. Ce blaireau-là se propose de "jouer les spectres" : ce personnage ridicule est également bien insubstantiel. L'humour se prolonge dans la coupe des vers : "nos annonces à la naissance" suggère que cette annonce date de l'origine même de ce personnage depuis toujours voué à hanter le lieu où il existe à peine. A la naissance, l'enfant émet souvent des plaintes, paronomase qui motive peut-être les plinthes où l'on grave l'annonce de ce bébé-blaireau fantomatique aussi loufoque qu'inventif. C'est un humour goguenard, parfois pince-sans-rire, qui se moque toujours de notre inaptitude ; nous ne sommes jamais décisifs ; nous lambinons plutôt. En ce sens, Morosités témoigne d'une certaine sensibilité satirique.
Il faut saluer la sagesse de Rassov : son livre, à soixante-six pages, ne fatigue jamais et ne poursuit pas son jeu jusqu'à l'épuisement. Chez d'autres poètes, la formule en on... finirait par se réduire au truc, par devenir mécanique ; chez Rassov, on ne s'en lasse pas, tant il impose par son agilité et sa souplesse.
Il n'y a chez Rassov aucun poétisme malvenu, aucune boursouflure. On ne se prend jamais trop au sérieux. C'est une parole en apesanteur ("Ce n'est pas un envol. / C'est une flottaison" ; 57). Plutôt que de puiser dans les grandes périodes, l'envolée oratoire ou les lourdes réflexions métaphysiques, Rassov préfère couper court. Le grand souffle lyrique n'est pas de son fait, ni l'orgueil du Poète ; il reste discret. Cette apparente légèreté, cette délicatesse même, ne ressemblent pas non plus à la morosité ; on n'y étouffe jamais ; quelle rare fraîcheur, au contraire !
Me suis-je contredit ? J'aboutis, semblerait-il, au même constat que les autres lecteurs, à savoir, que ce livre n'a absolument rien de morose. Seul le fond est morose, la vie qui remue à peine sur laquelle on brode tant bien que mal le poème ; le poème, lui, rachète un peu cette vie morne par son mouvement irrépressible : "notre mal / a tous / les symptômes d'une danse" (54).