Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
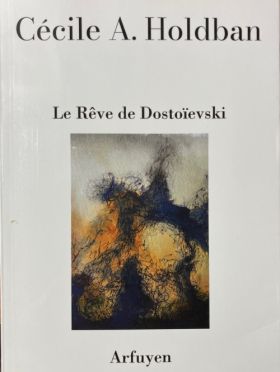
Cécile A. Holdban termine un court prologue, en citant Dostoïevski, « Eux, ils sont tous, et moi, je suis seul » ; c’est ce qu’elle souhaite « exorciser » dans cet ensemble de poèmes en vers et en prose. Ils forment six ensembles séparés par des extraits d’écrivains européens qu’elle apprécie, dont le nom est limité au prénom et à l’initiale du nom, comme « Robert W. » pour Robert Walser ; sont aussi présents Franz Kafka, Mikhaïl Boulgakov, Fernando Pessoa, Samuel Beckett et Jorge Luis Borges. La densité du livre explique que la lecture se limite pour l’essentiel à deux motifs liés, récurrents, la recherche d’un équilibre du "je" dans un monde plein d’aspérités, équilibre qui est désiré et recherché dans une relation étroite avec la Nature. Les textes cités s’intègrent dans cette thématique du livre : ainsi, du premier, « Tout est écriture. Je ne connais pas d’autre moyen d’avoir une identité ». Auparavant, on décrira sommairement les formes choisies.
Beaucoup de poèmes sont d’un seul tenant, quelques-uns en vers qui s’approchent de l’alexandrin, d’autres sont réunis en strophes souvent de 3 ou 4 vers. Le lyrisme de Cécile A. Holdban renoue avec le goût de l’image, abondante, souvent introduite par "comme", « Il neige comme un bleu sous la peau ». Elle privilégie quelques formes classiques et, d’abord, l’anaphore, « Tu n’as pas + participe passé », « Buvons à + nom », « même + article + nom » : « Le silence existe / même les fourmis (…)/, même les océans (…) / même la poussière (…) / etc. » ; « J’ai vu + nom » ; « aujourd’hui + nom (« aujourd’hui les oiseaux …) » ou + verbe (aujourd’hui disperse (…) ». À côté de ces moyens rhétoriques de susciter l’attention — l’image et l’anaphore arrêtent le lecteur —, pas de recherche d’effets (une seule paronomase, soufres/souffle), il suffit à l’auteure d’une langue simple pour tenter de mettre au jour l’obscur — chacun sait qu’ « On garde sous le visage /un visage jamais vu/ clé intérieure ».
La nécessité de l’écriture comme condition pour vivre est affirmée dans le premier poème, « J’ai une chose à dire ». Cette chose est « recroquevillée », cachée « dans un coin sombre » ; il s’agit d’une rose qui « en [elle] éclate » et dont les pétales sont « dispersés ». À sa manière la fragmentation de la rose figure symboliquement la difficulté à réunir et vivre la fragilité autant. Dispersion, comme si la personne était successivement plusieurs sans retrouver une unité — ce qu’exprime Pessoa dans le texte cité, « Je ne suis jamais moi ». Ce qu’exprime aussi un rêve où dans le corps défait « germent des graines » qui deviennent « feuillage ou fruit » pour les animaux — « je vis enfin hors de moi » — jusqu’à une nouvelle naissance ; « je » alors
nourrisson vagissant
mains crispées sur l’absence
je suis là, je suis né
Ce motif de l’absence, récurrent, est associé à l’enfance. Un poème est titré Oikos, c’est-à-dire « famille, maison », donc un lieu où l’on peut retrouver l’enfance, mais il s’agit ici d’une « boîte » où « jouait la vieille enfance » : l’oxymore dit bien le manque et, par ailleurs, le titre d’emblée dissimule ce qui est en jeu : peu aujourd’hui lisent immédiatement le grec. Le lieu où l’on retrouve un instant l’enfance du monde, c’est le grenier où sont remisés les objets oubliés, qui n’ont plus d’usage ; il s’agit d’une peinture, donc encore d’une image, pas de la réalité. On comble le vide dans l’étreinte, « jusqu’à ce que la chambre /nous secoue hors de nous / et que l’on disparaisse » ; étreinte éphémère qui n’oblitère pas le manque puisqu’il y a perte de soi. Enfance perdue et obsession de la disparition mais, même si la mort est évoquée clairement — « Les corps voguent vers la mort, sûrement, sûrement » —, c’est pourtant le foisonnement du vivant, de la nature qui l’emporte.
On citerait aisément tous les poèmes où le "je" et la Nature, avec un N majuscule, sont plus que liés : le "je" se perçoit issu directement d’elle, affirmant « Je suis née de l’arbre », ou acceptant sa métamorphose partielle en corbeau, ses mains alors rémiges des ailes de l’oiseau ; enfin, le "je" imagine avoir été à sa manière un végétal et un animal, « J’ai été / trèfle, cerf, /dans la racine de vivre » et rappelle que l’évidence de son accord avec la nature le conduit à échanger avec les corneilles, ou qu’il suit un oiseau venu lui montrer comment « garder / le pas léger sur la neige ». Il assure avoir une complicité avec les herbes, les arbres, les animaux — y compris les poissons —, même quand ils sont réputés dangereux ; ainsi les loups qu’une vieille peur éloigne sont les « métaphores de notre désir sauvage / clôturé au jardin ». La nature représenterait d’abord une liberté perdue, sans les règles qui limitent toute action dans le monde ; cependant, le tableau pour séduisant qu’il paraisse a des failles. La neige, très présente dans Le Rêve de Dostoïevski, est éphémère sous nos climats, la vie des herbes et des insectes se caractérise par sa brièveté et c’est seulement le "je" qui donne un sens aux choses, au vivant (« l’arbre, sans nous / s’endort ») et à sa disparition, ainsi des feuilles « qu’une saison détruit / qu’un poème répare ».
Quelle réparation ? Peut-on « célébre[r] les impossibles fiançailles du monde et de ma réalité » ? comme se le demandait Kafka, cité par son Journal ? Cécile A. Holdban semble l’assurer en développant sa relation particulière à la nature mais elle ne trouve cependant pas la paix avec elle-même, « chaque mot semble usé, effiloché / prêt à s’évanouir dans le pointillé des pluies ». Paix provisoire, toujours à conquérir, avec la présence de l’Autre sans qui l’effort de vivre perdrait son sens : « tu vois, c’est toi / et il n’y a rien d’autre / toi la passerelle / sur la guerre du vide ».