Georg Christoph Lichtenberg, BROUILLONS par Richard Monnier
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
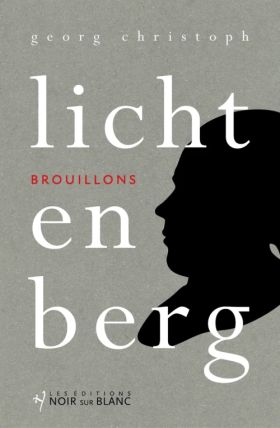
Les Éditions Noir sur Blanc viennent de publier la version intégrale des "Brouillons" de Georg C. Lichtenberg, richement annotée par son traducteur Étienne Barilier.
En 1997, la traduction des écrits de Lichtenberg par Charles Le Blanc, éditée chez Corti sous le titre "le Miroir de l'Âme", se présentait comme "un florilège", ne retenant qu'un quart des notes des "cahiers de brouillon". La traduction de Bernard Baumann parue en 2019 aux éditions de l'Aire, avait décapé l'édition précédente de nombreuses préciosités tout en revenant au titre "Aphorismes". Avec "Brouillons", les aphorismes, puisqu'il est convenu de les appeler ainsi, sont mêlés au travail de recherche continuelle de l'auteur. Les traits d'esprit sont toujours aussi brillants mais ce ne sont plus des formules closes sur elles-mêmes, ils émergent d'un fond, plutôt laborieux, composé de réflexions, d'observations (aussi bien des mœurs de son époque que des observations scientifiques d'expériences de physique et mesures astronomiques), de lectures studieuses, de Kant et de Bacon ou de lecture critique de Lavater, d'annotations sur de multiples événements quotidiens (le mouvement des ombres sur les toits pendant le lever du soleil, le vol des oiseaux, la circulation dans Göttingen). Les "Brouillons" révèlent un esprit en constant état de veille, un homme toujours penché sur les choses. Ses états d'âmes, ses rêves sont aussi l'objet de descriptions précises ou d'examens sans concession qui prennent souvent une tournure humoristique : pour résumer une journée insatisfaisante, il se reproche son "indolence préméditée".
Lichtenberg n'a jamais cherché à donner une forme globale à l'énorme travail de notes accumulées pendant 30 ans (1765-1799), celles-ci peuvent paraître "décousues" et "fragmentaires", comme disent les critiques. On sait aujourd'hui que le fragment est devenu un genre littéraire, justement depuis qu'un des livres de Friedrich Schlegel qui a pour titre "Fragments", est considéré comme une sorte de manifeste pour les jeunes romantiques de la fin du XVIII e. Pour essayer de caractériser les "brouillons", et de voir comment Lichtenberg s'imprègne de son époque et en même temps s'en distingue, je vais m'arrêter sur une note très courte qui me semble révélatrice de la disposition d'esprit particulière de l'auteur, (je m'autorise ce choix arbitraire d'autant plus facilement qu'il est de toute façon impossible de résumer une œuvre de plus de 3000 pages).
"Un arc-en-ciel par la voie sèche" J 653
Dans un premier temps, le lecteur y verra une image qu'il qualifiera spontanément d'absurde, le sens commun associant l'arc-en-ciel à la pluie, et l'absurde étant le caractère déjà repéré par André Breton à propos du fameux "couteau sans lame auquel il manque un manche".
Dans un second temps, la note du traducteur permet d'en orienter le sens, elle nous indique que "la voie sèche" est une expression employée en alchimie par opposition à "la voie humide". Les alchimistes distinguent deux méthodes d'analyse des éléments, soit par combustion, réduction par le feu, la voie sèche, soit par dissolution dans un liquide, la voie humide. Lichtenberg était tellement intéressé par l'arc-en-ciel qu'il a envisagé de le reproduire.
"Ne pourrait-on-pas fondre de la grêle à partir du verre ; [...] On pourrait obtenir facilement des billes qui seraient des parois pour arcs-en-ciel." (J 1504).
Voilà donc, si on veut bien continuer à jouer avec l'auteur, ce qui représenterait un arc-en-ciel par la voie humide, basée sur le fait que les rayons du soleil sont réfractés en passant à travers les gouttes de pluie. Mais alors, à qui s'adresse "l'arc-en-ciel par la voie sèche" ? Je fais l'hypothèse qu'il vise les personnes qui ne connaissaient pas l'expérience de Newton de la décomposition de la lumière à travers un prisme, ou plutôt, les personnes qui ne voulaient pas reconnaître cette expérience et qui ont, comme Goethe par exemple, exprimé leur désaccord, leur opposition même, à cette nouvelle science. Goethe était très satisfait de sa propre théorie des couleurs, cependant, il confiait à Eckermann, à la fin de sa vie, qu'il n'arrivait toujours pas à expliquer le phénomène de l'arc-en-ciel, précisément. Sachant, par ailleurs que Lichtenberg n'a jamais vraiment répondu aux demandes de reconnaissance du poète qui cherchait à faire éditer ses recherches dans les journaux universitaires, connaissant également l'esprit taquin de notre scientifique, je ne peux m'empêcher de considérer "un arc-en-ciel par la voie sèche" comme un trait ironique. Puisque vous refusez les nouvelles conceptions scientifiques qui permettent de se représenter le phénomène de décomposition de la lumière, eh bien essayez donc d'expliquer ce phénomène par la bonne vieille méthode des alchimistes.
Au lecteur qui pense que je me suis un peu égaré dans cette interprétation, je rappelle que tous ces détours ont été provoqués par l'étrangeté de la note elle-même. D'abord une image troublante qui éveille l'attention, puis une formulation qui révèle un problème de méthode et enfin la possibilité d'un regard critique. Nous retrouvons là, condensées en un trait, l'imagination (du poète ?), puis la rigueur du scientifique expérimentateur et enfin l'ironie du pamphlétaire. Ces trois caractères ne représentent encore qu'une face du personnage, l'autre face est beaucoup moins enjouée. C'est le Lichtenberg qu'on pourrait qualifier de moraliste, dont les aphorismes se distinguent néanmoins des sentences de nos moralistes. Je retiendrai comme exemple, un sujet très particulier qui a préoccupé notre auteur, c'est la question du suicide (une trentaine d’occurrences dans les "Brouillons" proprement dits, plus, de nombreuses évocations d'une fin de vie souhaitée dans le journal intime, appelé cahier SK). La note J 1186 se termine ainsi :
" ... et si tu trouves quelque jour, le suicide supportable, c'est-à-dire que toutes tes raisons ne suffisent pas à t'en dissuader, alors il te sera aussi – permis."
Considérer le suicide, acte tabou s'il en est, comme une décision raisonnable, ce n'est pas simplement s'émanciper de la morale dominante, c'est aussi se distinguer de la forme passionnelle du suicide, mise à la mode à l'époque par le roman de Goethe "Les souffrances du Jeune Werther"; et c'est également se distinguer du "désir de la mort" exprimé par Novalis dans "Hymnes à la nuit" où le poète souhaite "descendre enfin vers l'adorable fiancée" qui est morte précocement. Je pourrais me contenter de voir dans cette note de Lichtenberg le résultat de la tradition du "libre examen" protestant, conforté par la culture rationaliste naissante, mais l'infatigable diablotin me réveille aussitôt par cette déclaration :
" Se métamorphoser en bœuf n'est pas encore un suicide" D 169
Là encore, l'image est saisissante, elle me trouble plus qu'elle ne m'éclaire et m'oblige à m'interroger. Je ne prendrai pas le risque de chercher à qui elle s'adresse, je laisse ce plaisir aux lecteurs à qui je propose cependant, un moyen pour activer leurs réflexions. Dans une réunion de famille, par exemple, au moment où les grands sujets de conversations s'épuisent, redressez-vous, dirigez votre regard vers le plafond, et déclamez : " Se métamorphoser en bœuf n'est pas encore un suicide". Sur une quinzaine de convives, il y en a toujours un qui se sentira visé. Effet garanti.
Ce texte est un hommage à Etienne Barilier qui nous a offert un monument.