Silvia Majerska, Blancs-seings par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
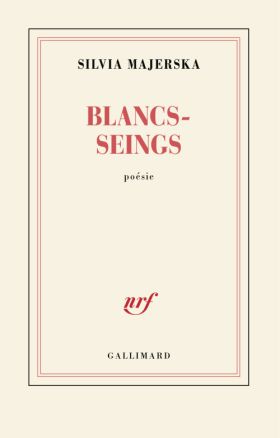
La quatrième de couverture propose une lecture des douze courts poèmes du livre ; chacun, en prose, occupe quelques pages, divisé en séquences précédées de chiffres romains ; aucun ne connaît la majuscule et la ponctuation est réduite au minimum. Chaque poème est consacré à une plante dont le nom en latin est donné en titre. Des éléments nés d’une vision personnelle alternent avec d’autres extérieurs et le tout est éloigné du (triste !) langage des fleurs tout autant que d’un discours sur un herbier. Il s’agit plutôt, comme l’écrit l’auteure, d’une « botanique intérieure » qui mêle constamment l’observation, celle que chacun pourrait faire, et l’imagination, qui transforme telle plante en être qui voit le monde. En exergue, une citation du Bon usage de Grévisse dit que l’astérisque (*) devant un mot signale une forme hypothétique, l’avertissement vaut ici pour le contenu qui suit le nom, pas pour la désignation en latin précédée de ce signe. La rose, fleur par excellence dans le monde occidental, ouvre le recueil.
La rose est reconnue comme le symbole de l’amour, culturellement très présente de la mythologie grecque et à la littérature, en France, du Moyen Âge à Ronsard et à Paul Éluard. C’est pourquoi elle est en ouverture, immédiatement identifiée bien que sous son nom latin, *Rosa. Ce qui n’est pas le cas des autres plantes du livre ; on lit d’ailleurs « il relèverait du miracle d’entrevoir tilia dans tilleul sans connaître un strict minimum de latin ». Le lien entre pinus et pin est encore lisible, comme peut-être celui entre viola et violette, mais l’ignorance de la langue morte ne permet pas de reconnaître dans Castanea, Trifolium, Taraxacum, Papaver, Bellis, Chamaemelum, Vitis et Lilium, respectivement Châtaigne, Trèfle, Pissenlit, Coquelicot, Pâquerette, Camomille, Vigne et Lys. On verra que c’est un motif, celui de la transformation, qui donne une unité particulière au livre : la rose aurait changé, de son passé violent (« sombre », avec ses piquants) au présent (fleur de l’amour), et elle change aussi de couleur hors de la nature.
Ici, la rose, comme vivante, « obéit : à la lumière, à la chaleur », et, avec les sentiments d’un humain, elle se comporte comme tel, douée de la faculté de rêver ; la narratrice comprend que les façons d’être d’un humain — comme la respiration — choquent la rose qui, elle, n’est pas soumise à l’air. La rose peut être transformée par la génétique et la dernière partie du poème rapporte qu’est née une rose bleue (précisément bleu violacé, bleu lavande) dans les laboratoires japonais, transformation destructrice d’un élément de la nature et de sa charge symbolique, de l’imaginaire qui lui est attaché. Toutes les plantes réunies dans Blancs-seings se modifient, chacune à sa manière ; pour les arbres ils grandissent et gardent quelque chose de leur histoire ; la châtaigne, qui semblait dans sa « cuirasse polie » avoir fait « vœu de silence » explose au sol ; le latex du pissenlit est comme du sang ; le pavot ressemble à une marmite, à une jupe et semble lié au feu ; la grappe de la vigne semble un fleur de glycine ; le poème consacré à la violette se termine par un palindrome, attribué parfois à Virgile et choisi comme titre par Guy Debord pour titre d’un de ses films, In girum imus nocte ecce et consumimur igni, « nous tournons dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu ». Pour la camomille,
« et pareil à l’eau chaude que nous versons sur les fleurs desséchées dans le but de ressusciter les cités perdues au fond de nos infusions,
la mémoire insuffle au passé recroquevillé dans le bol de l’esprit ses anciennes courbes et couleurs.
Il s’agit bien sûr d’une construction de l’imagination qui fait penser à la perception d’un bâton dans l’eau : nous ne voyons pas alors la réalité, déformée, ce que développe la fin du poème. On n’oublie pas non plus que le lys par sa blancheur s’apparente à la perle et le poème s’achève avec une explication détaillée à propos de la formation d’une perle dans l’huître, lieu par excellence de la transformation.
Une partie de la page (de chaque poème) reste blanche, comme un blanc-seing, en ce sens que l’on doit combler ce qui n’est pas explicitement donné à la lecture : les mouvements de transformation, de changement qui affectent chaque plante, preuve qu’elle est vivante. Ces douze courts poèmes le disent superbement.