Henri Droguet, Petits arrangements avec les mots par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
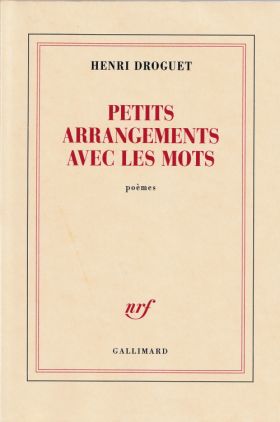
L’arrangement avec les mots commence avec le titre, une note finale indique qu’il est un « écho, et un hommage au beau film de Pascale Ferran, Petits arrangements avec les morts (1994) ». Il se poursuit avec les titres des quatre divisions, à peu près égales, du livre, tous à double sens : "À la lettre" (15 poèmes), "Main courante" (16), "État des lieux" (16), "Veille de nuit" (17), et il est présent du début à la fin. Il ne fait pas oublier les personnages du livre, récurrents dans la poésie d’Henri Droguet, la nature et les manifestations des éléments, la mer, le vent, la pluie, les plantes, les animaux. Cet univers appartient à l’anthropocène, nommé par dérision dans le premier poème « l’antre aux peaux saines » ; pourtant, l’homme, presque toujours anonymisé (un « quidam », un « passant », « quelqu’un »), y tient peu de place et ses actions, sauf celles d’un enfant, sont surtout du côté du chaos. À partir de cet ensemble, est mis en œuvre le programme esquissé en quatrième de couverture, « joie des mots », « fête du langage », soit jeux avec les significations, la morphologie, la syntaxe et la prononciation, qui n’empêchent pas que « la gravité n’est pas absente ».
Le livre débute par ce qui est lu habituellement à la fin d’un écrit, non un post-scriptum mais trois. Le premier exclut temps et espace : « Ni les jours ni les nuits ce n’est / ni soir ni matin c’est la cendre / comme un gouffre et le rien défait » ; la mer et le vent sont dans le désordre et la destruction dans un mouvement qui ne cesse jamais — « sans début / ni fin » — et qui est indéfiniment nourri, du ruisseau vers le fleuve et lui-même vers la mer, tout comme l’aube ne conduit qu’à la nuit. Tout semble se défaire, être voué à la disparition, la belle cétoine peut ravir le regard par ses couleurs mais quand elle « sort du cœur de la rose (…) elle se hâte sans savoir vers sa fin ». La ruine et la mort sont souvent proches, presque toujours liées à une violence ordinaire ; ainsi l’image du corbeau se nourrissant de charogne revient à intervalles réguliers (trois fois) et le bruit même du bec dans la chair morte est restitué, « soc soc soc » ou « toc toc toc » quand il « pioche (…) le désordre d’une entraille bleue », d’« une bidoche désassemblée corrompue ». Seules semblent échapper au désastre les plantes et la faune bien présentes, longuement énumérées : « spergulaire, séneçon, carotte à gomme, vergne, oseille, la belle ombelle, roselière, coudrier, aubépine ; chiens courants, reptile trigonocéphale, lièvre, merle, freux, fauvette » ; ajoutons un oiseau qui « cuicuite quelque part ».
Seul ici le chien courant rappelle un peu l’existence de l’homme dont les travaux et créations sont ignorés ou dépréciés, ainsi un produit tiré de la nature et un outil pour la transformer :
froment pétrifié mauvais pain mauvais
fagot écrasé cabossé
un talus épineux farouche
digère lentement une charrue multisocs
hors d’âge disloquée
Cette nature ne peut que difficilement convenir à l’homme (« l’inouï presque rien ») qui n’agit que pour la changer et parle sans cesse quand il lui faudrait se taire ; il cherche toujours « quelqu’un à qui qui parler ». Il est le « passant » dont les interventions apparaissent inutiles, « viande à Dieu / vautrée /[qui] chante le temps m’enfuit / braille et bée barbouille », qui ne comprend pas qu’il lui faudrait laisser ses fausses œuvres, partir vers la mer « nourricière », « vrai et beau refuge pour aller plus loin / nulle part encore et partout », se diriger vers un ailleurs dont on ne saura rien, sinon qu’« on sera loin / très loin / une fois pour toutes », et délivré au moins provisoirement d’une vie qui n’a pas de but. Les travaux humains n’aboutissent qu’à des constructions provisoires qui se défont plus ou moins rapidement ; pour Henri Droguet, alors qu’il insiste sur la permanence des mouvements et bruits de la nature, toujours semblables, les gestes de l’homme sont à côté de ce qu’il lui faudrait faire : rien n’est dans la durée, y compris les animaux qu’il pensait avoir maîtrisés :
un chemin compliqué se perd (…)
un moulin bat de l’aile (…)
plus bas dans une forge effondrée (…)
des chiens rouges hurlent clabaudent
cherchent qui dévorer
Cependant le lecteur n’est pas dans un univers du désespoir. Certes, « l’infini chaos », « l’informe abîme n’accueille ni / parole ni /rien », et il est bien là ; reste à en sortir autrement que par la fuite au bout du monde, qui ne changera rien. La vraie sortie, c’est l’enfant qui la connaît, il est « l’autre sans trace ni visage / étranger rebelle qui rêvasse encore » ; sans passé, n’étant donc pas devenu le « faramineux déchet » qu’est l’adulte, il rêve, « chante », « poursuit ses romances », « dans l’herbe court après les nuages » ; il « rêve entre deux portes », soit dans une situation des plus instables, et s’il oublie ses rêves il en reprend d’autres très vite. Henri Droguet rappelle que « l’enfance [est] sans parole » — enfant continue le latin infans « qui ne parle pas » —, mais « il ânonne la stupeur l’amour / seul l’amour / et le reste s’est perdu » — il se trouve encore, l’enfance passée, quelques hommes pour vivre « l’amour toujours / inlassablement l’abandon ». Pour ne pas quitter l’enfance, heureuse proximité des prononciations qui permet de parler de « je d’enfant », comme si l’identité était attachée au jeu.
Le jeu, la fête du langage sont en accord avec le chaos : ils sont partout, et d’abord dans la composition ; on l’a vu avec les titres pour les divisions du livre et les poèmes, il faut ajouter dans ce domaine "roman", qui n’en a aucun des caractères, "envoi", "fable", etc. À côté de citations de Victor Hugo, Jean Follain, d’autres non traduites (Coleridge, Dante, Milton) mettent en cause l’ordre du livre, comme l’emploi de l’italique, de capitales et de polices différentes. Il faudrait s’intéresser aux allusions littéraires, sans doute nombreuses ; par exemple, « un grenier où manque la neige » fait penser au passage d’un poème de Reverdy, : « j’écrivais dans un grenier / où la neige en tombant par / les fentes du toit devenait / bleue ». Chaos encore dans ce qui paraît stable dans la langue, les mots pour dire la position dans le temps ; ainsi le tombier — qui creuse les tombes — chantonne « demain / je t’aime hier je t’aimerai encore / toujours et déjà je t’aimais ». Henti Droguet accroît peu le lexique et ses créations sont aisément intégrables comme « grenaillu » ou « tombier », mais il emploie des mots régionaux ou techniques comme « drache », « grouin » ou « mégie » ; beaucoup plus courantes sont les assonances, allitérations, homonymes et paronomases : « Petit petit piètre piéton poieton », « la mer mégère magie mégie », « une averse herse », « orage opéra », « il dément déman / tibule », « qui franchit surgit rugit mugit ; conquis (qu’on dit », etc. Un mot familier voisine avec un énoncé "recherché" : « il lansquine » à côté de « l’indécise beauté / l’argent crispé des saules ». L’emploi au singulier de « entraille » est rarissime, mais on le lit par exemple chez Baudelaire, Giono et Valéry. On n’oubliera pas les nombreuses accumulations d’adjectifs ou/et de verbes qui donnent le sentiment d’un trop plein, comme si le texte débordait :
l’eau cabossée sauvage dévalante merveille
à son bouillon turbulent phosphoreux
sa tambouille ratatouille
chevelu parloir à tout faire et défaire
qui simultanément divague
fauche écorche bronche
vague désosse chuinte rince
happe râpe ponce
berce caresse
prémédite
Cet arrangement foisonnant se relit et le plaisir des jeux dans la langue ne faiblit pas ; on se laisse « prendre au je » et l’on reconnaît plus aisément aussi une dimension plus sombre du texte en suivant « l’homme instable » qui fuit le silence, en retrouvant « le modeste réel ».