Yves Boudier, Œuvres poétiques, tome 1 par Didier Cahen
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
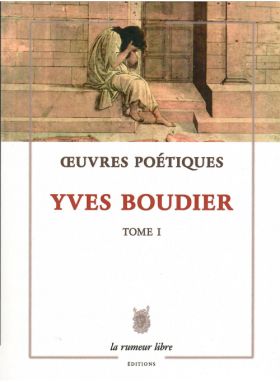
In fine (la vie désagrégée)
On connaît Yves Boudier, l'homme public, ses engagements multiples dans le monde des lettres et de la littérature. Après quelques décennies d'enseignement à l'université de Cergy-Pontoise, Boudier choisit d'autres formes d'aventures qui le mèneront à la présidence de la Maison des écrivains et de la littérature (de 2012 à 2015) puis à la présidence du Marché de la poésie (depuis 2015). En parallèle, Yves Boudier poursuit un travail (de) critique (Action poétique, Passage d'encres) qui répond à un profond désir : faire circuler, connaître, aimer les livres de poésie les plus imprévisibles, les plus risqués, souvent les moins « aimables ». Ses articles exigeants traduisent une façon bien à lui d’en déplier les pages avec des mots pesés, pensés, une attention toute minutieuse au texte et cette pédagogie qui a toujours nourri son travail d'enseignant et de poète (difficile de séparer l'un de l'autre).
Certes, le poète se montre plus discret, peut-être plus secret. La publication du tome 1 de ses «Œuvres poétiques » permet de mieux saisir la teneur d'un travail dont la nécessité tient d'abord au cours tempêtueux de la vie. Le recueil publié par La rumeur libre rassemble quatre volumes parus entre 2003 et 2012 : Là, fins, Vanités Carré misère avec un propos liminaire de Michel Deguy et Consolatio accompagné d'une forte mise en perspective de Martin Rueff. Rueff lui-même poète, philosophe, essayiste résume de façon saisissante le comment et le pourquoi de cette tétralogie : « Un carré. Le carré de la mort. La mort au carré » ; puis il précise son hypothèse qui traduit amplement l'ambition d'Yves Boudier : « un carré permettrait de relier mortalité, langage, politique, poésie ». Multipliant les analyses savantes et incisives, c'est aussi l'univers culturel du poète qu'il entend défricher. On mesure mieux ainsi combien la poésie archi-contemporaine d'Yves Boudier assume d'abord un héritage : Villon en éclaireur et la grande tradition de la « consolation » de Sénèque à Boèce et de Malherbe à Deguy. Rueff précise encore : « Consolatio s'ouvre sur une citation de Sénèque. Comme dans Vanités Carré misère, le poète s'inscrit dans une tradition : il la reprend, la rend possible, l’ouvre à la répétition et à la méditation ». « Je ronge/le temps usé » - tout aussi bien « je range » - risque Boudier dans un de ses raccourcis dont il a le secret, avec toujours cette même hantise bien soulignée par Michel Deguy : comment le poème peut-il faire et se faire ? Comment le poème peut-il se faire poème et nous « opportuner » au-delà même de son être de chair, de mots, de langue ?
Relisant ces poèmes cultivés dans tous les sens du terme, on est bouleversé, étreint par l'émotion première, mais davantage encore saisi par la touche du lointain qui échappe au poète : « Vu le monde basculer (…) L’abîme/de part en part//On dirait/ que la neige agonise ». Décrite avec des mots choisis en 4e de couverture, l'économie du livre est parfaitement lisible : Là mesure « l'écoulement du monde » et le déracinement des mois au moment de la perte – « La mort d'une mère est le premier chagrin que l'on pleure sans elle (Augustin) ». fins touche à l'impensable et aux confins de notre condition, avec cette seule question : comment se confronter à l'aporie majeure ? Comment (ré)concilier l'impossibilité et l'absolue nécessité de dire, comme dire se doit, l'horreur des guerres et des massacres puissamment orchestrés qui ont gangrené le 20e siècle ? Boudier déplie cette réponse opposable qui tient en quelques mots à peine : « écrire : mo(r)t : penser ». Le texte le plus développé, Vanités Carré misère, se concentre sur « l'impact(e) » de la mort dans notre quotidien. On y retrouve l'esprit et le répondant de « La ballade des pendus » de Villon puisque tout part de maraudes bien réelles, et tout se termine avec le mince espoir de sauver dans le corps du poème la vie désagrégée des sans-abris, migrants et autres laissés-pour-compte de notre société. Un peu à part, Consolatio simule la fin des fins… Tout en jouant la carte de l'apaisement, Boudier assume le déchirement en confiant aux lecteurs sa condition de mortel : « quand au bord/endormi// je ronge/le temps usé// me crie : tendre le corps/où//ça/mord dans la tête ».
Clairement, pour dire la mort sous toutes ses formes et dans tous ses états, Boudier choisit de ne pas choisir : au-delà des querelles entre anciens et modernes, sa poésie se veut intensément lyrique et puissamment formelle. Il faudrait prendre le temps de s'arrêter sur un dispositif qui se substitue à la grammaire figée pour nous parler autrement qu'en parlant et nous ouvrir les yeux. En vérité Boudier laisse au lecteur le soin de conjuguer ensemble savoir et non-savoir, silence de l'écriture et science de la lettre. A nous lecteurs d'entendre… la rumeur libre et de répondre à sa manière d'écrire et d'avancer : où le réel fournit le matériau et des éclats de matière première buvables et/où imbuvable, la langue ourdit son articulation, confiant l'usage de la parole à moins que « la terreur syntaxe ». Il faudrait répéter, autant que faire se peut, réciter mot à mot, un livre (d)écrit avec sa géométrie colorée – « (un vaste carré/bombé)//l'angle rouge/le sable/noir » - mieux mesurer le poids des blancs, du vide – « quelques grammes/de poussière » - relever sa gravité qui lui permet d’abord de rester les pieds sur terre : « quand vient son tour/de naufrager//descendre/au fond// plus encore/au fond//vers la fosse// des vivants à rayures ». D'où cette « rapidité de la langue », sa belle respiration avec ses résidus : « des images/pour ne pas rester nu », des images dessinées dans la page, incrustées dans le texte, des images figurales, fort peu figuratives qui déchireront alors les lignes tracées d'avance. Quoi d'autre pour traquer dans le texte « les écoulements d'horreur », ne conserver que les lambeaux de sens les plus parlants et les plus percutants, « atteindre la dépersonne » (sic) ? Et comme dans tout poème, tout vrai poème (osons !), au-delà de cette poésie dont Yves Boudier avoue ne trop savoir que faire, on est saisi, touché puis franchement emporté. D'où ce fait brut qui confond le lecteur : on le comprend à demi-mots, on accompagne Boudier dans les zones grises de la mort et de la vie, à la limite d'une parole interdite. On l'écoute, on l'entend, partageant in fine tout le désir-complexe qui le pousse à écrire.