Le Cas Lambert par Paul Echinard-Garin
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
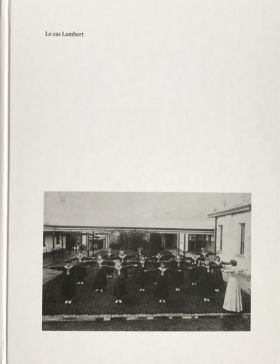
Théorie et pratique de la « balzacotypie »
> On connaît bien désormais la méthode d’Aby Warburg qui visait à exposer – pour une exposition comme pour une conférence avec diaporama – par la mise en relation de plusieurs images a priori hétérogènes. Cette « pensée intermédiale » (Philippe Despoix) pouvait d’ailleurs intégrer des documents textuels : cette méthodologie pourrait bien présider au volume Le Cas Lambert, qu’ont mis au point les éditions du Lampadaire et Sophie Saulnier.
>Dans cet ouvrage, en effet, au format d’étonnant catalogue, les images le disputent aux textes : la première partie reproduit, dans la version du Furne corrigé, l’« étude philosophique » Louis Lambert sur laquelle Balzac travailla plus de dix ans. Ensuite, le volume présente des sortes de prolongements du récit balzacien, comme des fragments à verser au dossier – le texte du romancier se présentait d’ailleurs déjà comme une collecte de documents, contrepoints d’une première partie narrative à propos de la période collégienne des deux personnages. De même que le narrateur balzacien veillait à préserver des pièces à conviction, de la manie peut-être, en tout cas des documents qui attesteraient la singularité du personnage éponyme – lettres à l’oncle et à l’aimée Pauline, d’abord, mais surtout ensuite « paroles » prélevées par cette dernière –, le nouveau montage prolonge le geste balzacien. Car, comme l’indique le titre, c’est « le cas Lambert » qui intéresse l’enquête : une section cite en premier lieu les lectures successives et contradictoires du vingtième siècle qui ressortissent à une forme d’extrapolation, en prenant Lambert pour un personnage réel, pour le paradigme d’un « dément précoce » ou du schizophrène. Il s’agit de présenter les preuves du contresens d’une lecture partiale, celle par exemple de la « névrose électrique » dont Louis Lambert serait la première évocation – ou d’un Lambert double de Balzac, interprétation que le malicieux commentaire retiendra plus loin, comme s’il s’agissait du « vrai soi de Balzac ». Considérer Lambert comme une personne réelle revient à prendre une physionomie pour preuve d’une maladie : comme ces deux opérations réduisent considérablement le problème, la solution préconisée ici est celle de la profusion des images, afin d’éviter toute lecture partielle. À cette fin, les proses qui accompagnaient à l’origine les images, formes de développements fictionnels qui les faisaient mentir, se trouvent écartées de leurs référents – ainsi nous invitera-t-on à lire, sans les modèles, une « anthologie d’existences » composée des descriptions cliniques des aliénistes Esquirol et Henri Dagonet. Plus encore, de même que les images sont proposées sans leur légende, le matériau documentaire des commentateurs comme de la correspondance de Balzac ou de sa sœur Laure Surville truffent les « interpolations » sans démarcation typographique. Tout cela rend justice à Balzac : n’avait-il pas lui-même procédé à divers remaniements, pour « corriger » Lambert, le faire « grandir », lui « donner un coup de peigne » ? Ces divers allongeails étaient une invitation heuristique : ils préméditaient les « suites » effectivement appelées à prolonger la fiction balzacienne.
Ainsi certains documents présentés jouent jusqu’à l’absurde le jeu des rapprochements d’un individu et d’autres qui ne serviraient qu’à le perdre parmi la foule des déments et cataleptiques. Le récit balzacien alimentait déjà la thématique du double en faisant dialoguer le narrateur et le personnage éponyme, qui soutenait lui-même la dualité des êtres selon Swedenborg, avant de développer une thèse proche de celle de Bichat et de voir dans le sommeil la manifestation d’un être intérieur : Balzac s’exerçait à redoubler ces deux « créatures distinctes » en faisant du narrateur – quasi-amoureux de l’ange qu’il reconnaissait en son condisciple et qu’il dépeint de nombreuses fois sous des traits féminins – un de ses miroirs possibles. Le volume procède donc à une démultiplication, fondée sur les portraits incohérents du protagoniste : sa description physique dans la première partie ne peut en effet guère coïncider avec la pose ultime en cataleptique – mais Balzac est coutumier de ce type d’associations, dont témoignent entre autres les collages de La Femme de trente ans. Le Cas Lambert s’amuse par conséquent à composer à son tour une anthologie de portraits, pour un anti-portrait-robot du personnage ou des types qu’il est censé représenter. La « balzacotypie » (« cette grande machine à fixer les états invisibles du réel », p. 271) permet de noyer Lambert dans des images autres, en proposant une multiplicité d’incarnations de la course effrénée de ses pensées. Sont donc convoquées d’hétéroclites références : les autoportraits réalisés par Marcel Bascoulard, dont toute une série effectue ici la transition entre le roman de Balzac et la « partie études » ; le film Memories Of Murder dans une note, clin d’œil aux « criminels » répertoriés par un Lombroso adepte de la physiognomonie. Le Cas Lambert documente également l’usage des images d’aliénés, depuis les 200 dessins qu’Esquirol (évoqué justement par Balzac, pour avoir examiné Lambert sans parvenir, bien sûr, à le guérir) fait réaliser pour les assortir d’une analyse clinique et les classer dans un « atlas » indépendant, jusqu’à la série de clichés commandée par Charcot pour La Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, en passant par le modèle de Duchenne de Boulogne et l’« iconographie photographique des centres nerveux », dans laquelle le Dr Luys avait cru bon de découper des cerveaux « à titre de recherches sur le système nerveux ». Dans cette collection, on retrouve incidemment Balzac : la « pose cataleptique » qu’obtient tel photographe d’un sujet hypnotisé est aussi celle que l’adepte du daguerréotype donne à son personnage lors de sa dernière rencontre avec le narrateur.
Signalons enfin la remarquable postface (car jusque-là il ne s’agissait surtout pas de donner une cohérence trop sensible au disparate) de Julie Cheminaud, qui remet de l’ordre en explicitant la cohérence de la confrontation – qu’il ne s’agit pas de vouloir résoudre, ou dissoudre – des images et des textes, et apporte l’éclairage des travaux de Foucault et Didi-Huberman.
Ce sont donc là des matériaux passionnants qui nous apprennent encore à lire et à voir – car on sait depuis M. Teste, succédané de Louis Lambert, que seul un personnage est capable de la gageure de toujours penser : nous, pauvres lecteurs, en sommes réduits à imaginer et à scruter l’altérité des images.