Le Fouet de l’âme ou le rire édifiant par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
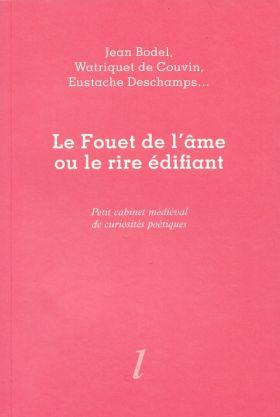
Jean Bodel, Watriquet de Couvin, Eustache Deschamps… : Petit cabinet médiéval de curiosités poétiques
Ce livre « est une bombe. Tout simplement ». C’est Pacôme Thiellement qui le dit en préface, et il sait de quoi il parle : les Fatras de Raimondin et Watriquet de Couvin manient un fouet dont la pointe atteint l’âme comme celle du sabre frôle le ventre : leur « humour absurde scabreux » annonce « presque Hara-Kiri », dont les meilleurs dessinateurs apprécieraient les lettres historiées de Marie Lefèvre. Et le « chef-d’œuvre de Bertrand Rouziès-Léonardi », qui traduit et commente aussi dans ce volume Jean Bodel, Eustache Deschamps, et quelques anonymes, évoque pour l’auteur de Économie eskimo – Le rêve de Franck Zappa, le musicien humoriste, dont il cite le descriptif de son film Uncle Meat : il s’agissait de prouver qu’au XXe siècle, il y avait « des gens qui ne pensaient ni ne vivaient comme les caricatures en plastique qui survivent en vue de nous représenter dans les rediffusions télévisuelles ou dans les livres d’Histoire ». De même, cet « âge de mille ans / Dont on n’a pas fini de tirer les bilans », ces « temps où les maçons étaient maïtres », ce « Moyen Âge frais, qui mord comme une eau vive », évoqué par Rouziès-Léonardi qui nous met cette eau à la bouche, manie comme Rabelais, Scarron, et « plus tard Alfred Jarry, Alphonse Allais, Raymond Queneau, Cavanna, Delfeil de Ton », le comique comme une « matière toujours plus ou moins considérée comme dangereuse : politiquement, spirituellement, culturellement ». De la bombe, oui.
Jean Bodel d’Arras, qui vécut sous le règne de Philippe II (1180-1223), écrivit « la première pièce non liturgique de notre littérature », Le Jeu de Saint Nicolas, et après avoir contracté la lèpre, les premiers Congés, « qui lancèrent la poésie personnelle ». Son fabliau Envie de vits (Li Sohaiz des vez) prend en compte, par les voies pré-freudiennes du rêve, le fait « que les femmes ont une sexualité, des besoins et des fantasmes ». Le poète empiète « sur les plates-bandes du confesseur ». Comme Marie Lefèvre, il leur préfère peut-être les bandes dessinées. Bertrand Rouziès-Léonardi rappelle que « le premier imagier ésopique médiéval n’est pas tant attaché à une œuvre textuelle » (celle de Marie de France, dont le fablier fut oublié par La Fontaine) « qu’à une œuvre textile, la Tapisserie de Bayeux » qui évoque « neuf fables classiques », et avant elle les « copies de fables de Phèdre par le moine et chroniqueur Adémar de Cabannes dans le manuscrit de Leyde, Vss. Lat. 8°, 15, daté d’avant 1033 », qui ont influencé « des isopets ultérieurs, à quelques variantes près ». Les fables anonymes de l’Isopet II de Paris ont été composées à la charnière des XIIIe et XIVe siècles. La Tapisserie de Bayeux illustre « parfaitement » la « plasticité du sens de la fable dans ses résonances avec l’actualité », certains poèmes comportant « deux moralités, dans une ambivalence assumée ».
Comme les fables, et comme l’Histoire comique des Etats et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac, les fatras sont « le véhicule d’une charge satirique bien consciente », et dissimulent une « masse critique d’impertinence sérieuse ». Leur « jeu de cour », considéré par Christine de Pizan comme une « fête (…) au coin du feu », a « d’abord été un jeu de camp ». Rouziès Léonardi relève, dans ceux de Raimondin et Watriquet de Couvin, une référence scatologique aux grossesses de Jeanne de Navarre, qui « ne produisirent rien de durable », une allusion au traité d’entraide entre la France et l’Ecosse, une autre au rattachement du comté du Dauphiné à la couronne de France. La citation latine d’un motet du Roman de Fauvel, « Règnent aujourd’hui, sur les trônes du siècle, la fraude et la rapine », inscrit le fatras dans les pas « de l’admonitio regum, l’avertissement au prince ».
Avant Christine de Pizan, « plus jeune que lui de vingt ans, qu’il connut et admira », Eustache Deschamps fut le « grand maître de la Ballade », à la fois prolixe et amoureux des « formes condensées ». Son « Art du dictié premier art poétique français », qui distingue musique « naturelle », langagière, et musique « artificielle », instrumentale, procède à un « annoblissement du langage sur la base de ses ressources propres », en préfigurant Rousseau, Ghil, et les poètes sonores. Son poème dialogué Farce de maître Trubert et d’Antrognart annonce, à la fin du XIVe siècle, « la célèbre Farce de maître Pathelin, écrite au siècle suivant ». Le prénom de l’avocat est emprunté par Deschamps à « un sulfureux fabliau du XIIIe siècle, Trubert de Douin de Lavesne, également traduit et présenté par Bertrand Rouziès-Léonardi, publié par Lurlure en 2019. À la fin, l’avocat est nu comme l’empereur d’Andersen.
Si Trubert, « le plus long fabliau de notre littérature française », est « digne du film Sacré Graal ! des Monty Python », la farce anonyme de la fin du XVe siècle Le Monologue du franc-archer de Bagnolet (avec son Épitaphe), met en scène « un matamore français ou, plus exactement, un "matanglois" », les « liens matrimoniaux particulièrement emmêlés des grandes familles aristocratiques » et la « présence déjà ancienne des Anglais sur le continent », faisant de la guerre de Cent Ans « une guerre civile », plutôt « qu’une guerre entre nations au sens moderne ». Pernet le franc-archer ressemble au couteau de Lichtenberg : il n’est ni franc, ni archer. Incorporés durant la Guerre du Bien Public pour répondre à la supériorité des archers anglais, ceux qu’on a aussi appelés « francs-taupins » parce qu’ils étaient « réputés rentrer dans leur trou » au « moindre bruit de bataille », se sont distingués « par leur indiscipline, leur vantardise, leur propension au pillage ». La seule représentation sourcée du Monologue eut lieu à Lille, le 5 août 1526. Rabelais le « connaissait par cœur ». Il fut « longtemps attribué à François Villon », dont les premiers éditeurs, « encourageant une forme d’imposture littéraire bien dans le ton du Monologue », l’ont « placé dans la suite des œuvres complètes du Maître ». Ils seront suivis par ceux du XVIIIe siècle. « On en est revenus depuis », mais rôde encore en Pernet le franc-archer le fantôme d’ « un coquillard », et avec lui celui de livres, de poèmes dont on ne se remet pas.