Filles bleues d’Ivar Ch’Vavar par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
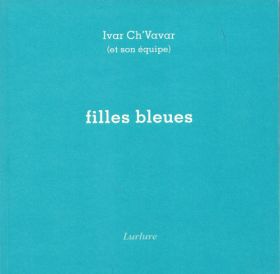
Cela pourrait s’appeler « Jeunes filles au bord de la mer », comme la deuxième partie de À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Ici, plus d’ombre que de fleurs. Plus de minéral, livré aux éléments, à leurs « forces irrésistibles » proclamées par le vent, que de végétal. Ce sont des filles du feu, désignées par leur prénom comme celles de Nerval, autant que de l’eau et du sable. Des sirènes ardentes. Et ce sont des mers. « Car chacune de ces Mers ne restait pas plus qu’un jour », écrivait Proust. Et « je ne vis jamais deux fois la même ». Les pages carrées du livre édité par Lurlure sont des tableaux, comme « les parties différentes du couchant, exposées dans les glaces des bibliothèques basses en acajou qui couraient le long des murs » de la chambre, à Balbec. À Berck, « la mer tourne ses pages / sur une plage blanche comme de la cendre », écrit Ch’Vavar dont les tableaux sont moins impressionnistes que psychédéliques : « Des gamines pâlottes extirpent de glacières / Des couleurs électriques, qu’on voit passer dans l’air ». Des « strings incitatifs » sont « comme saupoudrés de sucre glace », les « touffes d’herbe » ont « l’exubérance pubienne ». Les couleurs sont « sorties du tube toutes vraies », même si le beige est « la couleur de base ». On a « le pils dans l’coco », autrement dit : « ah ! cet acid ! ». Et le « vacarme » de la mer devient « étourdissant à cause de la substance que nous avions absorbée », on dirait même « que les pils étaient surdosées ».
« C’est l’ombre qui l’est, bleue », celle des cabines de plage. Y « bleuit l’urine accroupie ». Le hâle « presque bleu sur le sable de la / Plage de Stella » est celui d’une « beauté bleutée ». La peau des « jeunes baigneuses » est « presque bleue et leurs yeux / vides, suavement chassieux ». On se moque un peu de Mallarmé, « —C’est l’azur, l’azur —c’est l’azur », mais on cite Alin Anseew : « le bleu est plus grand que la mer ». Et le soleil ? noir. « éclaboussées d’ombre », nos têtes tremblent « sous l’onction fade / Du savon noir (ici on dit Zièpe) / Du jour maudit. Car c’est un caveau, le soleil », une « tombe sur orbite ». Or des « nouveaux vers de la mort ». Mort, « j’adhère et j’adore (…) Je vois la bouche d’or et merde.—Je vois l’universel derrière.— (…) Je suis mort./ Tout est fin prêt ».
C’est de la peinture et c’est de la musique. Rythmes, souvent syncopés (enjambements et rejets, mots coupés, tirets), chants entre récitatif et grand air, assonances et consonances. Dans une litanie à Lucie, « fumée » appelle « fumelle ». Ailleurs, « comètes » appelle « gamètes », Iseult derrière un voile évoque Isis. Quand « des choses » étincellent, « des chaises » roulent. Le v fait à la fois son et image : « les v inversés de leurs jambes » marchent « parallèlement à / leur pauvre et grave bavardage ». Konrad Schmitt cite Lou Reed, Franck Zappa, Patty Smith. La « sirène grise » est celle des pompiers, Johnny Winter « l’albinos fou » accompagne « une plage blanche ».
« Filles bleues » comme des steaks ? C’est cru. « Nous lorgnons ton entrejambe de jean (…) / Nous marchons dans ton cérumen —nous venons nous prendre / Au papier tue-mouche de ton étalage innocent —nous nous / Vautrons dans la porcherie de ta beauté ». Quand Marcelle, pour « la toute première fois », serre « un chibre » dans le poing, elle sent « la puissance. Oui, comme un sceptre ». Puissance de celui qui le détient, ou de celle qui le tient, le retient ? Réponse un peu plus bas : « je tiens le contremaître / quand je veux, par les couilles ». En des quatrains rimés, le chant de Soprane est celui d’une « fille toute crue, encor scandaleusement crue ». Ch’Vavar n’est pas Bataille. Il n’aime pas le mot « érotisme ». Evelyne « Salope » Nourtier, à la fois personnage et « autrice », est l’une des solistes du chœur, au même titre que « Notre-Demoiselle-des-sables, très grande jeune fille », qui « domine le m / onde et scrute le soleil à sa hauteur, / (…) Très fixe est le regard de Marie et son ombre —colossale ». Et « sa miséricorde reluit comme un mirage ».
La mer toujours revient sur ses pas. Ivar aussi. L’éternité, n’est-ce pas « l’éternel retour » ? « Retrouvée » dans le poème rimbaldien, elle est toujours neuve. De même, le cycle maritime de Ch’Vavar, opposable à son cycle rural comme Balbec l’est à Combray. L’éditeur Emmanuel Caroux lui avait demandé de rééditer ses « recueils ruraux » du temps de L’Invention de la Picardie : Couleurs cyclistes, Jours de glaire et Bander en automne. Ivar a d’abord opté pour une sélection sous forme de plaquettes de 62 pages (référence au département du Pas de Calais et aux albums de Tintin), sous le titre Feuillées d’Hypnos (« hommage » irrévérencieux à René Char) puis, comme le précise l’un de ses hétéronymes, Alix Tassememouille, fut « ramené à Berck, sa ville natale, par un questionnement de Mathieu Jung (sur le poème berckois de Sylvia Plath) », et redisposa « les éléments » de sa production « non pas rurale, mais maritime », dans un « grand ensemble » complété par des notes nécessaires à une « bonne compréhension ». Avec ses mouettes et ses jeunes filles comme avec celles de Proust, « la touche de / l’intermittence est pressée sur le clavier de l’éternité ».