Sonnets, Giacomo da Lentini (2) par Christian Travaux
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
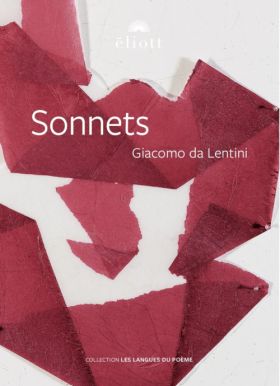
Du nouveau se trouve dans l’ancien, qui n’a pas été perçu.
Jacques Roubaud
Le sonnet est une contrainte. Contrainte des vers et contrainte de la rime, puisqu’il faut 14 vers (même s’il existe des sonnets courts, comme chez Hopkins, ou longs, des sursonnets, comme chez Goffette), répartis obligatoirement en un huitain et un sizain, et des rimes, les mêmes en quatrains, et d’autres en tercets. Dire l’amour, dans ces conditions, peut sembler artificiel, tant l’émotion paraît bridée, et froide, distante, pur jeu d’esprit, la confidence sentimentale. Il n’en est rien. Et Giacomo da Lentini, dans ses Sonnets, en est la preuve. Par cette forme qu’il fixe pour la postérité, il montre combien la poésie a à gagner d’user d’une langue à ses limites, à son sommet, pour dire ce qui dépasse l’être, l’amour, et le porte au-delà de lui, afin d’atteindre la quintessence de ce qui « meut le Soleil et les autres étoiles », comme disait Dante.
22 sonnets. C’est ce qu’a laissé ce poète du 13e siècle, Giacomo da Lentini, mort avant même que naisse Dante. 22 sonnets. Sans doute, le plus grand corpus de rime que la tradition a conservé de l’école sicilienne. À Palerme, l’empereur Frédéric II promeut une poésie lyrique d’inspiration profane, mais en langue vernaculaire. Il veut donner à ses États un certain prestige, une marque reconnaissable, en se détournant du latin, du provençal des troubadours, de l’ancien français des trouvères. Et Giacomo da Lentini, dans ce contexte, apparaît comme le point de départ de l’histoire de la poésie italienne. 22 sonnets, entièrement centrés sur l’amour, l’amour non partagé, la souffrance amoureuse, comme l’éloge de la femme aimée.
À les lire, on ne sait jamais qui est cette femme, si elle est fée, ou de chair (p. 51), si elle a vécu réellement, et qui parle, s’adressant à elle. Un « je » lyrique, certainement, mais sans visage, une voix pure, qui n’a pas d’autre concrétude que celle du chant, ou du langage poétique, du jeu des mots, et des contraintes du sonnet. Un « vous », « donna » (p. 20, 24), « donna mia » (p. 16, 44), « madonna » (p. 26, 36), « donna amorosa » (p. 46), autant dire une personne sans figure, sans traits distinctifs. Elle n’a, d’ailleurs, pas de nom, comme Laure ou Béatrice. Et les marques qui l’identifient sont de la plus pure tradition : « blonda testa e claro viso » (p. 30), « beauté blonde », « visage éclatant ». Elle n’est qu’appellations génériques, que périphrases, c’est-à-dire une pure abstraction, qui aide à dire, non pas l’amour d’un être pour un autre être, mais l’idée même de l’amour, le sentiment d’amour, dans sa plus grande intensité, dans sa pureté, dans son essence.
Et, lorsque le poète évoque, soudain, une notation concrète : « Par un jour clair, j’ai vu tomber la pluie » (p. 29), c’est pour mieux jouer des contraires, et les rapprocher : l’obscur et la lumière, la froide neige et la chaleur, la douceur avec l’amertume. Tout n’est qu’allégorie, qu’idée, dans ce monde où les mots disent l’intelligible plus que le sensible, raisonnent sur les effets d’amour, son origine, et les souffrances qu’il occasionne. L’Amour, lui-même, n’est jamais qu’une figure mythologique, avec « flèche d’or » et « flèche de plomb » (p. 57), qui frappe (p. 17, p. 19), ou impose sa loi (p. 23). Et les poèmes sont l’occasion de raisonnements rhétoriques, pouvant donner, à un lecteur d’aujourd’hui, l’image d’une poésie bien peu sentimentale. C’est que l’enjeu de Lentini n’est pas là, et qu’il n’a pas souci, comme Pétrarque, de dire l’amour pour une femme réelle, rencontrée dans la vraie vie, follement aimée, et trop tôt disparue.
Son but est de faire jouer les mots, de s’enchanter de leurs sonorités, de leur écho, des liens qu’ils tissent les uns les autres, quand ils s’appellent et se répondent. Et d’épuiser, d’utiliser, toutes les ressources qu’autorise la pratique de cet instrument nouveau qu’est le sonnet. 14 vers. Des contraintes de rimes. Mais que de combinaisons possibles, si l’on s’impose de répéter les mêmes mots en fin de vers : « passo » / « giunta » ; « punto », « gente », « parte » (p. 16), en jouant sur les doubles sens, ou la nature grammaticale, substantif, participe passé. Plus encore, le poète s’exerce à renverser l’ordre des rimes des tercets, de CDC en DCD aussitôt après, ce qui impose à la rime une contrainte supplémentaire (p. 20, 30, 32, 40, 46, 48). Il peut s’obliger aussi à commencer chacun des vers des quatrains par le même mot : « viso », « lo viso », « bel viso », « adorno viso », « chiaro viso » (p. 32). Le poème tourne presque au blason, sans, pourtant, rien décrire vraiment, concrètement, que le seul enchantement des mots, leur jeu de sonorité, comme leurs appels, comme leurs échos. Car « viso », en début de vers des quatrains appelle une rime « viso », « riso », « paradiso » dans les tercets (p. 32). Enfin, la rime batelée peut être utilisée, jusqu’à l’excès, jusqu’à la grâce d’une incantation du langage, qui fait que le sens compte moins que ce que les mots en miroir font briller, font étinceler.
La fin d’un vers peut rimer avec le mot mis au milieu du vers suivant (p. 42, 50). Un tercet peut finir par une expression : « che s’aprendesse » (p. 44), et le suivant commencer par cette même expression. Ou les deux tercets d’un sonnet peuvent finir par le même vers : « redendo vita come la finise » (p. 42), mais l’un évoquant le Phénix expirant, ou rendant la vie, tandis que l’autre, par le même vers, dit le Phénix reprenant vie, revenant à la vie. Enfin, des jeux de mots en cascade autour de mots de même origine ou de même sonorité : « viso », « aviso », « diviso », « visare », « divisare » (p. 34) peuvent faire que, soudain, tout scintille, dans ce poème sur le visage de l’aimée et la façon de le concevoir. Mais ce sont les mots qui scintillent, les mots qui brillent, comme le font au ciel les étoiles, durant une claire nuit d’été. Alors, il y a fort à parier que Lentini n’est pas seulement une figure un peu oubliée de la lyrique médiévale italienne. Il est aussi, il est surtout, comme Jacques Roubaud le rappelle, citant les mots de l’Oulipo, un plagiaire par anticipation, tant l’éblouissement de son jeu rhétorique annonce les vers d’un Mallarmé, ou les poèmes à contraintes des temps modernes.
La poésie est déferlante de langage. Elle est tempête avec des mots, avec des noms, avec des verbes, des adjectifs, ou des syllabes. Elle est, d’abord, pour le poète, l’occasion de s’émerveiller, lui-même, du langage qu’il emploie, et de rester, là, fasciné, devant tous les scintillements que les mots entre eux peuvent créer. C’est le feu d’or d’un bracelet, pour Mallarmé. C’est la brillance de la fenêtre d’une pièce vide dans un miroir, dans le sonnet en x. Ou c’est, plus sûrement avec Lentini, les premières lueurs d’une nuit sicilienne, qui commence à peine, et qui fait briller ses étoiles, et ses planètes, et son Soleil, dans le ciel noir de l’univers.