Camillo Sbarbaro- Le Paradis des lichens par Christian Travaux
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
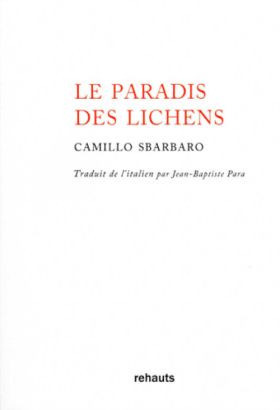
La signification essentielle est dans la réalité, dans le concret, le brut, le compact ou le fluide, le gazeux : dans ce qui est. Il n'y a que le monde qui parle.
PIERRE GASCAR
On pourrait penser le sujet peu amène, pauvre ou restreint. Le lichen est un végétal si peu visible, si négligé, qu’il peut paraître superflu d’en parler, d’y être attentif. Une humilité volontaire l’habille. Et sa vie retirée, comme en sourdine, fait de lui une plante d’espèce secondaire, peu digne d’un écrit littéraire ou poétique. Pourtant, Camillo Sbarbaro l’estime plus qu’aucune autre plante. Il en a même fait sa vie, par ses recherches de toutes espèces (au point d’avoir donné son nom à une vingtaine de spécimens), et en a fait aussi son œuvre. Copeaux et Feux follets fourmillent de textes sur les lichens, sans parler des textes latins, scientifiques, de Sbarbaro. Le Paradis des lichens est une petite anthologie, un choix de ce qu’il en a écrit. Avec lui, le regard s’éclaire. Le monde a d’autres priorités. Et les chutes du Niagara peuvent bien s’écrouler avec bruit, force et fracas. La plus petite trace de lichen, sur une roche ou le bois d’un arbre, importe plus que cette grandeur, trop haute, trop immense, pour nous.
L’œuvre de Sbarbaro est vaste. Des textes en vers. Mais, principalement, de la prose, des fragments, de plus en plus courts, de plus en plus parcellisés. Cette anthologie réunit des extraits de divers recueils, Lichens, Copeaux, et Feux follets. Et un des très rares entretiens que Sbarbaro ait accordés, en 1965, à Ferdinando Camon. C’est à partir de celui-ci, sans doute, qu’il est le plus facile d’entrer dans ce livre singulier. Le poète ligure s’y révèle solitaire, humble, isolé, dans une maison vide de livres à l’exception d’un seul volume : une taxonomie des lichens. Et il y explique son goût pour ce végétal ignoré, pour tout ce qui n’est pas voyant, ce qui est pauvre et négligé, sans importance, misérable :
« L’arbre, dit-il, mène une vie dont la plénitude et l’harmonie sont incomparables à la nôtre, et lui donner un nom revient à le limiter ; tandis qu’en saluant nommément quand on les croise les lichens peu visibles et négligés, il semble qu’on les aide à exister. » (p. 79-80, phrase qu’il reprend de Lichens, p. 21).
C’est assez dire ce qui fait la marque propre de Sbarbaro : un goût pour ce qu’on ne voit pas, ce qu’on ne regarde pas, une attirance pour le plus humble, le plus caché. Et, dans le même temps, une prose fragmentaire pour leur donner plus de lumière, plus d’existence.
Et, pourtant, des formes d’exister, le lichen n’en manque pas. Pour Sbarbaro, il est, d’abord, polymorphe, s’accrochant partout, multiforme, grand comme un arbre, ou pareil à du simple fil, fait des substances les plus diverses. Et polychrome, jusqu’à l’excès, puisqu’une gamme de couleurs des plus étendues le concerne : du blanc laiteux au noir stygien. Les mots latins pour le nommer sont légion. Rien que pour les noirs : fusculus, nigritulus, nigricans, tenebricosus, nigratus, obscuratus. Car le lichen, dit Sbarbaro, est un univers en soi, à part entière, un labyrinthe du vivant où l’on se perd avec bonheur, pour en ressortir, vivifié, les yeux lavés. C’est une plante « mémoire du monde » (p. 19). Et un « herbier est un cahier d’Echantillons du monde » (id.). Aussi, « récolter des plantes », est-ce pour Camillo Sbarbaro, « d’abord récolter des lieux », « garder la mémoire d’un site » (id.), et parcourir « un territoire sans frontières » (p. 39), avec quelque chose que personne même ne voit.
Sbarbaro, lui, dans le lichen, voit une Manne (p. 23), des écritures, des crinières, des barbes, des chevelures (p. 25), des dalles ou des Voies Lactées (p. 26), des paysages foudroyés (id.), des systèmes stellaires (p. 25), ou des ruches, ou des bancs d’huîtres, des poulpes, ou un petit cerveau (p. 26). Il bouleverse, ce faisant, à la fois nos priorités et notre regard sur le monde. Assez de spectaculaire, d’étonnant, d’extraordinaire. Assez de sites incontournables, de lieux de mémoire essentiels, ou de voyages frénétiques, obligés, à travers le monde. Toutes les taches que l’on remarque sur les pierres et sur les troncs d’arbre suffisent à notre rêverie. Assez même de tous ces livres, qu’il faut lire de toute urgence. Le lichen lui est son livre « le plus cordial, le plus spacieux » (p. 36). Et un face-à-face silencieux, pendant des heures, avec un muret de pierres sèches doit suffire à notre bonheur (p. 39). Aucune forfanterie dans cela. Sbarbaro va à l’essentiel, et se désapprend de toutes choses, de toutes autres façons de vivre, pour n’être plus qu’en contemplation face au monde.
Sa langue même traduit cet état. Une langue enveloppante, sinueuse, faite de terre, trouée d’images, qui caresse plus qu’elle ne dit, qui fait ruisseler plus qu’elle parle, et qui ouvre notre lecture à tout un pan trop ignoré de notre réalité. Il recueille, comme il le dit, non pas des bulles de savon, mais encore plus inconsistant, plus délicat (p. 36). Et sa prose atteint cet état de grâce et de délicatesse, cette inconsistance légère, à la merci d’un souffle d’air. Il n’est, alors, pas anodin qu’il ait la même délicatesse, la même tendresse, pour les gens qu’il croise dans la rue. Les filles derrières leurs fenêtres (p. 48). Les pauvres (p. 47). Les vieux qui attendent de mourir, et qui s’y résignent (p. 48). Et les gamins des rues (p. 50). Chaque geste du quotidien en acquiert une lumière nouvelle : comme allumer le gaz, et voir une bourdonnante fleur de feu (p. 56) ; fixer un merle, et entrevoir dans son regard sa colère d’être captif (p. 69) ; ou l’ardoise froide de la mer comme une mouette blessée (p. 59).
Ainsi devrait-ce être, toujours. Il n’en est rien. Nous passons notre vie blasés, désabusés, de ce que nous voyons chaque jour de plus humble, de plus ordinaire. Nous ne le considérons plus. Nous remplissons, alors, nos vies de désirs toujours plus grands, de tentations toujours plus vastes et trop immenses. « Le malheur des hommes, dit Pascal, est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». Ainsi, devrions-nous toujours apprendre à rester immobiles, face au monde qui nous est offert. Apprendre à le contempler, simplement, avec des yeux tranquilles. Et s’étonner de le voir, dans toutes ses manifestations, chaque jour toujours différent, toujours changeant. Un chat peut rester immobile, des heures, à guetter un oiseau ou regarder un papillon. Et nous, nous ne savons pas même, dit Sbarbaro, « comment le soleil éclaire une certaine rue à une certaine heure » (p. 53). Quittons cette vie effrénée, folle, qui n’est pas pour nous. Et retirons-nous dans notre être, dans la closerie de notre être, pour être à l’amble avec la terre où nous vivons.