Laurent Albarracin, Le Message Réisophique par Christian Travaux
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
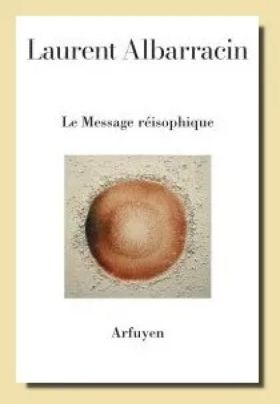
Il y a une attente dans les choses (p. 55)
Qu’est-ce qu’une chose ? Qu’est-ce qui fait d’une chose qu’elle est chose ? Quelle est sa chosité, c’est-à-dire sa présence commune, près de nous, en tant que chose, et seulement chose ? Nous ne le savons pas. Nous vivons au milieu des choses, toute la journée, toute notre vie. Nous les fréquentons constamment. Et nous sommes aveugles face à elles, tant nous sommes imbus d’être humain. Nous ne voyons ni ce qui fait leur différence fondamentale, leur essence même de choses, ni ce pour quoi elles sont là, avec nous, et vivant leur vie. Non pas nous voyant, nous guettant, nous observant continûment (ce serait les rendre trop humaines), ni écoutant ce que l’on dit (ce serait les croire douées d’oreilles), mais étant essentiellement là, simplement là, dans un monde qui est le leur, où nous ne faisons que passer. À cela, Laurent Albarracin, dans son nouveau livre Le Message Réisophique, apporte des réponses sérieuses et farfelues tout à la fois, relevant d’une autre logique que notre logique habituelle. Et c’est, comme toujours, savoureux.
L’affaire s’est complexifiée, depuis Res rerum, en 2018, et Le Manuel de Réisophie pratique, en 2022. Il s’agit, toujours, bien évidemment, d’interroger les choses en tant que choses, ou – comme l’écrit Albarracin – de « constater que ce qui est est conforme à ce qu’il est » (p. 88). De s’étonner, devant les choses, qu’elles soient justement comme elles sont. De développer une connaissance des choses elles-mêmes, venant d’elles-mêmes (elles, dont nous ignorons tout), et donc de forger des concepts depuis l’observation des choses. Être, ainsi, à hauteur de choses, et penser les choses et le monde où elles vivent, et où nous passons simplement, avec des concepts qui soient ceux des choses mêmes, et non des humains. Dans Res rerum, 64 poèmes proposaient un « livre étrange sans mention d’auteur ni d’éditeur ni de date ni de lieu » (p. 7). Dans le Manuel, 224 textes présentaient « une liasse de papiers » (p. 7), reçue « par la poste, sans mention d’expéditeur » (id.). Ici, c’est 303 sentences, ou recettes, ou Mantras, ou K?ans, qui sont exposés.
Mais, c’est, surtout, tout le Collège de Réisophie qui est mis au jour, une société à demi-secrète (p. 14, 28), inventée par Albarracin, et dont il dévoile les arcanes : son Magistère (p. 93), ses organes et ses courants (p. 70), ses ordres, comme celui de la Hyle (p. 40), ses branches schismatiques, orthodoxes et non-orthodoxes (p. 25), ses officines patentées (p. 67), ses congrès (p. 44), ses conférences (p. 30), ses rituels, comme les premiers gestes matinaux du bon Réisophe (p. 65, p. 74), et ses rites longuement énumérés en fin de volume (pp. 99-102), enfin ses livres (p. 93, 98) et son Bulletin, cité de nombreuses fois (pp. 18, 25, 67, 70). Autant dire une véritable organisation structurée, qui propose une vision des choses différente de celle habituelle. Pour les Réisophes, la chose affirme sa vérité de chose en étant elle (p. 15). Elle ne s’adresse donc qu’à elle-même (p. 21), contient sa preuve en elle-même (id.), la preuve de son évidence d’être. Et donc, s’il y a en elle ce qui l’exprime (p. 76), elle reçoit d’elle-même une action qui lui prouve, à elle et aux autres (aux autres choses comme à nous, humains) qu’elle est (p. 11). Le cela – cela qui est – signe son évidence (p. 23). Et la chose est le terme unique d’une comparaison à elle-même (p. 19), la « clé – disent les Réisophes – dont la serrure [est] à l’intérieur » (p. 20). À se constituer en objet, elle bute sans cesse sur elle-même, pour se réaliser en tant que chose (p. 57), d’un refus qui l’affirme (p. 89). Ainsi, la pomme :
« L’accident du pépin dans la pomme, par exemple, participe de sa pommité. Il y a une pommité de la pomme qui fait que la pomme ressemble à la pomme et rend possible de la saisir comme pomme » (p. 92).
Et Albarracin d’ajouter :
La pommité de la pomme est aussi sa paumissibilité. La pommité de la pomme est précisément la commité [c’est-à-dire : « la cohésion interne des choses qui transparaît à l’extérieur » (p. 91)] qui fait venir la pomme à la pomme et à la main, créant une sorte de communauté ou plutôt de pommunauté (une paumunauté) de la pomme et de la main » (id.).
Ainsi, encore, la chevalinité du cheval (p. 52), la sagacité de la sagaie (p. 93), ou la sangularité du sanglier (p. 81).
On le voit, tout cela n’est pas très sérieux, et, pourtant, du plus haut sérieux. Car, pour interroger les choses, il faut, dans un esprit pongien très sensible à la lecture, questionner les mots. Pour Albarracin, le non, ce refus qui l’affirme, « est le vrai nom inchoatif de la chose » (p. 90). La table, puisqu’elle est dure, est « intraitable » (p. 9). « L’oignon est le moignon absolu » (p. 17), ce pour quoi il fait pleurer. « Le chien assis de la fenêtre » est un chien qui regarde (p. 28). « Le wagon [va] bon train » (p. 42). « La pomme est comme la pomme », […] fait pomme le comme » (p. 46). « L’assiette a une assiette » (p. 52). Quant au point :
« il y a qu’il point. Avant même d’être le point, il sort d’un fond, il apparaît. Avant de s’accommoder comme point, avant de faire le point optiquement sur lui-même, il commence par poindre » (p. 53).
Le cratylisme de cette pensée éclate partout, ici. Mais il est mené, sobrement, avec un sérieux absolu, une logique imperturbable, une démonstration sans faille. Et, quand la pensée réisophique part d’un constat évident – la « faillance » de « la faïence » (p. 88), « l’étoile [si] lointaine qu’elle est étoilée » (p.75), ou la fenêtre que « sa menuiserie amenuise » (p.90) – elle pousse à ce point la logique qu’elle aboutit le plus souvent à des déductions improbables, et pourtant logiques, à une nouvelle vision des choses.
Aussi n’est-il pas étonnant, logique, et, pourtant, profondément illogique, selon notre logique humaine, qu’une « grenouille [soit] une savonnette » (p.59), et « ses bonds […] les gonds de la mare » (p. 49), qu’un « peigne », une « crevette se ressemblent » (p. 59), qu’un « gant [soit] une main » (« vide de main », cela s’entend, p.78), qu’une « pomme » – encore elle ! – soit « une rose qui est une pomme qui est une rose qui est une pomme » (p. 14), et qu’une « lanterne » soit comme « la lune », donc comme « du lait », donc comme « une crêpe », donc comme une « assiette » (p. 12). La vision poétique des choses qui en découle fait naître, alors, d’autres liens, plus mystérieux et plus secrets, par les mots, entre les choses. On entre dans un autre univers que celui que nous fréquentons, différent et, pourtant, le nôtre, logique et, pourtant, illogique, d’une autre logique que la nôtre.
Il suffit, au réisophe Albarracin, de prendre à la lettre un syntagme figé ou une catachrèse, de retourner une expression, pour en montrer toute la charge poétique qu’elle contient, combien notre monde fait d’objets nous le méconnaissons, et combien la pensée humaine que nous estimons infaillible, toute puissante, n’est qu’un brin de paille sécable, ou un feu pétillant de rien, ou une bulle d’air. Avec la réisophie, la canne pourrait marcher, mais d’une seule jambe (p. 32), la table accéder, peut-être, à une certaine bipédie, mais d’un seul pas (p. 37), la brouette de sable être faite de sable (p. 47), et l’eau raser l’eau au miroir de l’eau, le rasoir qui rase l’eau rasant aussi le rasoir (p. 25). Pour Perec, l’infra-ordinaire constituait l’extraordinaire. Pour Albarracin, c’est, ainsi, en réinterrogeant les mots que nous employons tous les jours que nous découvrirons combien le monde des choses qui nous entoure est renversant d’une fulgurante beauté, car renversant d’immobilité et d’évidence.
Il nous appartient, désormais, d’apprendre à mieux le regarder et à le considérer.