Rehauts, n° 54 par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
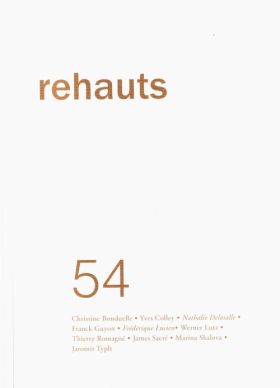
Comment écrire à propos de ce qui n’est plus, effacé par les années ? que reste-t-il par exemple du père ? seulement « Un sourire derrière la verrière du temps ». De là une question, que doit-on « à l’image d’un père disparu / Pas plus pas moins [qu’à d’autres] / Mais quoi ? ». C’est la rupture entre aujourd’hui et une autre réalité, celle de l’enfance au hameau vendéen de Cougou, que James Sacré explore dans quelques poèmes, écrits entre septembre 2020 et novembre 2023. Prés et arbres changent peu, mais les fleurs cultivées par sa mère « aux environs d’une ferme qui n’existe plus » ne sont que vagues souvenirs peut-être en partie inventés. Reviennent à la mémoire quelques mots d’une langue elle aussi quasiment oubliée, « Qu’est o qu’oi est qu’aurait dit le père » devant les fleurs en pots sur la terrasse de James. Rien ne peut reconstituer un autre monde tombé dans l’oubli et, quand la fin approche, ce sont les vers de Chassignet et de Ronsard sur la fin de vie qui sont présents.
C’est encore le passé que visite Marina Skalova. La narratrice retourne dans l’ancien régime soviétique par l’évocation d’une ville, Visaginas, et d’un marché, Kalvariju Turgus, tous deux en Lituanie. Brutalité de ce que la mémoire fait surgir d’une enfance où l’odeur d’essence imprégnait les trottoirs, où la forêt se caractérisait d’abord par un « silence opaque ». Rien de divers, c’est-à-dire de vivant : les habitants, les immeubles, comme les arbres, sont « en rangées », les rues portent des noms sans lien avec le réel, « Rue des Soviets », « de l’Énergie », « des Vétérans ». La langue même est perdue, « Une gamine crie des insultes en russe », et des phrases en russe sont introduites dans le second poème consacré à un immense marché où l’on trouve un fatras de marchandises venues du passé, celui de l’ « homo sovieticus », mais « ici le russe est la langue vieille, la langue rance », qui porte en elle « une odeur moisie ».
Le poème en prose de Franck Guyon s’en tient au présent, à un présent qui s’étire interminablement et seul un sujet peu défini intervient (« dit quelqu’un »), un "nous" apparaissant très tard. Son injonction répétée, « Il ne faut surtout pas [variantes, « rien », « plus »] écouter, organise le récit d’un refus, refus aussi nécessaire que dans L’Odyssée, « il faudrait se boucher les oreilles comme le font les compagnons d’Ulysse ». Cela pour tenter d’éviter le bruit continu des voix, ce bourdonnement « comme s’il n’y avait pas de commencement, comme s’il n’y avait pas de fin », comme « du vent dans du feuillage et de la pluie sur le pavé des cours ». Ce bruit, comme un « appel », reste indéfinissable, toujours là, dans le sommeil ou dans l’éveil, il vient autant du dedans que du dehors, toujours incompréhensible, et il (« dit quelqu’un ») inutile de se boucher les oreilles. Le récit de Franck Guyon s’achève par trois débuts d’énoncés (« Il ne faut surtout pas », « Surtout pas », « Pas »), chacun suivi d’une série de lettres qui ne forment aucun sens — les bruits du monde à jamais privés de signification.
Les poèmes en vers libres de Walter Lutz (1930-2016), écrivain suisse de langue allemande, sont regroupés en très courts ensembles. Les notations du narrateur (« je ») semblent sans lien apparent : il s’agit bien pour lui de restituer la diversité, souvent ignorée, des choses du monde, de « Dégager à la fois une odeur de printemps et de défaite ». À côté de multiples notations à propos de la nature, le narrateur se met quelquefois en scène, y compris dans un contexte où le lyrisme est bien éloigné, « La boue la crasse la vie / tout me saute à la gorge tout à coup ». Presque toujours, ce qui serait à entreprendre est présenté de manière neutralisée, comme une distance était introduite entre le présent et le fait d’agir, retardé ou annulé :
Écrire dans le jour pâlissant
écrire dans l’obscurité qui grandit
écrire pour se faire à l’idée
que l’homme ne saurait que pourrir.
Écrire un poème à partir d’un tableau est une tradition ancienne, de Baudelaire à Éluard et du Bouchet. Thierry Romagné choisit trois tableaux, de Pablo Picasso, Édouard Manet et Eugène Boudin, dont les titres sont repris pour les poèmes, Baigneuses jouant au ballon, Sur la plage et Plage à Trouville. La description des baigneuses insiste sur leur caractère érotique (nudité, seins, fente) et, en même temps, tend à l’annuler (« géantes »). Ce qui n’appartient pas au tableau lui-même et relève de la vie du peintre est présent dans la notice du musée Picasso — le nom de deux baigneuses, Olga, l’épouse, Marie-Thérèse, la maîtresse ; de là sans doute la désignation du jeu de ballon par bitch [= putain] volley et l’interprétation qui suit : le ballon perçu comme un fœtus porté par l’une d’entre elles — à partir de l’expression avoir un polichinelle dans le tiroir, « être enceinte ».
Dans le tableau de Manet, une femme (son épouse) lit et un homme (son frère) regarde la mer, tous deux silencieux, « les vents emportent leurs paroles / avant qu’elles soient prononcées ». Romagné invente une autre scène : les personnages « font mine de ne pas se voir et n’entendent rien de ce qui se passe autour d’eux, l’homme songerait à des scènes qui évoqueraient un autre tableau de Manet, Le déjeuner sur l’herbe, « ekphrasis réduite aux images ou extase picturale » — le narrateur surgit de cet ekphrasis pour s’en déclarer l’auteur.
Pour le tableau d’Eugène Boudin, le narrateur construit un récit en attribuant un statut social aux personnages présents sur la plage, avant de laisser une femme le poursuivre, femme qui apprécie d’être courtisée sans conséquence pour elle dans ce lieu public. Ce sont ensuite les enfants qui apparaissent, « qui sont à qui / on ne sait pas / on ne sait plus ». Ou plutôt, l’enfant comme les adultes, sous le ciel « gigantesque » « n’est qu’un fœtus qui braille vainement ». Les trois poèmes tournent autour de la vacuité de l’existence, ce qui est peut-être inscrit dans des assonances et allitérations où se lit le dérisoire des choses, comme « compactes opaques », « légère (…) lingères », « infimes infirmes », « accortes et à cri / nolines »
On n’oubliera pas les poèmes du tchèque Jaromir Typlit et du belge Yves Colley, et l’on sera incité à réfléchir avec Jean-Christophe Bailly après avoir lu la recension de Temps réel par Jacques Lèbre.