Thierry Metz-Lettres à la Bien-aimée et autres poèmes par Mathieu Jung
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
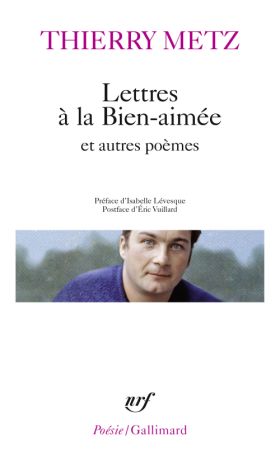
Rassembler des recueils est un exercice qui, par essence, risque de nuire à l’unité du poème, à l’intégrité originelle de chaque livre ou plaquette. Il n’en est rien ici. Lettres à la Bien-aimée et autres poèmes, volume cinq-cent-quatre-vingt-seizième de la collection « Poésie/Gallimard », est un ensemble cohérent constitué de six ouvrages et de quelques poèmes isolés de Thierry Metz. Non un simple panel ou panorama de la poésie de Thierry Metz, mais un livre uni, organique qui permettra de mieux faire connaître cet auteur dont Le Journal d’un manœuvre, les poèmes de Terre, ou L’Homme qui penche ont déjà rencontré un lectorat fidèle et toujours grandissant.
La grâce de Thierry Metz est souvent éprouvante. Les textes brefs ici réunis peuvent — et c’est sans doute souhaitable — s’égrener progressivement, graduellement. À la manière dont on prie sur un rosaire consacré à un Dieu dont la présence n’est pas garantie. Mais ce n’est jamais, quand bien même la déréliction travaille à l’âme et au corps, une prière dans le vide :
C’est toujours l’intérieur qui est à l’affût.
Vers toi ou vers un Dieu…
Ces poèmes exigent une réceptivité particulière. Le destin de Thierry Metz est en effet bouleversant. Les Lettres à la Bien-aimée et autres poèmes sont édités avec autant de soin que de tact par Isabelle Lévesque. Son introduction, sobre et informative, ainsi que la postface d’Éric Vuillard évitent toute forme de dolorisme. On aimerait pouvoir parler d’empathie, si le mot n’avait pas été dévoyé, ces temps-ci, de son sens. Il y est dit en tout cas ce qui est à dire — tel que c’est écrit, pour reprendre le titre d’un recueil de Thierry Metz repris dans ce volume.
Écris
non dans l’écriture
mais dans l’intimité du puits
où se cache le plus clair
Le poème de Thierry Metz est riche de son dénuement. Isabelle Lévesque évoque dans sa préface le caractère rudimentaire de cette poésie placée sous le signe selon elle — et c’est très juste — de l’inachevable. On assiste en effet à l’expression de ceux que Thierry Metz nomme les « grands brûlés de l’être ». C’est la zôè qui se donne ici à voir, la vie nue, selon les Grecs, le simple fait de vivre. « Le reste est de chaque jour : presque nu. » Le commentateur est nécessairement exclu de cette expérience, que le poète est le mieux à même de signifier, en cela qu’il est maître des silences :
De n’être rien
que ce qui est
de ce qu’il reste
brûlé
dans nos voix
comme un nom
après le travail
délivré
de l’herbe
sauf peut-être dans l’âme
du grillon.
L’un des métiers de Thierry Metz fut celui de maçon. Pour ce bâtisseur intranquille du poème, « l’abri, constate Isabelle Lévesque, ne se construit pas avec des phrases mais avec des mots ». L’abri, précaire, exige une lecture lente mais ferme, mot à mot. Alors même que l’abri tâche de se construire, la scansion doit prendre acte de la suffocation du poète. Ce d’autant qu’il s’agit d’une poésie sans refuge : « Là : il n’y a pas d’intérieur. » Le don du poème, pourtant, relève d’une extériorité pure, en direction de la Bien-aimée :
Je t’écris d’un ailleurs où il n’y a pas d’ailleurs.
Vie reste vie
Mort reste mort
La voix ici ne se retourne pas, ne revient qu’avec des silences. Ou avec le pire.
J’aime m’allonger contre toi, le soir, sans les épices de la lampe, une main sur ton ventre, mon visage entre le cou et les cheveux.
Là : un oiseau pourrait se poser, sans crainte.
Je sais bien que nous pensons à des soucis, à des transhumances. Mais comment ne pas se mesurer à ce qui est ? à une vie courante ?
Nous n’en parlons pas. Nous sommes où les quatre vents nous ont amenés.
C’est là qu’est le puits. Ta bouche contre la mienne comme des gosses qui ont mangé des fraises ou fait tomber des pierres pour entendre jusqu’où on l’entendrait.
Ces poèmes d’amour se nimbent de la mort de l’enfant. Le chagrin travaille de manière gravative. Il pèse, il leste, il creuse le poème. Il l’ajoure également. Or, ces trouées ne sont jamais des éclaircies.
Heureusement, il y a depuis le début quelque chose que nous ne voyons pas, que nous n’entendons pas. Sinon…
Il est un arrière-monde indicible sur lequel s’appuie la parole rudimentaire et presque sacrée de Thierry Metz. Sinon… Sinon, on le devine — le poème à bout de mots, si près de l’os et de l’âme témoigne d’une condition-limite, celle qui est dévoilée dans L’Homme qui penche : « Je dois tuer quelqu’un en moi, même si je ne sais pas trop comment m’y prendre. » Ce règne occulte, on le perçoit peut-être mieux, encore que confusément, dans un curieux récit intitulé Le Grainetier (Pierre Mainard, 2019). Ici, dans Lettres à la Bien-aimée et autres poèmes, c’est en creux, dans la béance du poème qu’on le devine.
L’ange ne reviendra pas
mais son visage est partout dans l’arbre
et tout ce qui vit à proximité
est tourné vers son absence
et cherche
Une forme de grâce ne manque pas de percer dans ces poèmes extirpés des « amas étoilés du réel ». L’expérience de l’impensable garantit sa nécessité au poème de Thierry Metz, mais il convient également de ne pas réduire le poète à cette seule douleur, à cet impossible en particulier. Car ces poèmes, nonobstant la peine et peut-être malgré eux, ont une portée plus vaste. C’est en cela qu’ils peuvent nous toucher, d’aussi loin qu’ils nous parlent. Par leur simplicité même. Encore que ce terme soit quelque peu faible pour désigner le dénuement extrême — rudimentaire, oui — dont est fait le poème de Thierry Metz. Le rudiment, c’est bien quelque chose qui commence. L’étymologie l’indique. On va pouvoir mieux commencer de lire Thierry Metz grâce à ce volume.