Roger Munier, La Voix de l’érable par Mathieu Jung
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
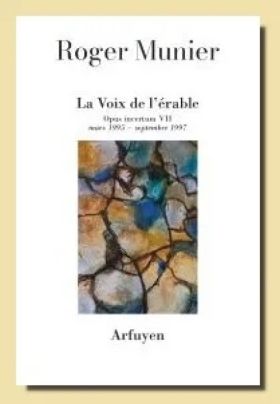
Les Éditions Arfuyen entreprennent de faire paraître l’œuvre majeure de Roger Munier, dont une partie a déjà paru dans cette maison ainsi qu’aux éditions Deyrolle, Fata Morgana et Gallimard. Opus incertum, annonce l’éditeur, comprendra en tout une quinzaine de volumes. La Voix de l’érable constitue — nous ne sommes pas encore à mi-chemin — le livre septième d’Opus incertum, vaste ensemble aphoristique que Munier définit ainsi :
Plus que des aphorismes au jour le jour, ce sont […] ici des notations d’instants, fruits d’une méditation continue mais sans apprêt, dont l’agencement peut rappeler l’opus incertum auquel renvoie le titre.
Il s’agit en l’occurrence d’un terme d’architecture désignant un mode d’assemblage de pierres irrégulières s’enchâssant les unes dans les autres selon leur forme, de manière à faire un tout continu : mur ou soubassement de façade, dallage extérieur. L’impression première est celle d’un certain désordre, mais contrôlé, où chaque pierre vaut certes par elle-même, mais autant par l’ensemble où elle s’insère et qui règle sa mise en œuvre.
J’ajouterai qu’incertum dans le titre peut avoir aussi, outre son sens technique, une connotation d’incertitude. Il faut, bien sûr, la maintenir dans mon propos. On pourra s’en tenir à chaque pierre réduite à elle-même dans sa forme, parfois inattendue, et considérer ses contours. Mais seul l’ouvrage d’ensemble quelque jour achevé peut lui donner sa place. Entre-temps, l’incertitude demeure, comme elle demeure pour moi quand une pensée me vient au fil des jours…
J’avais lu Munier jusqu’ici à travers d’autres auteurs qu’il avait traduits et commentés. Au filtre ou en filigranes de ses traductions de Heidegger, d’Angelus Silesius, des Voix d’Antonio Porchia ou encore de la Poésie verticale de Roberto Juarroz, dont Munier a souligné l’universalité, mais aussi le fait que l’œuvre du poète argentin n’est « déchiffrable qu’au niveau de chacun, du destin de chacun ». J’avais donc été mis en présence de Munier sans trop le savoir, tant son retrait lui est essentiel, presque sans faire attention à lui. Munier me semble d’ailleurs contenu dans cet aphorisme très beau, surprenant, au baroquisme bizarre, daté de mars 1987 — je le trouve émouvant : « Vache à l’écart des troupeaux errante seule, d’une errance lourde et lente… »
En ne rencontrant que le préfacier ou le traducteur, j’avais Munier en arrière-plan de ma lecture. C’était déjà beaucoup, encore que ce fût peu. Voici en effet, paru aux Éditions Arfuyen, La Voix de l’érable, par où l’on peut désormais pleinement découvrir Munier, appréhender Munier comme une voix à part entière, de tout premier plan.
Les notes de La Voix de l’érable, qui s’échelonnent de mars 1995 à septembre 1997, témoignent d’une aventure de la pensée dont la portée est, là encore, à la fois particulière et universelle. À mieux dire, on assiste à une aventure dans la pensée, à un périple intellectuel. Munier le dit excellemment : « Toute vie est voyage vers les confins, par prudence ralenti ou même différé, car il est sans retour. » Alors allons-y.
La Voix de l’érable est également une sorte d’almanach des sensations, où l’on voit défiler les mois et les saisons. Mais que l’on ne s’y trompe pas : on lira ici un anti-journal coulé dans une forme retenue et minérale, d’où rien ne s’épanche. « Une autobiographie, mais qui ne serait faite que des moments impersonnels où l’être s’est senti traversé. » Ces nouvelles révélations de l’être, qui n’ont rien à envier à celles d’un Artaud — Munier s’aventure bien ailleurs, et selon d’autres moyens —, se livrent en une série de variations, d’inlassables reprises. Le travail de Munier peut faire penser à celui d’un Giacometti, qui n’a de cesse de sculpter pour « en finir », mais dont le geste est d’inexorable commencement, à la lisière d’un dire toujours renouvelé. « L’homme commence là où il ne se sait pas. » L’inconnaissable prime dans ces notes tenues jour après jour pendant quelques décennies. L’espace qui lui sied lui est généreusement accordé, sans que jamais la pensée ne vienne le trahir ou l’entacher. « Le regard pense, lorsqu’il regarde, mais sans voir. » ; « L’homme est à peine moins inconnaissable que Dieu. » (subtilité féconde de cet « à peine »…) ; « On ne sait pas le temps, on le sent. On sent qu’on ne le sent pas. », etc.
Œuvre incessante, oui, que celle de Roger Munier, abondante et encore à venir, littéralement à paraître. La force de cette voix à part entière réside en ce qu’elle ne se livre que par fragments. Ceux-ci requièrent de fermenter en qui les lit. C’est en effet un savoir d’une saveur particulière, qui nécessite en somme le goût du risque. « La pleine connaissance serait notre destruction. À quoi donc s’ouvre notre destruction ? »
La pensée de Munier infuse en nous. Comme elle était là, déjà, dans la traduction par Munier de L’Errant chérubinique d’Angelus Silesius (Arfuyen, 1996). On se souvient de la formule célèbre de Silesius :
La rose est sans pourquoi ; elle fleurit parce qu’elle fleurit,
N’a souci d'elle-même, ne cherche pas si on la voit. (Roger Munier trad.)
La pensée de Munier se ramifie en tous sens, et il serait vain de chercher à la réduire ici sous la forme d’un résumé ou d’un compte rendu. Je me contenterai donc, pour donner à lire un peu des quelque 300 pages de La Voix de l’érable, de constituer un bréviaire de la rose à partir de fragments cueillis dans cet ensemble.
Le « sans-pourquoi » n’est pas une sorte de suspens plaintif imposé à la pensée, à sa question lancinante. Seule l’évidence foudroyante est « sans pourquoi ».
La rose en exhibant la rose cache la rose. Car la rose n’est pas la rose, mais une apparition.
La rose ne peut se respirer, elle est son parfum.
Rien ne dépassera jamais, en élégance, souple rythme, le plis des pétales dans la rose, au moment où elle se déploie./ Mais il est vrai que la rose est, pour une part, produit humain. La nature, elle, ne fait d’elle-même que l’églantine.
La rose reçoit la pluie comme un outrage. Seul en profite le rosier.
C’est le Rien qui monte dans la rose, se fait la rose. Ainsi la rose, ensemble, est rose et n’est rien.
La rose repose dans la rose, couverte par la rose, qui n’est rose que comme couvrant la rose./ Ce qui couvre est bien rose, mais justement n’est que « rose », non la rose — pleine et parfaite rose-là.
Le dire ne peut que se figer devant la rose.
Il faudrait pouvoir dire la rose, sans recourir au mot de « rose », qui l’occulte en la magnifiant dans l’idée, mais n’est qu’un doigt tendu vers elle et de trop loin…
La rose est le néant. Où est le néant de la rose ? Il ne peut « être » qu’elle, en son éclat. La rose est son néant.
Rien, dans les choses, ne nous reflète. L’arbre nous juge. La rose ne désigne que soi.