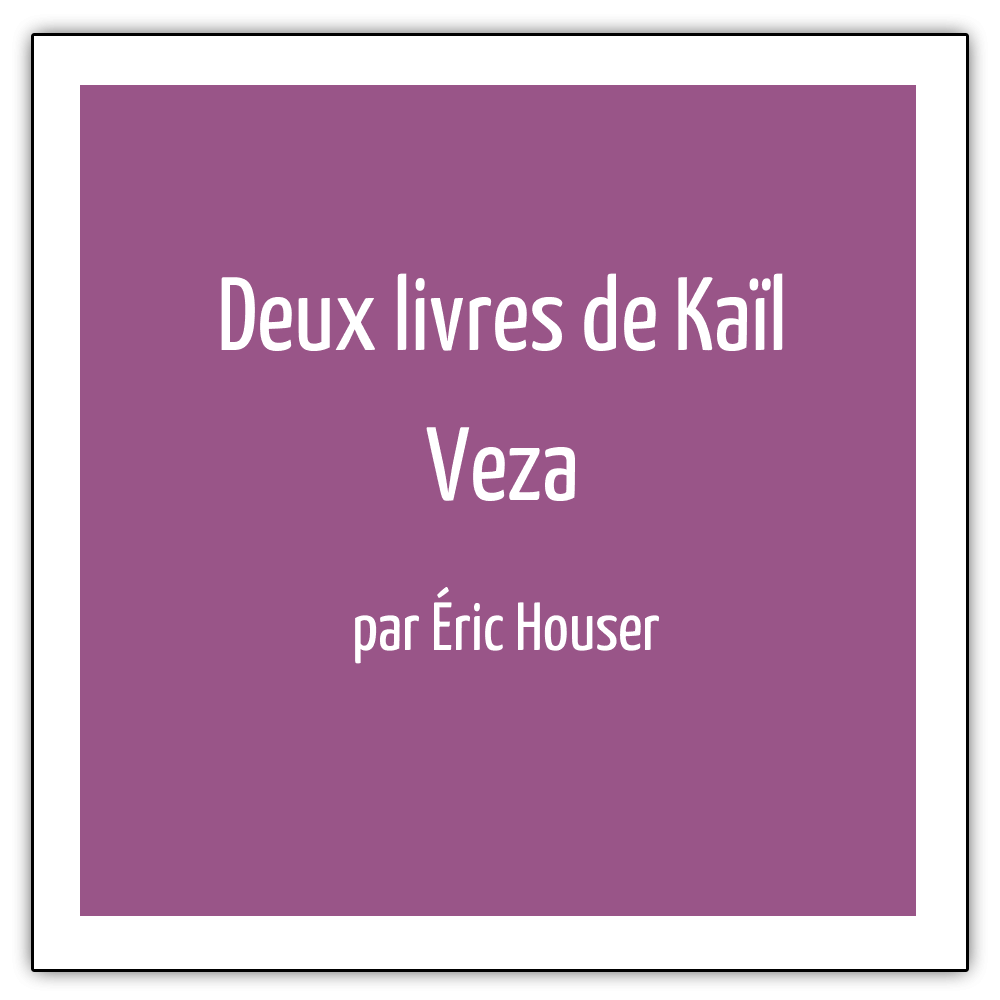Deux livres de Kaïl Vezza par Éric Houser
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
« Tu ne couperas point. »
Devant un auditoire attentif et je crois admiratif aussi (au Frac Sud, mercredi 9 avril dernier), l’éditeur-typographe Éric Pesty a très bien parlé de son travail en insistant d’une part sur sa matérialité, et d’autre part sur sa littéralité. Les deux font couple. Rien à objecter à cela.
Le lecteur et la lecture viennent après. Certes. Mais qui a franchi une fois la porte de l’atelier d’imprimerie, dans le Panier à Marseille, peut témoigner avoir assisté au livre en train de se faire, à l’affiche en train d’être composée, etc., et de ce que cela donne comme prémisses de la lecture du livre « fini ».
Ainsi, devant le premier livre de Kaïl Vezza, curb, j’ai été heureux de voir à quel point tout a été pensé et réalisé sous l’égide des deux « patrons », qui font la paire comme les saints Cyrille et Méthode (ils étaient frères) : matérialité, littéralité, les deux faces d’un même axiome.
Pour curb, mot qui désigne quelque chose comme trottoir, ou « angle du trottoir », mais aussi une figure de glisse au skateboard (que l’auteur pratique), la matérialité du livre-texte est directement nommée dans la prose du début, et agie avec les lignes noires qui interrompent le texte et peuvent évoquer la glisse elle-même, la lecture comme glisse, tout en annonçant les lignes (que j’appellerais ici « vers libérés ») isolées sur chacune des pages suivantes, qui en sont comme des rejetons. On entend aussi, en français, courbe, courbure.
La littéralité, pour moi, tient dans le pliage de la feuille contenue dans le huis/8 clos du livre, espace qui joue avec mais aussi contre l’espace externe à l’écriture, marqué par la contrainte et la violence (sociale, policière). La courbure du livre est une protection littérale contre l’effraction, un moyen de glisser hors champ. De ce point de vue, il importe de ne pas couper, de ne pas inciser la feuille/planche, et de s’accommoder du petit inconfort de lecture qui en résulte (« je glisse un doigt dans les fentes et ouvre de petits espaces en voûte d’ogive », in O.M., Éric Houser, à paraître).
Pour Vie d’un impersonnage, narration plus « classique » en trois parties (de 4, puis 3, puis 5 textes chacune), matérialité et littéralité sont plus à l’état de traces, me semble-t-il, que dans l’ouvrage précédent.
Ce récit magnifique m’a bouleversé car j’y vois comme un portrait (possiblement un autoportrait) d’un être qui n’est pas ou plus tout à fait de ce monde. Une sorte de saint, qui m’a évoqué de bout en bout l’écrivain (merveilleux) Robert Walser, mais aussi les personnages (peut-être eux-mêmes « impersonnages ») du cinéma d’un autre Robert, Robert Bresson. Je ne relèverai pas ces traces ici, chaque lecteur et lectrice le fera lui-même et elle-même. Je recopie seulement quelques phrases qui m’ont particulièrement plu et touché, non sans ajouter au préalable que le mood plutôt tragique et sombre du récit n’exclut pas l’humour :
« Table dressée et chaises en bois s’emparent de son squelette, ressoudent une partie de ses articulations. »
« On découvre dans son regard des machines ensevelies sous la neige. »
« Visage réfléchi dans la vitre des voitures,
ses lèvres se resserrent en une moue pincée pour produire un sifflement, et la bonne humeur aussitôt s’enracine. »
« Chaque pas, monnayable, devient le jouet d’un plaisir étranger qui s’approprie le mouvement dans les jambes, embrase le sol sous les pieds, se repaît de l’image du corps aux prises avec son désastre cinétique. »
À défaut d’existence, l’impersonnage a un corps. Est ce corps.