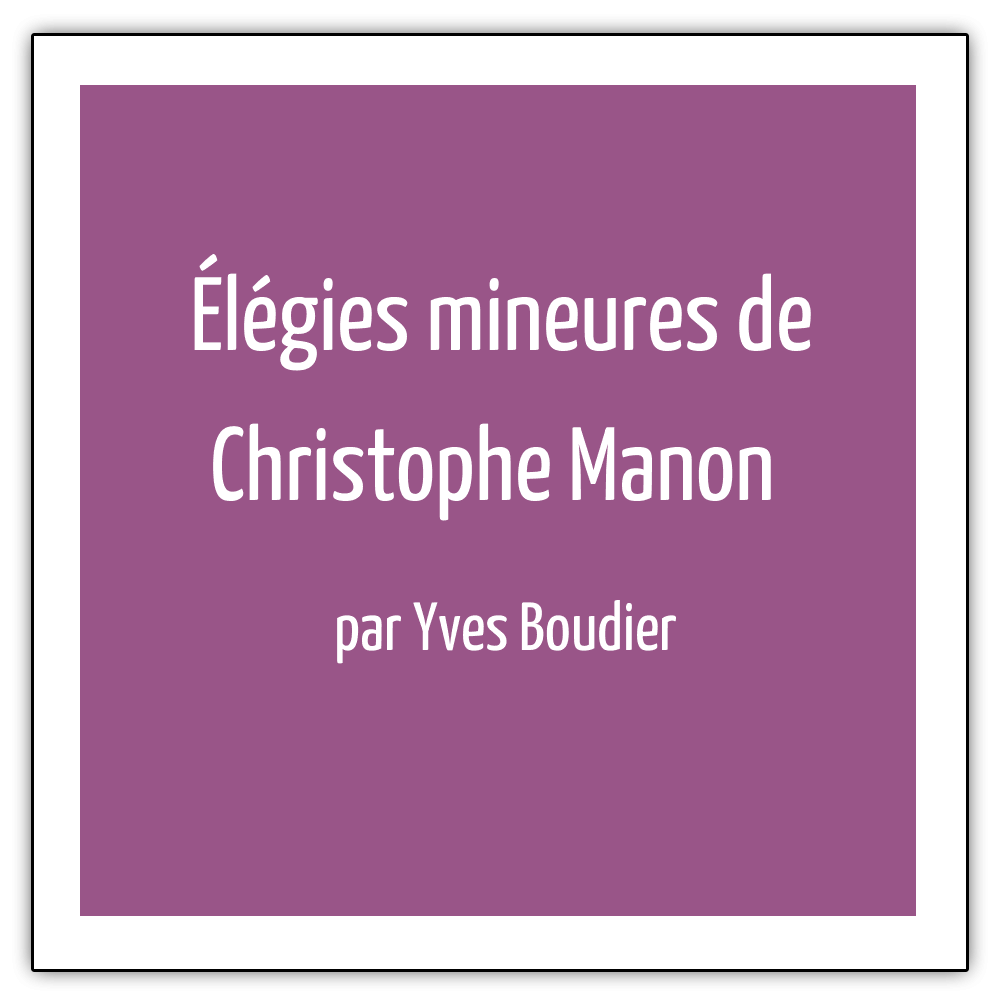Élégies mineures de Christophe Manon par Yves Boudier
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Il convient d’entrer dans ce livre avec ces vers de l’élégie 2 : « inutile il est absolument / de les ouvrir (ajoute-t-il / aussitôt) pas la moindre // car les morts vont vite dit-il les morts ». Il est ici question des portes qui donnent accès au passé, la leçon négative du voyage en Italie à la recherche des ancêtres s’étant radicalisée. La Porte du Soleil s’est avérée une illusion, n’était ce qu’elle a déplacé dans la poétique d’un Christophe Manon qui a ressenti et compris que c’était dans son intimité la plus personnelle et non dans une fiction de filiation que l’équilibre d’une vérité du sujet pouvait se trouver. On retrouve là la situation récurrente qui désunit le lieu d’une origine imaginaire des affects et l’intimité constitutive du poète. Nous ne sommes pas loin de la sempiternelle fable de La Mort à Samarcande, (… tu savais bien que je t’attendais là…). Or, la mémoire demeure indépassable : « mais nous il nous est impossible d’exister / sans eux non nous ne pouvons plus vivre ». Vivre sur un mode mineur, à l’image de celui que le solfège nous a appris : altération accidentelle, note sensible, note dominante-sous dominante, autant de caractérisations dans le discours musical des inflexions modales, que l’on peut transposer vers la rhétorique du poème de Christophe Manon. Déplacement et fragilité des affects passés. Le poème rythme alors ces mélodies silencieuses du souvenir, leur confère une enveloppe charnelle sonore, les place dans un jeu de silences et de reprises du souffle à l’origine du sens convoité, recherché, et qui parfois s’impose. Cela en bonne logique, si l’on considère que le prédicat dit quelque chose de l’autre, qu’il est l’attribut constitutif d’un objet de par la proposition majeure, le discours porté par la mineure « répond au signalement de notre prédicat », comme le souligne Claudel dans son Art poétique (1907).
Clément Rosset, en particulier dans Le Réel et son double (1976), s’interrogeait sur notre relation à « ce qui a été », déplaçant vers l’autre du sensible, l’éternel à-côté, l’enseignement majeur de Jankélévitch qui définissait le passé comme notre « viatique pour l’éternité ». Christophe Manon résout par le poème cette apparente contradiction entre le passé et le présent (en tant qu’actualisation de sa narration) avec ce vers : « ce qui fut a été est ne sera plus », un vers qui formule de manière ontologique toute relation dialectique au passé. En effet, à rebours de la norme linguistique qui attend un et conjonction de coordination, « est ne sera plus » doit s’entendre comme « c’est » ce qui ne sera plus. La puissance intime d’une telle formulation, outre son irrespect volontaire de la norme, tient à l’emploi paradoxal d’un futur pour désigner la fermeture absolue du passé, son impossible retour sinon dans l’espace du rêve, voie étroite pour accéder au réveil à venir du « ce qui », locution on ne peut plus concise pour désigner le matériau de l’écriture du souvenir dans sa diversité et son impossible véracité. De plus l’élision du C apostrophe renforce par un trouble agrammatical inattendu le jeu entre le révolu et le non encore advenu. Or, une mutation apparaitra avec l’anaphore du ceci au seuil de l’élégie finale au cœur de laquelle on lit « je n’ai plus peur bientôt j’irai / m’étendre parmi les morts ». Depuis le corps, les éléments naturels qui conduisent à la pulsion sanguine, à la cadence du désir, à un appel absolu de vivre, autrement dit à celui d’affronter la lumière de l’autre, à « louer la grâce et la beauté des formes », « à battre la mesure / à tomber de fatigue ».
Vigny, dans le poème La maison du berger (1844) écrivait : « Aimer ce que jamais on ne verra deux fois ». Christophe Manon fait sillage à ce vers, héritier contemporain d’une vision héraclitéenne de l’être au monde, autrement dit du thème de la ressouvenance, le souvenir premier nécessitant sa répétition pour se fonder en tant que tel, se faire matériau mémoriel. Et, de la même façon, il pourrait faire sienne la sensation que Fernand Gregh nomme l’Illusion de fausse reconnaissance : « J’ai senti se produire en moi une sorte de déclenchement qui a supprimé tout le passé entre cette minute d’autrefois et la minute où j’étais ». Un espace aboli qui ouvre la possibilité de se mettre en quête de soi, d’ouvrir, comme le rêve parfois l’autorise, l’accès à un passé certes fragmenté mais source de toute création à venir dans le présent d’un acte d’écriture, un passé que nul espace ne sépare plus du présent. Cet espace absent, vide, est celui qui génère la pulsion de l’écriture, celui dont elle nait. Montaigne le disait ainsi : « Notable exemple de la forcenée curiosité de notre nature, s’amusant à préoccuper les choses futures, comme si elle n’avait pas assez à faire à digérer les présentes » (Essais, I, chap. XI, Des prognostications, 1580). Et plus près de nous, Nerval nous apprenait que le présent était, à chaque instant, l’addition de tous les présents, présent s’entendant dans son double sens, don de l’instant et offrande absolue, « cette chanson d’amour qui toujours recommence » (Les Chimères, Delfica, 1854).
Si l’on sait depuis Freud que le narcissisme permet à l’individu de renforcer le refoulement de ce qu’il ne veut pas savoir de son passé, Christophe Manon prend le contre-pied de cette pulsion primaire au profit d’un repli défensif du désir consécutif à la perte d’un objet d’amour extérieur, ou à l’inverse à la présence de son quotidien traversé par l’obsession d’images récurrentes, roman familial et quête de sincérité allant de concert. Nulle contradiction, mais le frottement d’un lieu où coïncident présent et passé, le poète d’aujourd’hui et l’infans qu’il fut. En témoignent les fragments de comptines qui scandent dans les poèmes de brefs temps d’arrêt où tout lecteur se retrouve, est renvoyé à sa propre enfance où les choix entre bons et méchants se partageaient ainsi : on compte, on est désigné. Aucune responsabilité, le hasard binaire a décidé. La scansion précède tout récit, toute action, toute conclusion. L’enfant exclu est renvoyé à sa solitude, à la solitude du monde qui s’est effacé pendant les quelques secondes d’une parole en suspens qui signe le partage des actions : « quelque chose tremble / quelque chose brûle / à l’intérieur du corps ».
Le geste et la voix intimes de Christophe Manon, leurs inflexions quasi répétitives et obsessionnelles, sont au principe de son écriture, ils la précèdent et la déterminent. L’écriture du poème lui permet de retrouver une (son) identité native, elle en porte le témoignage, le poème se donne comme testament, mais un testament inversé en quelque sorte, ouvert sur l’avenir et non pas replié sur les circonvolutions du passé, des passés qui du pluriel qui les compose, se font l’unique force vive qui instruit le cœur d’une singularité poétique. Celle de Christophe Manon s’expliquerait-elle ainsi : « existe-t-il encore ce monde lointain / auquel parfois en rêves je reviens ? ». Dans Livre à venir (1959), Maurice Blanchot nous apprend que « L’écrivain a beau savoir qu’il ne peut revenir en deçà d’un certain point sans masquer, par son ombre, ce qu’il est venu contempler : l’attrait des sources, le besoin de saisir en face ce qui toujours se détourne (…) est plus fort que les doutes (…). Les tentatives poétiques les plus fermes et les moins rêvées de notre temps n’appartiennent-elles pas à ce rêve ? ». Christophe Manon n’est certes pas un rêveur, moins encore un poète rêveur. Toutefois, sans masquer par son ombre la scansion si singulière de sa métrique portée par une voix intérieure au bord des rives du poème, le poète est présent sous nos yeux au cœur du souvenir, présent dans la lettre même du poème, s’interdisant de dominer son écriture sur le mode du journal intime ou du carnet de route d’une expérience mémorielle.
Christophe Manon met en scène dans la fragmentation du poème le conflit latent entre le reflet de soi ancré dans les dépliements d’un roman familial et l’altérité patente de l’acte d’écrire. Brassant le passé, le poète instruit son présent et se met ainsi en quête d’une continuité, d’un avenir du vivre avec, avec le « wo es war, soll ich werden » freudien. La surface de l’eau (le poème) renvoie-t-elle à Narcisse (le poète) autre chose que son visage, son histoire peut-être ?
Lorsque les géographes analysent un fleuve, ils s’interrogent d’emblée sur son « lit mineur », ce lit ordinaire, occupé en permanence, délimité par ses berges. Le lecteur de ces Élégies mineures retrouvera dans ces poèmes l’ineffaçable fable d’un poète, son jadis, présent à jamais dans son écriture, sa parole, son « lit mineur », lieu majeur de tout engendrement.