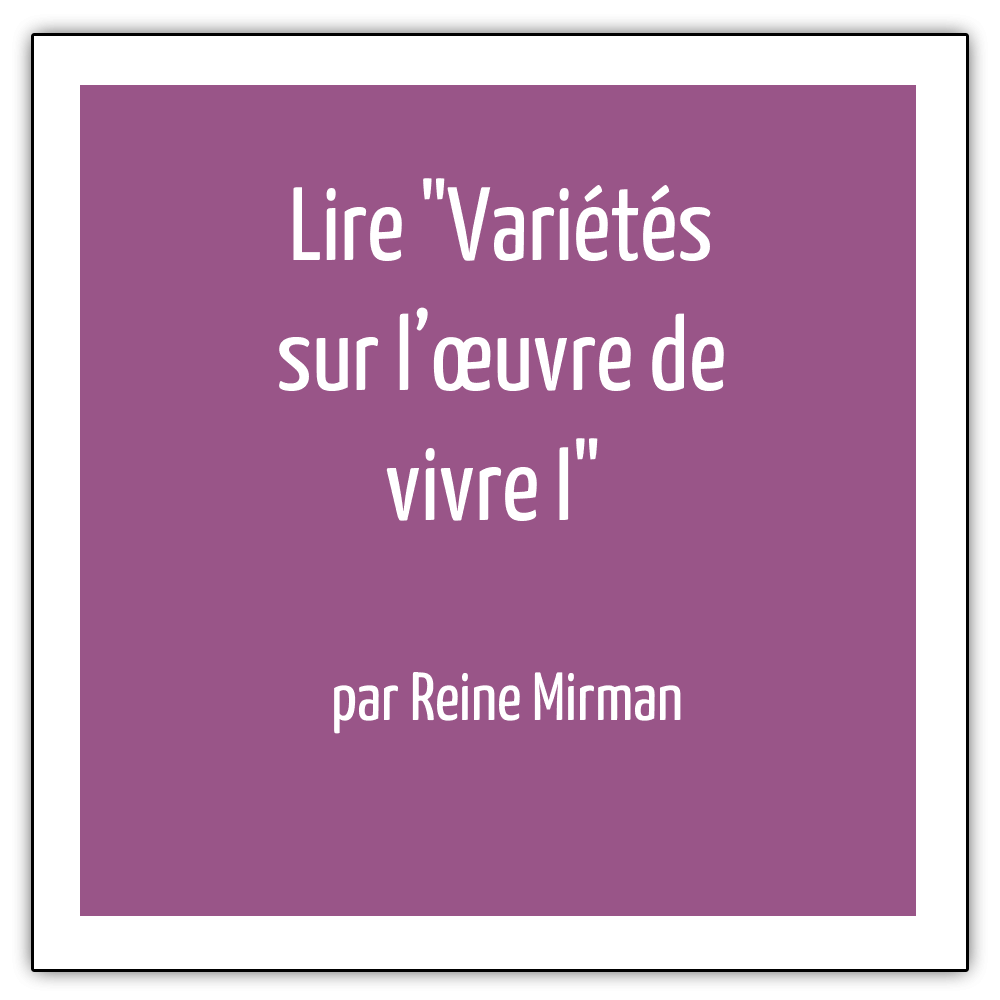Lire "Variétés sur l’œuvre de vivre I" par Reine Mimran
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
L’homme est fait pour s’exhausser de soi, pour tenter sa petite excursion hors de soi : il y faut de l’audace, il y faut cette espérance que la vérité d’un homme, c’est sa fabrication, c’est son ouvrage, c’est son roman et c’est « son mot ».
Emmanuel Tugny : Du Chagrin, p.69, paru en 2020, chez EEEOYS éditions.
La facilité de lecture est de règle dans les Lettres depuis le règne de la hâte générale……Tout le monde tend à ne lire que ce que tout le monde aurait pu écrire …… Quant à moi, je le confesse, je ne saisis à peu près rien d’un livre qui ne me résiste pas...L’art de lire à loisir, à l’écart, savamment et distinctement, … se perd : il est perdu.
Paul Valéry ; Variété III, Je disais quelquefois à Stéphane Mallarmé, p.14,15
J’ai tenu à mettre ces deux citations en exergue de cet article parce que je les trouve pertinentes pour introduire le lecteur à Variétés sur l’œuvre de vivre I d’Emmanuel Tugny, ouvrage modeste dans son format (159 pages), mais ambitieux par son contenu.
Il se présente sous la forme d’une suite de 97 chapitres, plus ou moins longs, certains comptant deux pages, d’autres une seule ligne. Ces chapitres sont précédés non de l’Avant-propos habituel, expression où le mot « propos » pourrait donner au texte un caractère plus léger, plus futile, mais d’un Avant-dire, où le verbe « dire » serait le pendant de « faire », d’«œuvrer », apparaissant comme une des fonctions principales de l’homme et qui impliquerait son être. L’ouvrage va se clore sur un Envoi, couplet final, insolite aujourd’hui. Ces deux termes, « avant-dire » et « envoi » nous introduisent d’emblée à l’originalité, à la liberté lexicale d’Emmanuel Tugny. Et voici, la première phrase de cet envoi :
« Je « fais ma vie », je crois, pour qu’elle s’exhausse en la vie. »
(Notons la présence de ce verbe « s’exhausser », souvent repris dans les « Variétés… », comme un leitmotiv qui fonderait une pensée, une philosophie, même si dans l’Avant-dire, Emmanuel Tugny se défend d’être philosophe : Je ne suis pas philosophe : il faudrait pour cela que je crusse en l’arraisonnement d’objets. Petite malice de notre auteur, puisque ce mot « arraisonnement » appartient à la pensée d’un philosophe, à la pensée de Heidegger.
Et voici la dernière phrase de l’Envoi :
« Je vois ce qui advient si je fonde mon temple : l’œuvre de vivre, en somme, fait le lit du levant. »
(Là, c’est le mot « temple » qui nous donne un autre élément propre à ce texte, le motif religieux qui le traverse)
Revenons donc aux deux citations qui introduisent notre article et qui éclaireront les visées de cet ouvrage.
Tirée d’un des romans d’Emmanuel Tugny, écrivain à l’œuvre foisonnante, impressionnante par son originalité et sa diversité (romans, essais, poésies, traductions, et même édition, puisqu’il a créé avec Pascale Prigent Tugny, les éditions Ardavena), la première citation évoque en sourdine un des thèmes récurrents de cet ouvrage.
L’homme est fait pour s’exhausser de soi : s’exhausser de soi, ce verbe évoque bien ce concept selon lequel l’homme travaille à sortir de soi, à s’élever, dans une sorte d’assomption, j’ose ici ce terme qui rend compte du caractère religieux de nombre de pages de cet ouvrage.
…la vérité d’un homme c’est sa fabrication, c’est son ouvrage. Tout est dit : « fabrication, ouvrage », ces deux mots constituent le fil rouge de Variétés… ; ils rejoignent le verbe « œuvrer » et ses dérivés, dont l’un, invention sans doute de notre auteur, l’ouvreur littéraire, désigne l’écrivain. Tous ces termes appellent l’homme à être acteur de lui-même, créateur de lui-même, de sa vie ; tous les thèmes abordés (littérature, art, amour, monde, solitude, peuple, laideur, beauté, mort…), obéissent à cette convocation, mais ce qui est original dans la pensée d’Emmanuel Tugny, c’est que le vrai travail de l’homme qui est de se construire, d’œuvrer sur soi en s’élevant, doit s'accompagner également d'une attitude particulière, celle de l’attente, du consentement à ce qui peut advenir, de l’écoute, mais ce qui est encore plus original, c’est qu’il s’agit de l’attente à ce qui vous attend déjà, du consentement à ce qui est et qui peut advenir, de l’écoute d’une voix intérieure, présente à soi, et ce dans tous les domaines de la vie.
Je n’écris pas j’accueille l’œuvre afin que l’œuvre tienne… Je n’écris pas ; j’œuvre à entendre. Il faut croire en la sacrosainte inspiration…... » chap. XXXVI, p.52,53,54
L’amour en quelque façon est attente de l’amour, non pas en tant que l’amoureux l’attend mais en tant qu’amour attend l’amoureux. ch. XVII, p.29
La seconde citation, est tirée de Variété III, de Valéry.
Ce mot « Variété », est présent chez nos deux écrivains et même si Emmanuel Tugny ne doit rien à Valéry, on ne peut s’empêcher de retrouver à travers ce mot « variétés » la même idée de multiplicité, de bigarrure chez l’un et chez l’autre, multiplicité de sujets chez Valéry, multiplicité de facettes d’une notion, « l’œuvre de vivre » chez Emmanuel Tugny.
On retrouve également dans ce terme « variétés », l’ensemble des éléments distincts qui constituent une gamme musicale avec sa succession de notes, ses intervalles mélodiques. Si je parle de gamme musicale, c’est que chaque chapitre dans ce texte révèle une valeur mélodique, avec ses forte, ses piano, selon le sujet traité, selon les propos tenus. Et ainsi, à chaque thème de cet ouvrage pourrait correspondre une tonalité, une mélodie.
Voici deux phrases de l’Avant-Dire qui confirment cette volonté de trouver dans la parole, un chant à écouter.
Je suis mon chant
Ce qu’il y a, voilà, c’est que je suis mon chant ; écoute.
Si j’ai choisi cette citation de Valéry c’est qu’elle nous parle d’un style, d’une écriture. Tout vrai lecteur doit chercher un ouvrage qui lui résiste, qui demande un effort, un « art de lire ».
A cet « art de lire » que Valéry croyait perdu, Emmanuel Tugny, répond ici, par un « art d’écrire ». Et même s’il affirme :
Je ne suis guère écrivain ; il faudrait pour cela que je fisse mienne l’idée du roulis de la langue sur soi en dépit de l’objection d’objets. Avant-dire, p.7
de chapitre en chapitre, il se montre, se révèle pleinement et totalement écrivain ; il est écrivain à travers une langue qui rend compte avec précision d’une pensée, d’une réflexion philosophique certes subtile, mais féconde, à travers une langue qui lui appartient, une langue assurément complexe, ardue parfois, mais chantante, une langue aux accents religieux, une langue neuve qui séduit par ses recherches, ses « fabrications », ses retrouvailles, ou ses inventions linguistiques, par ses fulgurances poétiques, musicales, une langue différente de tout ce qu’on peut lire aujourd’hui. Et c’est cette langue et cette pensée précisément qui initient chacun de nous à cet « art de lire » exigeant que Valéry attend de tout lecteur digne de ce nom.
Impossible de terminer cette incitation sans quelques citations qui donnent une idée plus nette du travail et de la pensée de l'auteur :
- L’œuvre de vivre...ne ressortit à aucune « morale », à aucune « intelligence » … elle est fille d’une vision et cette vision est celle-là même de l’étoile captive dont toutes les forces du sujet convergent vers l’affranchissement comme « jour levé » ou comme soleil. chap. LIX, p.88
- Une littérature qui « dit son temps » est infâme par nature, je crois, au regard de l’essence ………Ainsi des littératures du moi, en quoi le moi ne s’excepte – ni partant ne s’excède – de soi. chap. IX, p.19
- Je crois à la « majesté littéraire ». ch. XI, p.21
- Nuit, constellation, jour et printemps, coquelicot : rien en vérité qui ne soit. chap. LXV, p.104