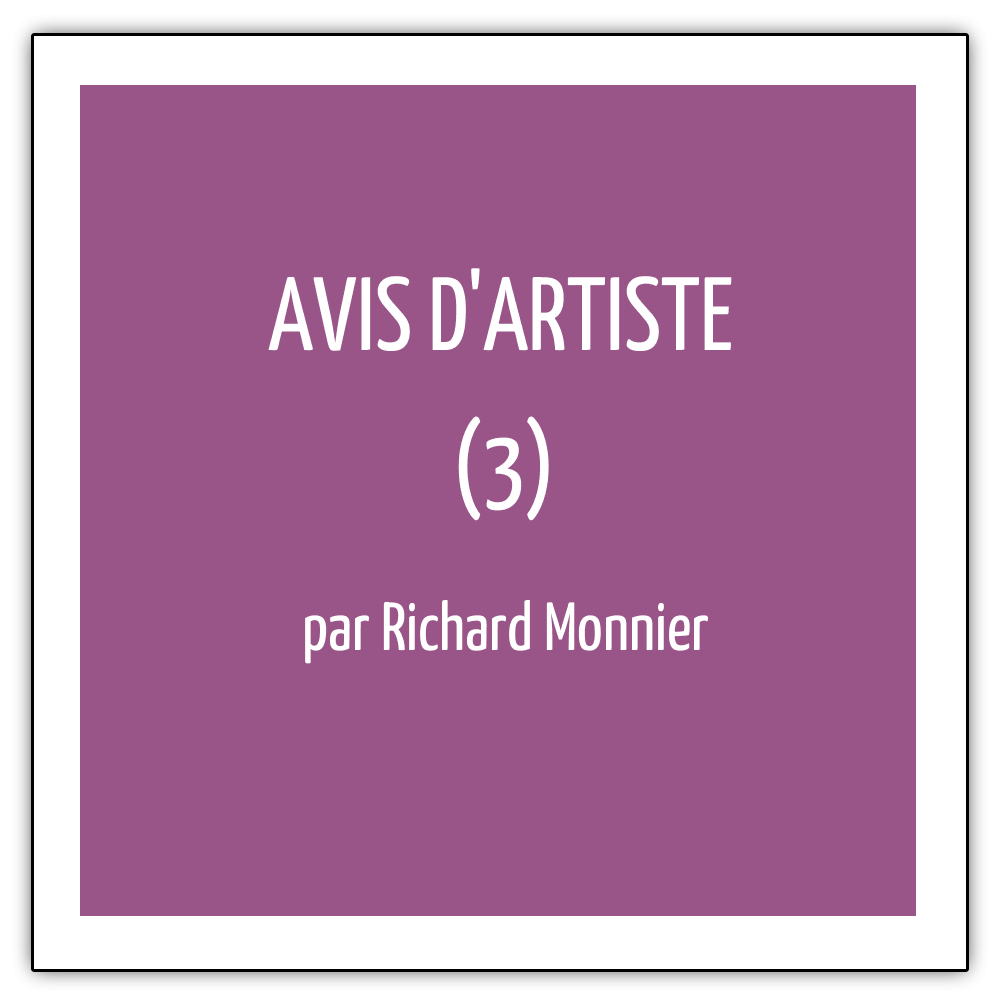AVIS D'ARTISTE (3) par Richard Monnier
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Première lecture
Dans son essai "Traces, Racines d'un paradigme indiciaire" Carlo Ginzburg suggère que "Le chasseur aurait été le premier à "raconter une histoire" parce qu'il était le seul capable de lire une série cohérente d'événements dans les traces muettes laissées par sa proie." (empreintes dans la boue, plumes, boulettes de déjection etc.) et il voit là, en précisant qu'il s'agit d'une "hypothèse évidemment invérifiable" : " le geste peut-être le plus ancien de l'histoire intellectuelle du genre humain : celui du chasseur accroupi dans la boue qui scrute les traces de sa proie." (p. 243 et 247)
Difficile de ne pas voir une douce provocation ou au moins une trace de dérision, dans le fait d'associer en une seule image le premier geste intellectuel humain avec un primate accroupi dans la boue. Plus loin, C. Ginzburg précise que son hypothèse peut être renforcée par " le fait que les figures rhétoriques sur lesquelles reposent encore aujourd'hui le langage du déchiffrement relatif à la chasse – la partie pour le tout, l'effet pour la cause – peuvent être rapprochées de l'axe prosaïque de la métonymie." L'historien émet là une hypothèse vivement paradoxale : une figure de style censée être un moyen d'enrichir notre langage, serait en fait une forme antérieure à l'invention de l'écriture, et plus encore, elle aurait conduit notre primate à devenir lecteur avant d'avoir appris à lire. Ce renversement de perspective est aussi un renversement de valeur. Le cliché de l'homme préhistorique armé de sa massue laisse la place à ce que j'appellerais un primate éclairé. À partir de ce nouveau point de vue, je n'ai pu m'empêcher d'imaginer d'autres hypothèses "évidemment invérifiables".
Après avoir satisfait une première faim, notre primate éclairé s'est redressé et, fort de ses nouvelles capacités d'observation, a porté son attention sur les traces de ses propres pas qui elles aussi recèlent de nombreux indices. Bien sûr, comme il ne se faisait encore aucune idée de sa petite personne, il n'avait pas le souci d'authentifier ses empreintes digitales mais il a pu reconnaître dans la trace de ses premiers pas quelque chose de beaucoup plus essentiel : le fait qu'il marche debout (les paléoanthropologues ont pu dater l'époque où l'homme a commencé à marcher debout grâce à des traces de pas pétrifiées). Bien avant de se projeter dans des visions panoramiques de l'horizon, il a pu ressentir quelque satisfaction en contemplant ses empreintes qui le représentent marchant : une façon de se voir à distance, le premier moyen de se distinguer.
De même qu'il a pu suivre le parcours d'un animal suivant ses traces, il a pu suivre le déplacement d'un congénère. Suivre pas à pas, c'est se donner la possibilité de décomposer et de recomposer le mouvement image par image, les historiens du cinéma l'ont bien noté, mais cette action peut entraîner une conséquence d'une tout autre portée : en décomposant, j'oserais dire, en discrétisant une certaine distance en une suite de pas consécutifs forcément identiques, notre primate éclairé a fondé rien de moins que la première unité de mesure qui est encore utilisée aujourd'hui, et cela, sans savoir compter. Au vu de ces acquis qui honorent nos ancêtres, on se demande pourquoi il a fallu aller sur la lune pour se rendre compte qu'un petit pas pour l'homme est aussi un grand pas pour l'humanité. Notre primate éclairé en était déjà convaincu sans même y penser.
En marge de son texte, C. Ginzburg note que de grands auteurs ont déjà signalé cette situation paradoxale de l'homme qui lit avant l'invention de l'écriture, mais lorsque W. Benjamin, par exemple, s'étonne : "Lire ce qui n'a jamais été écrit.", il parle en fait des haruspices qui lisent dans les viscères des animaux et qui sont déjà considérés comme des savants dotés du pouvoir de prédire l'avenir. Roger Étiemble a lui aussi relevé cette situation paradoxale, mais c'est pour mieux orienter son intérêt sur les origines de l'écriture et non sur ce moment bien antérieur aux pratiques qui sont déjà des acquis d'une société évoluée. Même C. Ginzburg n'en fait qu'un cas particulier du "paradigme indiciaire" dans une théorie plus générale qu'il nommera la "microhistoire".
L'expérience du chasseur-lecteur se situe dans un temps à proprement parler pré-historique, elle est contenue entre un fait passé récent (les traces de passage de l'animal) et un futur immédiat, le but de la chasse étant la capture d'une proie, point final. Comme les traces sont éphémères, le chasseur-lecteur ne vit là finalement que des histoires courtes qui ne laissent aucune trace. Néanmoins, en se concentrant sur un besoin vital, il a assuré sa survie et celle de notre espèce, sans faire d'histoire. Et c'est en se penchant sur les menus faits qui conditionnent son existence qu'il a réussi à cultiver sa disposition à la lecture. Ainsi formulée, la condition du primate éclairé est tout à fait actuelle. Je m'y reconnais. Dès le début du 20e siècle, Kiki-la-doucette, le chat de Colette, avait bien saisi l'essence de la condition humaine : " un Deux-Pattes qui gratte". Il avait bien compris que l'homme ne chassait plus de proies et qu'il cherchait à satisfaire d'autres faims, mais toujours debout, toujours à la recherche "de séries cohérentes". Même si aujourd'hui, tout semble déjà écrit, indexé, tagué, remixé, je cherche encore à " lire ce qui n'a pas été écrit ", ce n'est pas un choix, c'est ma condition.