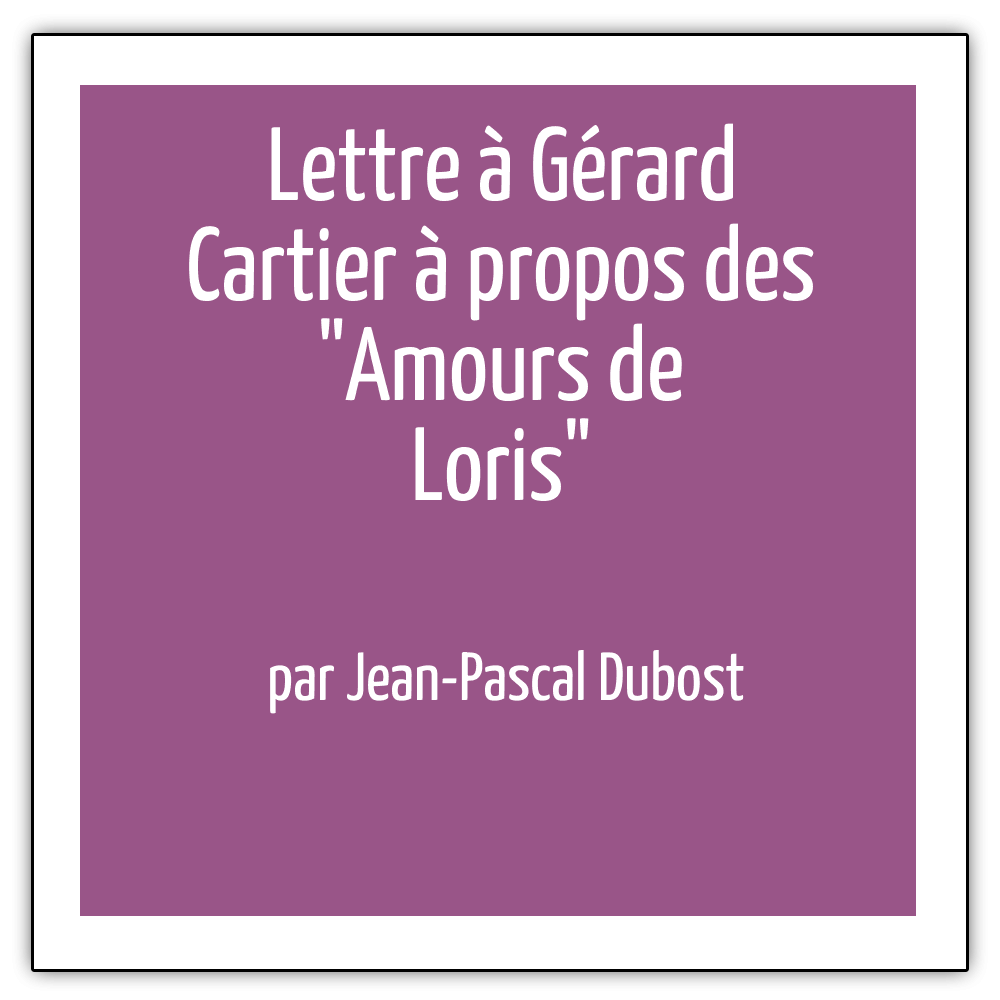Lettre à Gérard Cartier à propos des « Amours de Loris » par Jean-Pascal Dubost
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Lettre ouverte à Gérard Cartier au sujet de "Les amours de Loris »
Paimpont, le 14 août 2025
Cher Gérard,
L’emploi féminisé du mot « amours » place ton livre au cœur d’une toile linguistique, puisque, dans l’ancienne langue française, et au pluriel notamment, ce mot s’accordait au féminin, particulièrement en poésie, (tandis que la prose tendait à le masculiniser). Les poètes courtois, quant est d’eux, chantaient la fin’ amor. Cette petite digression liminaire pour en venir au fait que, en amateur et connaisseur de l’épopée, c’est à une épopée du mot « amour » à travers l’histoire littéraire à quoi tu convies le lecteur. Ton livre navigue dans le temps. Tu prends pour point de départ et pour horizon d’écriture cet auteur que je pense peu lu, Ovide, démarrant, de fait, depuis un de point de vue ovidien d’éloignement sinon d’exil mental volontaire afin d’observer les amours avec distance. Tu recours à son Art d’aimer et à ses Remèdes à l’amour, comme sites d’observation, mais Ovide est également auteur des Amours, dont on ne peut faire abstraction (il m’a semblé en percevoir quelques échos). Usant à son instar d’un ton didactique, mais aussi quelquefois élégiaque, mélancolique ou nostalgique mais d’un lyrisme contrôlé, tu distribues des conseils d’amour à un destinataire vague et anonyme, à une fiction d’amant, qui pourrait être l’auteur aussi bien. Construit en trois parties, ton livre est programmatique : la première partie, « L’art d’aimer », dit « apprends à aimer » ; la deuxième, « Les amours de Loris », suivant le fil des saisons ainsi que le firent maints poètes anciens pour noter l’usage du temps sur les amours, est une injonction, « profite d’aimer » ; et la dernière, « Remèdes à l’amour », propose des solutions de guérison de l’amour. La partie centrale ayant le ton ronsardien de qui regarde la femme avec le désir inusable d’éternel amoureux. Partant du constat que « « L’amour est une façon de guerre » (c’est un leitmotiv chez Ovide, « L'amour est une image de la guerre » in Art d’aimer), où les blessés et les morts sont nombreux, et la défaite souvent la fatale issue (générant une poésie amoureuse essentiellement plaintive ou complaintive, sinon dolente : « la solitude/est l’amie de ceux qui ont choisi de souffrir » écris-tu en écho à cela), nonobstant ce, tu enjoins l’amant au combat, à la conquête, à la vaillance, car « l’amour n’est pas une partie de plaisir ».
Cela faisant, tu valorises une œuvre dont les poètes contemporains mésestiment la valeur (la lisant peu ou prou), dont il sont assez insavants, qui négligent royalement l’hypotexte antique, et on appréciera la manière généreuse d’un auteur de ce temps (toi) nous conduisant vers autre plus ancien (je repense, dans un autre registre, aux recyclages de Martial par Christian Prigent, aux « catulleries » de Jude Stéfan ou bien encore à Emmanuel Hocquard et ses élégies) ; ton livre propose une relecture d’Ovide sinon une incitation de lecture. Et s’il est un pastiche de plusieurs de ses textes, c’est aussi un palimpseste épique, assavoir qu’il dessine un tissu des amours à travers l’histoire littéraire, les combats menés pour gagner le cœur aimé dans les textes, entremêlant littérature, mythes et contemporanéité (avec toutefois une attirance marquée vers le passé). Le lecteur reconnaîtra maints vers ou motifs empruntés aux poètes du passé ; alors le poème pourra avoir quelquefois l’aspect d’un centon, mais d’un centon de très grande densité. Voici une vaste épopée à travers la poésie amoureuse.
Néanmoins, le pastiche porte une intention en soi et dissimule malicieusement un petit traité d’art poétique. Un traité qui, pareillement aux conseils de Du Bellay exprimés en sa Défense et illustration de la langue française, suggère expressément d’imiter les anciens (« imite les poètes/qui d’un petit Liré font un mont Palatin »), de se constituer un fonds littéraire avant que de s’aventurer dans l’écriture poétique, louant la force des mots quand ils sont versifiés, louant et surtout cela, l’excellence de la langue française (sinon sa précellence) exhaussée par le latin, comme tu le fis déjà (notamment dans Du franglais au volapük ou le perroquet aztèque, paru aux éditions Obsidiane en 2019) ; une langue française qu’il faut savoir étreindre avec connaissance et amour. L’art d’aimer est chez toi l’art d’aimer l’écriture, la langue et la poésie. Distribuant les conseils d’amour, tu glisses çà et là quelques préceptes d’écriture, « pas de mots pénibles/qui obombrent l’esprit aucun ptyx/d’inanité sonore […] sois habile en secret bégaie un peu/un entretien uni et des mots caressants/ mais sans recherche », préceptes qui délivrent parfois quelques allusions polémiques. Puisant dans l’histoire de la langue française, tu consolides et répands, ce faisant, comme dans tous tes livres, ton amour pour icelle, qui se manifeste, et en ce livre plus que jamais, par une certaine sensualité d’écriture perceptible dans un rythme bien particulier, où la ponctuation s’établit à l’aide de blancs dans le vers, mariant l’œil et l’oreille, de barres verticales ou de puces typographiques. Les amours de Loris sont aussi les amours de Gérard Cartier pour la langue française.