transparaître de Séverine Daucourt par Yves Boudier
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
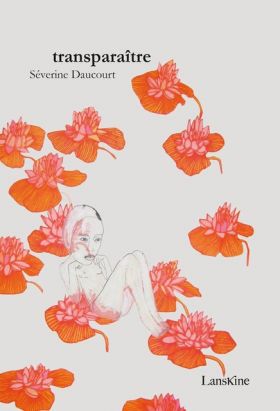
Il y a deux ans, avec la publication de Dégelle1, Séverine Daucourt poursuivait un parcours d’écriture exigeant en courant le risque d’une lucidité capable de retourner contre soi l’instrument virtuellement létal d’une quête de vérité engagée au plus incarné d’une histoire intime en miroir de l’Autre, quelles que soient ses fragmentations jusqu’à celles du cadre spéculaire. C’est en ce sens, celui de la brisure, celui des effets du travail sur les blessures portées par des fantasmes en parade à la détresse quotidienne face à la vacuité du monde, que j’abordais cet ouvrage saisissant et je répète ici les mots mêmes de mon commentaire d’alors. Je ne soupçonnais pas la valeur prémonitoire de ces poèmes.
Aujourd’hui, transparaître, plus que de simplement s’inscrire dans un sillage redoublant une quête éprouvante de subjectivation, décline sans fard, dans le dépassement général d’une incorporation mutilante, d’un corps mis à nu, les étapes et les éléments d’une métamorphose, d’une résolution possible du parcours qui conduit de soi à soi, chemin de croyances dessillées au prix d’une anamnèse sans pitié car devenue consciente du risque de la ravageuse reproduction générationnelle : « je suis entrée en maternel un peu trop tôt » (p. 65).
Ainsi, transparaître ne cesse-t-il pas, page après page, de multiplier les palpitations d’un retour sur un passé peu à peu dépouillé de ses leurres, lavé des figures chroniques d’élans fantasmés qui parfois font basculer dans une perte de réalité mortifère tenant lieu, sous une forme mensongère et exaltée, d’un consentement factice au sentiment de pleinement vivre. Le corps, jour à jour, encaisse, provoque sa propre dispersion, entretient la confusion entre plaisir et jouissance, instruit contre lui-même le silence des actes qui le dépossèdent et le condamnent à se reconnaître sous une identité fallacieuse qui coupe la parole et dessaisit de la capacité d’un retour sur soi, de la perception possible d’une image acceptable, d’une adhésion non pervertie au quotidien et à l’usure de l’âge.
En effet, comment passer d’un sujet qui vit le traumatisme originaire et le reconduit, sujet d’un aveuglement noétique, à un sujet de la connaissance, précisément celle de soi, pour atteindre au-delà de l’ineffable, de l’imaginaire et du compromis, cette zone ardente où coïnciderait celui de l’énonciation et celui de l’énoncé. Là, il ne serait plus question d’éprouver, jusqu’à souvent tourner en rond sans trouver d’issue, les affres et les remaniements identificatoires, les aveux mensongers qui englobent et paralysent, mais d’entrevoir dans ses propres gestes un rai de lumière libératrice de l’enfermement enfin fissuré par l’effort d’écriture, une échappatoire hors de cette gangue paralysante que chacun méconnaît d’autant mieux qu’elle est construite par celui-là même qui initie son émancipation.
Que l’on se réfère à Platon, Descartes ou Lacan pour épeler les stades de cette course vers une vie possible, Séverine Daucourt démontre avec transparaître que seul le poème peut offrir à un tiers lecteur la possibilité de ressentir ce qui fut le parcours de cet(te) autre à l’image de soi, de comprendre comment peut croître et germer dans un acte apodictique et dantesque l’aliment du grand jeu de nos complicités humaines, ferment d’une fraternité poétique émancipatrice.
transparaître éclaire par un poème en récit l’énigmatique formulation freudienne « Wo Es war, soll Ich werden »2 qui, jouant sur l’homophonie entre le es, le Ça, et la lettre S, initiale du sujet et faisant à son tour du Ichà la fois le pronom et le Moi, peut se traduire alors par ce raccourci lacanien volontaire et performatif : J’adviendrai3,tout entier contenu dans ces vers : « j’oublie d’être envahie / par ce qui me tranche / en deux » (p. 18), forme d’aveu et conscience naissante du chemin à parcourir pour lever la barre qui obère l’invention, au sens originel, d’un sujet averti.
Tentons de reconstruire, au fil tranchant de ce livre, le parcours à la fois singulier d’une écriture intime et d’une forme de confession faite à soi-même hors de toute velléité de pardon, de rédemption, ni même d’une interprétation apaisante qui ne serait que tromperie émolliente. Un parcours dont la puissance évocatrice est d’autant plus forte qu’elle refuse les faux-semblants d’un esthétisme poétique au profit d’une épellation réaliste, certes en vers, de la vie quotidienne, de l’ordinaire du jour et de la nuit qui enchaîne nos gestes auxquels il faut trouver une cohérence et à défaut, du sens.
L’héritage du sang ouvre la course. « […] les femmes sont ensanglantées / C’était et je ne voudrais pas m’en souvenir c’était au déclin de la / beauté » écrivait Apollinaire au cœur de Zone, en 1913. Un siècle plus tard, celle qui en revanche veut s’en souvenir, se fonde pleinement sur une dramaturgie du sang qui donne à entendre en profondeur le sens du mot règles, dont le pluriel indique ce qui lie la femme naissante à la dynastie des mères : « je me tiens debout pourpre et ensanglantée / je veux dire femme et ma mère / m’ordonnant d’effacer tous ces avantages / ne sait ni ce qu’elle creuse / ni qu’elle me troue davantage » (p. 55), « poème mensuel / sans mansuétude mentale pour la santé / mes règles chéries » (p. 96), « la surprise de mon sang / ne devait pas m’empêcher d’être prise et / reprise sur le fait d’être une femme » (p. 97), « la fin imprévue de ton enfance venait de surgir / là / sans prévenir / me plongeant en moi-même / dans une nostalgie déferlante »(p. 136). « [...] comme des mères / Filles de leurs filles »4, pour entendre de nouveau le poète assassiné.
Transparence et voile d’une transmission. Violence et sidération devant un refus qui conduit à l’acquiescement, « je me désinfecte à coups d’intelligence et je crois que ça va cicatriser » (p. 95), jusqu’à souffrir de cette implacable double perte, celle indicielle de la sortie de l’enfance, puis celle infertile de la disparition de la capacité d’engendrer. Double douleur entre les marques de laquelle une femme, « coincée dans ma demande / que je crois être offrande » (p. 50), peut choisir ou concéder d’y engendrer pour repousser ainsi la frontière parfois ressentie d’une existence sans maternité, pour conjurer « d’être trop ou de ne pas être assez » (p. 33) et trouver comment combler ce « on est toute trouée de partout » (p. 123). Une épreuve de la cruauté, redoublée au cours du temps fertile par la violence des avortements, comble de la tragédie du sang et de la condamnation sociale : « (j’entends les reproches) / accomplir son désir toucher au but / est plus fort que la raison / sinon pas d’addiction pas de jeu / avec le feu »(p. 64).
Puis vient le temps du consentement et celui de la question des limites, celles que l’on s’impose ou que l’on impose autour de soi. Comment en effet, garder un rien de quant-à-soi lorsque la défense se perd d’un corps en proie à la contradiction de pulsions d’une imitation doxique-toxique et au refus des masques qui déguisent le regard que l’on porte sur soi, un regard paradoxalement terrorisé et fasciné à la fois par la grimace dont on soupçonne la possible apparition et le pouvoir de séduction : « très tôt je suscite ce qui me dépasse / suis-je la seule / ou le sort d’une femme ? » (p. 43).
Comment partager ce qui relève du désir et reste encore vivant après l’humiliation sexuelle et le presque carnage physique, « on ne sent pas la douleur / dans ces états d’hors-soi » (p. 51), de ce qui au fond de l’être continue d’orienter, de donner un indice de valeur à « ma chair / acceptable quand elle cesse d’être sous la pression / quand elle élude le vouloir de l’autre / la haine cesse / le corps se rencontre / et se rend compte / qu’il n’a plus de compte à rendre » (p. 71) ? Comment enfin, rompre avec un passé qui pour autant a conduit où l’on se trouve pour l’évaluer, sans reniement ni occultation, sachant que la mémoire n’a pas forme d’exuvie ? Comment pouvoir mettre en acte , au-delà du constat : « mais c’est trop décalé entre dehors et dedans », le « je veux me correspondre » (p.105), dire et accomplir les paroles et les gestes qui donneront la clef d’une « sororité » ?
Les souvenirs abondent, la mise en scène des étreintes qui se multiplient et se succèdent, « prête à me décimer » (p. 54), donne à voir sous la lumière sensible et blessée d’une remémoration douloureuse, un corps en discord avec le désir qui le précipite, parfois le retient ou le mène aux limites d’une perte sans retour, « je vais signaler ma disparition » (p. 109), « je finis par me perdre / dans le miroir / ce jeu de qui suis-je » (p. 133).
S’instaure alors une dialectique de substitution des éléments qui entretiennent la relation thème-rhème dans l’énoncé à travers l’usage de ces fragments de langue dont on ne mesure jamais suffisamment la discrète mais bouleversante puissance, les pronoms, qu’ils soient dits personnels, réfléchis ou possessifs.
Aptes à saisir et formuler ce qui échappe et pourtant relève d’un vouloir-dire au plus près de soi, les pronoms qui engagent le sujet dans son rapport à lui-même nourrissent ici le jeu complexe d’une référence troublée par l’imprécision entretenue des antécédents. Anaphoriques le plus souvent mais parfois, à l’inverse, cataphoriques dans le renvoi à une relation sémantique à venir, « je donne / me donne » (p. 137), jouant de plus sur l’aphonie des marques du pluriel (elle/elles) qui dévoient l’accès au singulier, ces éléments déictiques ne livrent leur sens qu’en déplaçant les termes de la pulsion qui va du personnel au réfléchi, qui tente de réunir les berges abandonnées d’une histoire trop vite, trop tôt commencée, consciente de complicités peu amènes, « je me désole / d’avoir joué leur jeu » (p. 121), « cessant d’être honteuse / de ma honte […] zézayant / contre une injustice / je ne savais laquelle » (p. 139).
Ainsi, comme l’arme se retournant contre soi, contraignent-ils le je qui conduit le récit à se pronominaliser, à prendre conscience qu’il n’a valeur de sujet que par l’interpellation implicite d’un tu qui incarne la figure de l’Autre, parangon polymorphe de l’entour masculin convoqué dans sa diversité agressive, séductrice, provocatrice, multipliant les mensonges qui signent son incapacité à assumer sa lâcheté. Une interpellation pesant sur le choix des mots qui l’actualisent, la remémorent et ainsi la délivrent d’un vis-à-vis clos sur lui-même et prompt à inverser le sens de l’histoire vécue pour déguiser les vraies responsabilités ; en termes clairs, pour renvoyer le féminin à la honte de soi, pour interdire le retour vers le réel à un sujet qui a pris la parole, libre des avatars qu’il incarna, « à mon corps défendant » (p. 24).
Surmonter ces contradictions pour atteindre le stade d’une réconciliation, celui d’une forme de souveraineté morale, vivable, n’est certes pas le but recherché par Séverine Daucourt avec ce livre autobiogre, pour reprendre le néologisme d’Hubert Lucot5.
Le risque encouru de remettre l’affaire sous le tapis, d’oublier « cette injonction de faire céder cet appel à intérioriser », deviendrait grand, et la perspective que propose le « j’aimais mentir / disant que cela m’était arrivé / sans savoir que je ne mentais pas » (p.78-79) serait quasiment fermée, pour le moins entrouverte sur un recommencement mortifère, une répétition des affects. Pire encore, sur la menace d’être « vouée à la disparition » (p. 117). Disparition d’une identité ressentie dès le principe, mais dont la fusion de la chair et de l’esprit qui lui donnera corps, corps engagé dans une existence partagée, comme enfantée d’elle-même, dut nécessairement se faire dans la traversée d’une douleur assumée, pensée par une écriture, celle émouvante d’un long poème venu à son heure : « […] tous les pôles sont tendus vers ce qui m’apaise » (p. 135). C’est là, assurément, la vertu de ce livre, pour « supporter le néant / renaître de [ses] cendres » (p. 87).
1 Dégelle, éditions La Lettre Volée, 2017
2 Nouvelles conférences sur la psychanalyse, (31e), 1932.
3 Traduction d’autant plus intéressante que le verbe advenir, défectif, ne se doit conjuguer qu’à la troisième personne, forme impersonnelle.
4 « Les Colchiques », Alcools, 1913.
5 Autobiogre d’A.M.75, Hachette P.O.L, 1980.