Andrea Zanzotto- Phosphènes par Christian Travaux
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
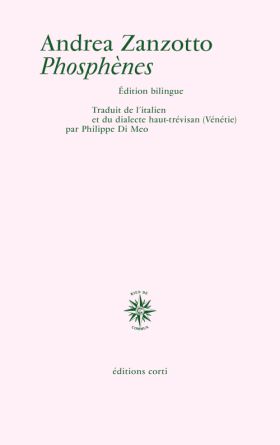
Je baisse les feux du lustre, je me jette sur le lit, et, tourné du côté de l’ombre, je vous vois, mes filles ! mes reines !
Arthur Rimbaud
Rimbaud, dit-on, frottait ses yeux pour voir apparaître des choses, des lumières, des objets, des êtres, ou les faire remonter de lui, figures venues de l’inconscient, ou sollicitées et créées par l’excitation des pupilles. Il y avait, là, chez le poète ardennais, le désir, sans doute, d’une totale connaissance de soi, pleine et entière, comme une volonté assumée de quereller l’apparence du monde et notre vision des choses, pour voir au-delà, à travers, ou pour mieux voir. Chez Zanzotto, il en est de même. Et, à lire Phosphènes, plus d’une fois, me sont venues à l’esprit les Illuminations. Le réel est un point d’appui, et notre repère dans ce monde. Mais, en le voyant, constamment, identique à notre pensée, à notre façon de le penser, on passe ainsi toute notre vie à côté de ce qu’il est vraiment, dans toutes ses dimensions plurielles, et que nous ignorons. Frotter ses yeux, faire naître ainsi des phosphènes, est ce qui pourrait, peut-être, un jour, nous faire accéder au réel dans sa plus complète plénitude, au-delà de ce voile-rideau que nous avons devant les yeux.
Et réenchanter notre vie.
24 poèmes d’inégale longueur, plutôt longs, faits de vers eux-mêmes plutôt longs, plutôt libres, tant dans leur métrique bousculée que par leur indépendance volontaire devant le sens. Rien n’est dit d’immédiatement clair. Des bribes, des morceaux, des fragments de sens paraissent et disparaissent, s’engloutissent dans le langage, dans une averse de mots, dont on ne comprend pas tout de suite les enjeux. C’est que Zanzotto dit sans dire, parle sans parler, en abandonnant des trouées, des blancs, des ellipses, évoque ou raconte sans jamais raconter, évoquer clairement. Tout commence par un paysage gelé aperçu, certainement, pas très loin de son bourg natal, Pieve di Soligo. Mais, à la différence du Galaté au bois, il n’y a, dans Phosphènes, ni forêts, ni arbres, ni nature pleine d’histoire. Juste une terre desséchée, un paysage de neige, de glace, où la poussière même est gel (p. 21). Gel, la terre (p. 93). Gel, la montagne, dépourvue de végétation, « à jeun » comme l’écrit Zanzotto (p. 123). Toute la végétation est givre (p. 31). Une « plume d’oiseau-déjà-neige » (p. 125), à « 9 degrés en dessous de zéro » (id.). Il n’y a que des châteaux en ruines (p. 33). Même le bistrot, au coin, est ruine, panneaux, et cloisons défoncées (p. 87), porte barricadée (p. 35), « sur laquelle on bat bat en vain / des poings » (id.). Et le journal […] n’apporte aucune nouvelle (p. 131).
Un tel paysage n’est pas sans rappeler celui, désolé, de la Caïna, chez Dante, le lac gelé dans lequel flottent les damnés les plus lourdement condamnés, le cœur des Enfers. Mais une campagne hivernale, de givre, de neige et de glace, n’est pas seulement une terre nue. Elle est, d’abord, elle est aussi une terre pleine de lumières, qui peuvent aveugler et blesser. Et Zanzotto de relever, dans ce qu’il lit du paysage, toutes les choses qui scintillent (p. 21), « un très âpre frémissement azur » (p. 35), « des sentiers-lunes [qui] trottinent vers partout » (p. 75), des « brumelettes » aveugles (p. 91), un « pétillement de soleils » (p. 93), et des « soleils qui égouttent [des] fèces de miel » (p. 95), un « cristal séismé des diaphanités » (p. 125). Cette brillance éblouit, au point qu’il faut, comme Rimbaud, se frotter les yeux (p. 57), et, dans le « frottement des yeux-pluie », comme le dit Zanzotto (p. 59), voir autrement, d’autres choses, faire surgir d’autres éléments du paysage contemplé, ou faire resurgir, remonter, d’autres choses de soi, du passé.
Ainsi, peut-on lire, en sous-main, dans Phosphènes, une histoire passée, d’amour, de désamour, dont on n’a jamais que les ruines, les restes, les débris. Ce paysage de ruine, de gel, et de givre, est aussi le sien, celui de son intérieur, dévasté, brisé et détruit, à jamais méconnaissable. Les mots cachent la vérité du dire. Et c’est aussi pourquoi, sans doute, cette langue de Zanzotto est si particulière. Car il lui faut trouver une langue pour dire ce paysage de neige, transformé, comme pour exprimer l’intérieur de soi, anéanti. Sous la neige, les choses se transforment. Le paysage efface les formes, en crée d’autres, est si bouleversé qu’on ne le reconnaît qu’à peine, et qu’une autre terre apparaît, bien différente. Dans l’amour, et le désamour, c’est la même chose, la même ruine, la même transformation, dévastation. Et les repères sont brouillés. Aussi Zanzotto se doit-il de pratiquer, dans la langue, une autre langue, dans l’écriture, une contre-écriture, qui changera celle existante pour faire naître d’autres usages, et faire voir d’autres images.
Dire le paysage bouleversé, modifié, métamorphosé (intérieur comme extérieur) impose de trouver d’autres mots. Aussi est-ce par tout un lexique profondément renouvelé que la voix poétique progresse. Et ce sont mots-valises, mots rares, néologismes de toute espèce qui fleurissent dans l’écriture. Soit ce sont, simplement, des mots agglomérés les uns aux autres, qui créent d’autres réalités. Et l’on trouve « rasd’ombre », « rasdeterre », « fauchelunes » et « fauchesoleils ». Ou soit ce sont des mots, construits à partir d’une base lexicale existante, mais qui n’existent pas. Ainsi « nuits lunâmes », « imoiité », « prêtraillons », « célestialités », « pardonnation », ou « nôtritude », paraissent-ils comme autant d’éclats de langue, d’éclats de neige, sur le paysage de la page. Paronomases, onomatopées, mots d’autres langues, langue dialectale, chiffres, ou blancs placés dans les vers, créent, ainsi, une étrange voix qui vient faire paraître, dans le poème, l’étrangeté de sens que présente un paysage enneigé.
Et pour dire ce qui doit être tu, en le laissant deviner, il faut que le sens soit bloqué, buté continûment, et que l’empan du langage s’ouvre à tous les sens possibles. Aussi la phrase ne cesse-t-elle pas, semble-t-il jamais, une fois commencée, mais change-t-elle, bifurque-t-elle souvent, au point qu’une discontinuité systématique s’impose comme une règle possible d’écriture. Une image chasse l’autre, un mot l’autre. Un souvenir surgit, s’arrête, reste en suspens, comme en attente, et le texte change de direction. Les mots ouverts à tous les mots, à tous les sens, la syntaxe flottante, bredouillante, et le parler décidément tremblé de cette langue, font que Phosphènes n’est, certes, pas d’une lecture facile. Mais le sens sémaphorique, clignotant, ouvre à d’autres sens, d’autres possibles de sens, que le sens commun n’atteint pas. La collusion des mots entre eux montre combien le mot, ici, est matière modelable, à malaxer. Tant de souterrains, coins obscurs, labyrinthes, passerelles existent dans la langue, qu’on peut s’étonner que si peu de poètes s’y soient aventurés, sauf Zanzotto.
Aussi faut-il bien saluer ce maître-ès-langues, rabelaisien, cet aventurier du langage, épris de visions, qu’est Zanzotto
. Frotter ses yeux, faire naître en nous des phosphènes, c’est bien découvrir ce que nous ne voyons pas, ne voyons plus, autant que ce qui est en nous laissé de sédiments par notre vie. Phosphènes est un livre d’images, tout autant que de souvenirs. Mais il est aussi une machine à rêver, à faire rêver, de langues, ou d’un autre monde.
Réenchanté.