Camillo Sbarbaro - Le paradis des lichens (2) par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
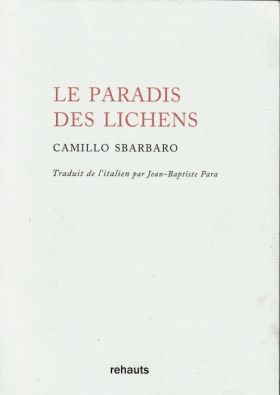
Le choix et la traduction d’un ensemble de textes de Camillo Sbarbaro (1888-1967) par Jean-Baptiste Para réjouira bien au-delà du cercle des amateurs de mousses et lichens. Cet écrivain italien, qui s’éloigna peu de sa Ligurie natale, publia principalement des plaquettes dont les titres sont éloquents : Copeaux, Feux follets, Coupons, Compte-Gouttes, Bulles de savon ; elles ont été déjà en partie traduites*, mais l’édition est épuisée depuis longtemps. C’était aussi un traducteur des tragiques grecs (Sophocle, Euripide, Eschyle) et de la littérature française, de Stendhal, Flaubert, Zola, Huysmans (pour À rebours) à Supervielle et Martin du Gard. Enfin, engagé volontaire dans la Croix Rouge pendant la Première Guerre mondiale, il y a réalisé sa première collection de lichens : il s’est passionné pour la plante et en est devenu au cours du temps un spécialiste reconnu, écrivant en latin ses découvertes, mais ses proses en italien sur le sujet visaient à faire partager sa passion. Dans sa préface, Jean-Baptiste Para écrit à propos du premier livre, Pianissimo (1914) : « mutisme du monde, mutisme de l’âme, aridité et angoisse, c’est sur ce socle premier, sans transcendance possible, que la poésie de Sbarbaro adviendra ».
Ces caractéristiques, sous d’autres aspects, sont présentes dans les extraits retenus ici. Plante fort modeste, souvent confondue par le profane avec la mousse, ou pas même vue, le lichen est à l’opposé de tout ce qui constitue les sociétés humaines qui, à de rares exceptions près, reposent sur la possession de biens (quand ce n’est pas d’humains), sur la propriété privée, et elles tendent toutes à se ressembler, à effacer les différences dans la vie quotidienne d’un bout de la planète à l’autre. À l’inverse, le lichen revêt toutes les formes imaginables et occupe tous les lieux possibles, y compris marins, et c’est « le plus polychrome des végétaux ». Sbarbaro lui-même en a découvert et décrit de nombreuses variétés et il leur donne leur nom quand il les rencontre : quand on le fait, commente-t-il, « il semble qu’on les aide à exister ». Cette émergence à la vie, cette intégration dans un classement botanique, n’empêche pas que, à l’époque de Sbarbaro, restait « une énigme » : on pouvait seulement dire avec certitude : « il appartient au règne végétal » ; on sait aujourd’hui qu’il est composé, vivant en symbiose, d’un champignon, d’une algue et/ou d’une cyanobactérie.
Quelle que soit sa composition, le lichen trouvait sa place dans l’herbier de l’écrivain, pour plusieurs raisons. D’abord :
L’herbier est un carnet d’échantillons du monde. Ressource des heures d’ennui, j’ouvre un paquet au hasard. Dans chacun il y a le monde. (…) La moindre plante que je vois, que je touche, le moindre fragment documente un point du globe ; il en est une parcelle.
Ensuite, c’est pourquoi l’herbier exclut que l’on puisse se sentir seul ; il participe à « l’inventaire du monde » mais il rassemble aussi les souvenirs de lieux donc de marches faites pour trouver les plantes, de rencontres de chercheurs, de correspondances. Enfin, pendant chaque recherche de lichens, il est à nouveau « l’enfant autorisé à faire main basse sur un magasin de jouets ». Sbarbaro n’hésite pourtant pas aussi à minimiser ce que représente la vie pour lui, « recueillir de petites herbes, écrire de petits riens ». À la question "Pourquoi le lichen", la réponse s’accorde avec tout ce qu’il écrit, « Forme négligée — pauvre ? — d’existence » et « curiosité, plaisir visuel, la sympathie ».
Parmi ces petits riens, Copeaux, où l’écrivain rapporte notamment qu’il regarde ce qui n’intéresse personne, semble cacher un mystère ; ainsi, il choisirait volontiers l’activité sans aucun intérêt d’un clerc de notaire « pour pénétrer le secret de la petite place moisie » qu’il traverse. Son commentaire est le plus souvent acide, sans illusion sur ses contemporains et sur lui-même ; ainsi, « Je connais cette rue comme ma vie et l’une et l’autre sont un même désert. » Pour supporter ce qu’est la ville, il la transforme par l’imagination et quand il pense une autre vie, ce pourrait être celle d’un petit fonctionnaire dans une ville sans intérêt, « Ce serait un suicide tranquille et décent ». Un désenchantement analogue parcourt les pages de Feux follets, « Bonheur, je ne t’ai reconnu qu’à ton bruissement quand tu t’es éloigné ». L’argent, devenu une valeur dans nos sociétés consuméristes, est associé au poison, à une drogue dont il faut se débarrasser. Sbarbaro ne perçoit pas toujours ses contemporains négativement, en particulier quand ils connaissent comme lui la pauvreté ; il remarque l’importance alors des fenêtres, « richesse des pauvres », moyen pour eux de voir et d’écouter les passants et « dans la vie de tous d’oublier la leur. »
Sans être passionné par les lichens, ou toute autre plante, on appréciera l’écriture de Sbarbaro, souvent elliptique, sans fioritures. Malgré son rejet d’une société estimée sans consistance, son sentiment d’y être souvent étranger, il sait exprimer son amour des choses, du jardin sauvage dans la ville, de la fragilité de la ballerine semblable « à la rose qui s’effeuille quand on la respire. » Ce choix de textes d’un écrivain peu connu en France, admiré par Carlo Emilio Gadda, est une belle découverte, d’autant plus agréable que l’ensemble donne l’impression d’avoir été écrit directement en français.
* Deux volumes de traductions ont paru en 1991 aux éditions Clémence Hiver, Pianissimo suivi de Rémanences (B. Vargaftig, Bruna Zanchi et J-B. Para) et Copeaux suivi de Feux follets (J-B. Para).