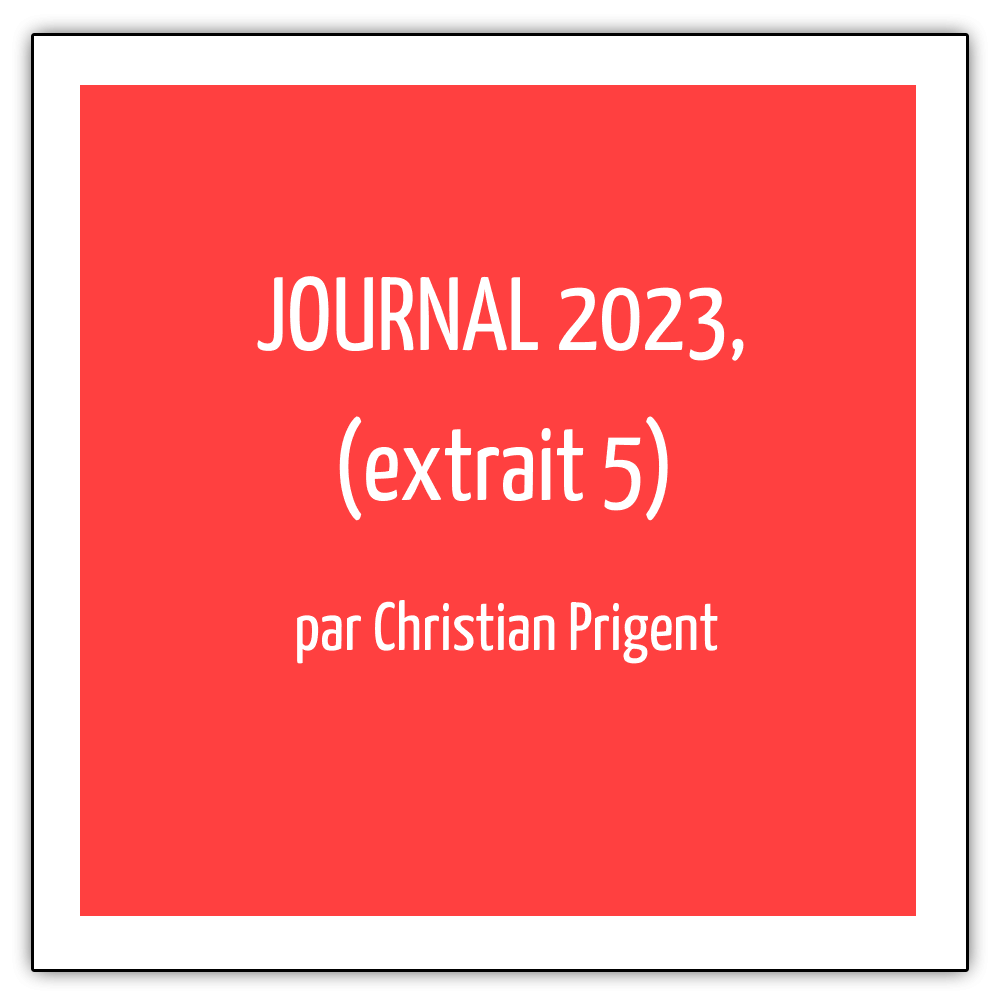JOURNAL 2023, (extrait 5) par Christian Prigent
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
01/07 [un acteur]
1984, Paris XIVème, Boulevard Edgar Quinet, je frappe à la porte de Jean-Pierre Léaud. C’est pour une nouvelle séance de travail sur quelques textes de mon livre Peep-Show que l’acteur doit lire au Centre Pompidou dans le cadre de « La Revue parlée » de Blaise Gautier.
« Ah, c’est vous… » : il m’ouvre, manifestement à peine sorti du lit.
Slip et marcel mous sous peignoir gris ouvert, pantoufles.
A besoin d’un bol de Ricoré pour émerger un peu.
Ça fume, la petite cuiller tourne.
On se met au travail.
Il lit quelques pages posées sur des miettes entre les bols.
Sans conviction, avec une sorte de fureur dépitée.
Quelques efforts pour « mettre le ton », comme on dit.
Fréquents raclements de gorges — sonores, sur-joués, ne décrochent rien.
Finit par déclarer qu’il n’y arrive pas.
Il n’y a pas de place pour lui, dit-il, dans ces textes où « tout est mis en place dans votre tête ».
Pas de place pour l’acteur : je pourrais prendre cela pour un compliment mais ne suis pas sûr de comprendre ce qu’en vérité il veut dire (je ne sais rien du théâtre, des acteurs, à cette date — guère davantage depuis).
Et je n’oserais pas contredire, même discuter : trop déférent, trop intimidé (c’est Antoine Doisnel qui dit ces choses au cinéphile extasié que je suis, au fan).
Je sens surtout qu’il n’y arrivera en effet jamais : que ce genre de texte n’est pas pour lui, pour l’acteur de cinéma qu’il est (celui de Truffaut, etc.).
C’est une erreur de casting.[1]
De fait, ça ne se fera pas. Me téléphonant pour se retirer, in extremis, du projet, Léaud, buté, ne me donnera aucune explication (« c’est comme ça », dira-t-il).
En effet…
C’est en effet « comme ça » que les petites scènes de ce Peep-Show en rien écrit pour le théâtre sont faites : brefs mécanismes verrouillés chacun par des rouages formels rhétoriquement joueurs, mais voulus sans « jeu » — sans flottement des articulations verbales, sans suggestion d’un hors-texte, sans interstice pour l’interprétation.
Où donc, il n’y a rien à « jouer » du côté de la mimésis (situations plus ou moins vraisemblables, psychologie, expression d’affects…).
*
04/07 [une actrice]
Vanda Benes, bien plus tard (dans sa mise en scène de 2010), reconnaîtra cela d’emblée. Et travaillera en fonction : ne s’occupera (cette restriction est le sens même du geste de Peep-Show) que de dessiner (non de jouer) des scènes : en rendant audible la gestuelle verbale (cadences, coupes, tempos, lignes rythmiques propres à chaque séquence) et en la redoublant d’une gestuelle corporelle visible — en n’incarnant rien d’autre que cette gestuelle, en ne jouant que son impact formel. Ainsi, brusques arrêts sur image, poses plastiques, syncopes, litanies en cascades et silhouettages sonores feront du spectacle une pantomime parlée, in-vraisemblable, non expressive, vide de psychologie, goguenarde et sans aura — adéquate à la formalité sur-indiquée du texte et à sa clownerie mi-farcesque, mi-catastrophique.
*
10/07 [Budapest à la maison]
Classant des papiers de famille, je tombe sur un tract de 1956 : le Parti communiste appelle à soutenir l’intervention de l’Armée rouge contre les « fascistes » en Hongrie…
Souvenir de cet automne-là : ma mère, échevelée, les yeux blancs de fureur, dévale les escaliers de la passerelle métallique qui surplombe les voix de chemin de fer.
Elle vient de sortir du siège de la Fédération PCF des Côtes-du-Nord : un local enfumé à la Gauloise, puant le poêle, l’encre des ronéos et le papier humide.
Elle y a rendu sa carte du Parti, suite à la tragédie sanglante de Budapest.
Elle ne me voit même pas, qui file doux sur le trottoir opposé, vers le lycée.
Le soir : gueules en coin à la maison, repas amer, silence de mort.
C’est que mon père, lui, non seulement n’a pas rendu la sienne, de carte, mais encore a murmuré qu’il fallait bien que… sans pouvoir dire quoi sauf éclats, tessons et noms d’oiseaux.
Il glisserait bien d’entre ses dents qu’il faut peut-être moins lire la presse bourgeoise.
Mais non : L’Humanité lui atterrirait tout chiffonné en sauce dans l’assiette.
Je sens se creuser une faille entre mes parents. Il m’aura fallu longtemps (en 56, j’ai 11 ans) pour comprendre d’où elle venait. Elle est de classe, comme on disait. Ma mère : petite bourgeoisie citadine. Mon père, fils de sabotier, sort de la misère des campagnes.
Ils ne pensent pas l’Histoire en termes identiques.
Ma mère, immédiatement réactive à l’actualité, légitimement scandalisée, moralement horrifiée, mesure les choses dans le temps court ; elle peut rompre avec le Parti parce que rompre ne brise rien d’essentiel du sens de sa vie. Elle y reviendra, d’ailleurs, au Parti, la colère passée.
Mon père pense dans un temps plus long et dans des termes socio-politiques. S’il tient au PCF (dans cette organisation et à cette forme-là de l’engagement militant), c’est parce qu’il est vital pour lui que ne disparaisse pas une espérance politique aussi vieille que le monde, venue de bien avant qu’existe le mot même de communisme : l’utopie d’une justice sociale.
Espérance, utopie, justice : tous ces mots sont gros. Les esprits forts en sourient volontiers. Mais sans l’appel de ces mots ne gagnent que cynisme et nihilisme. C’est en tout cas ce que mon père a en tête. Et il sait pourquoi, vu d’où il vient.
À cette mesure-là, les événements de Hongrie ne pèsent pas, ce n’est même pas une couleuvre de plus à avaler. Rompre avec le Parti serait vider la vie elle-même de sens.
Mon père n’est pas pour autant un militant stalinien borné. Ni un naïf. Encore moins un impérialiste sanguinaire. C’est un plutarquien stoïque et humble. Il sait bien que les gros mots ont besoin, souvent, qu’on leur rabatte le caquet et qu’on joue leur musique plutôt en mineur. Aux épopées géo-politiques, aux stratégies nationales, aux actions parlementaires et aux discours de tribune, il aura toujours préféré ces actions locales restreintes qui, mine de rien, incarnent les grands mots, leur font avoir des effets immédiatement éprouvés dans la vie des gens.
Donc : 1) comme militant, la gestion municipale et la charité sociale au jour le jour ; 2) comme enseignant : la pédagogie émancipatrice.
Pour le reste : « faire avec », autant qu’il est possible, en serrant s’il le faut les dents.
Je ne dis pas (de quel droit ?) qu’il avait raison. J’essaie de comprendre. Ce n’est pas faire qu’essayer de le comprendre lui : mais une époque, un monde.
*
13/07 [pas assez bavé]
Je me souviens de mes grands-parents sabotiers comme de figures étranges, figées dans la distance à laquelle ils furent toujours pour moi.
Mon père ne faisait rien pour réduire cette distance. Sans doute pensait-il que la vie de ces gens, s’il avait tenté de m’en instruire, aurait été pour moi trop incompréhensible.
Ou peut-être que tout simplement il ne souhaitait pas que ses enfants lui volent, s’ils en avaient su plus, quelque chose de son enfance à lui.
Ils avaient connu une grande pauvreté, voire la misère.
Et (à ma connaissance) aucune conscience « politique » ne leur permettait d’en penser les causes, d’en mesurer la relativité (face aux autres pauvretés, aux richesses, aux pouvoirs…), d’en envisager la fin.
Mon père, lui, ne donnait à sa vie d’autre sens que la bataille contre ça (la misère), l’effort intellectuel à faire pour en connaître les causes (l’étude de la pensée marxiste), les actions politiques menées pour l’extirper du monde.
Moi qui n’ai eu aucun rapport concret à la misère et à l’exploitation, donc aucune nécessité objective de penser les choses dans les termes de la pensée politique des communistes, je n’ai sans doute jamais eu d’autres raison de le faire que le souvenir de mon père le faisant et celui de l’existence de mes grands-parents comme raison qu’avait mon père de le faire.
En 1960 ou 61 (j’avais quinze ou seize ans, j’étais membre des « Jeunesses communistes »), j’ai annoncé à mon père mon intention d’adhérer au PCF (il me fallait pour cela son autorisation). Il a grommelé entre ses dents sans me regarder (a grondé, plutôt, la tête rentrée dans les épaules, sans s’arrêter de balayer le carrelage des miettes du repas qu’on venait de finir) que c’était bien trop tôt, qu’on verrait plus tard.
Mais je sais ce qu’il pensait : que je n’étais pas digne, que rien ne justifiait qu’on me fasse cet honneur (d’être membre du Parti), qu’il n’y avait dans ma vie aucune raison objective, sociale, pour que je veuille en être, que je n’étais qu’un petit bourgeois privilégié et irresponsable, politiquement non fiable — bref : que je n’en avais pas assez bavé. Et de son point de vue il avait raison (même si ce qu’il reprochait du même coup à ma vie c’était d’être ce qu’il avait fait en sorte qu’elle fût).
La politique, pour moi, dans ces années-là (et bien au-delà), c’était des récits, des héros, un supplément d’âme épique, une exaltation littéraire (pas au meilleur sens de ce terme). Rien de concrètement éprouvé, d’objectivement motivé, de nécessaire. Mais qu’aurait-ce pu être d’autre, dans cette famille où d’une part on était à l’abri de tout manque objectif et où d’autre part on ne vivait que de consommer sans cesse la légende communiste (dans des livres, via des films, au gré des meetings, des fêtes du Parti et de la seule fréquentation des « camarades ») ?
Si la lecture de Rimbaud, dans ces années-là, m’a tant bouleversé c’est qu’elle faisait se télescoper cet imaginaire politique (le Rimbaud « communard » entrait bien dans le tableau) et la banale rébellion adolescente (la « révolte » activée par le malaise physique, moral et sexuel de ces âges-là) en donnant du corps à tout cela (du corps verbal : de l’incarné dans une poétique dont il n’était plus question de pouvoir se remettre).
[1] L’idée vient de mon ami Bernard Dubois, pensionnaire en même temps que moi à Rome, Villa Médicis : il y réalisait alors son film Parano ; Jean-Pierre Léaud était l’un des comédiens (avec Joe Dallesandro).