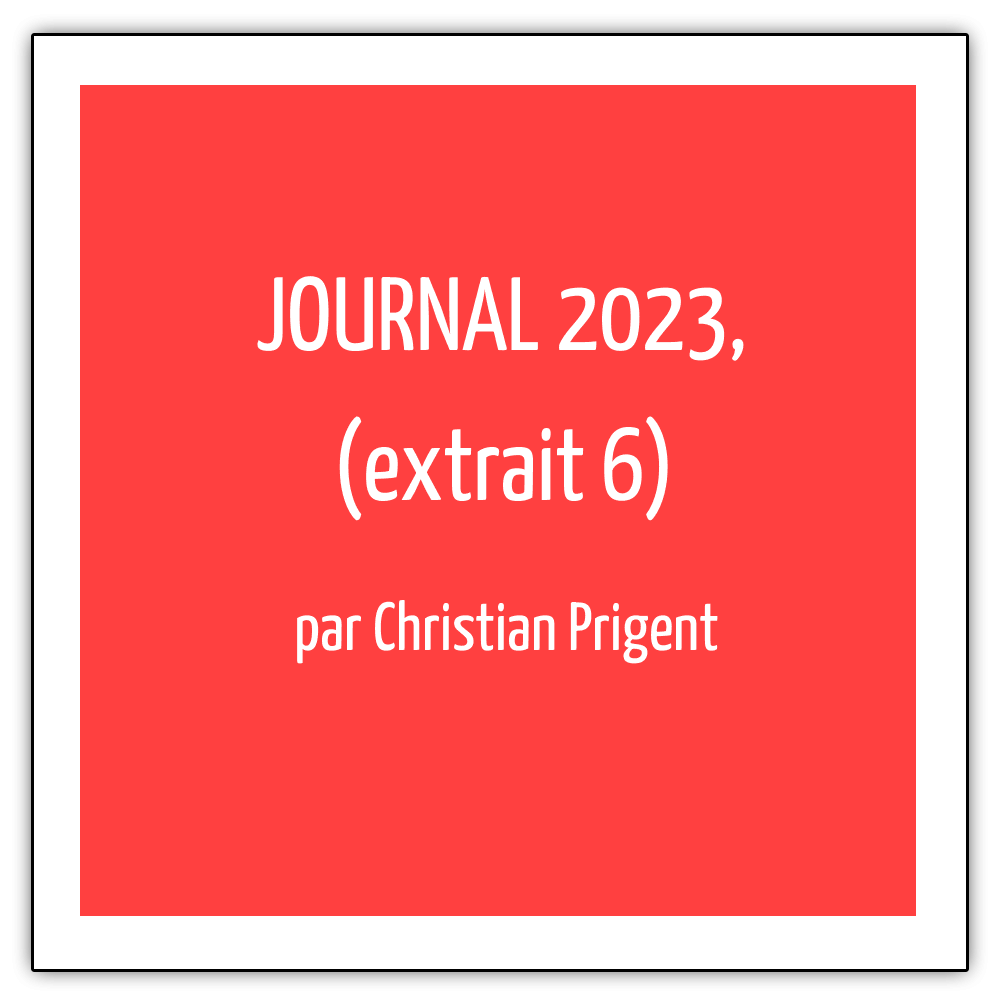JOURNAL 2023, (extrait 6) par Christian Prigent
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
01/09 [vieille vague]
Les années 1980-90 : après l’avant-gardisme moderniste (la nouvelle vague, le premier Truffaut, Godard, Rivette — déjà Straub, pas loin Chantal Akermann…) : pouce !
Voici la détente « post-moderne » : on souffle.
Retour à la psychologie romanesque, au pathos plaisant, aux familles déchirées, aux amours tortueuses, à l'ordinaire des crises de nerf.
Quelques effets de saucissonnage déstructurent le temps narratif (un coup à gauche pour le moderne) ; pas trop quand même (un coup à droite pour le classique). L’image est bien propre, rien qui bave, déroute. De même les personnages. On a juste rosi leurs joues d’un reste de blush « baroque » pour faire un peu peur au mainstream.
C’est le mobilier Restauration : le ciné re-domestiqué, guéri des aventures formelles subversives, fatigué des radicalités.
C’est le Le Lieu du crime d’André Téchiné (1986) : ronron.
*
08/09 [bout du monde]
Au bout du monde, en Finistère (pen ar bed).
Mais la sensation de bout du monde, ici on ne l’a guère.
D’autres sites la donnent vivement.
Ils surgissent par surprise, au détour d’un virage, au rebord d’une montée : ouvrant d’un coup la porte sur une attente inconsciente qui n’espérait que cet événement pour épandre son sentiment d’inquiétante étrangeté.
Il ne s’agit pas de lieux situés effectivement à un « bout » (bords de mer, seuils de déserts). Étendus plutôt au bout de rien, ne mettant terme à rien, comme suspendus (dans l’espace et le temps).
À chaque fois que surgit cette sensation, je l’associe à la Patagonie telle que je me la représentais quand je lisais (vers mes 10 ans) Le Tour du monde de deux gosses : vastitude, vacuité, grisaille ponctuée de riens (cailloux, herbes rases, quelques cabanes plates), dépeuplée de tout « monument ».
Sentant venir la fin de l’aventure qu’il contait depuis des centaines de pages, l’auteur (Arnould Galopin, l’assez bien nommé) faisait le choix de cette contrée par volonté d’extrême lointain, d’exotisme radical : l’à peine cartographié, l’inhabité par l’Histoire. Il se trouvait d’ailleurs vite embarrassé par le peu à décrire : platitude et poussière, nul évènement à espérer, un grand vide blanc calmait la trépidation du récit[1].
Se sentir au bout du monde ne dépend pas principalement d’un critère spatial (géographique). Mais d’une rencontre temporelle surprenante : au bout d’un parcours, d’une étape, dans la sensation d’échéance (enfin !) et de fatigue (pas trop tôt !) ; et au confluent de cette échéance avec une vacuité de la pensée qui tombe sur un peu d’improbable patagonie : distante, indifférente, obtuse, à peine respirante dans une raréfaction du désir touristique et un désœuvrement du savoir (géographique, historique).
Pas de « bout », en somme : juste un souffle qui s’exténue, mais ne meurt pas (sans pour autant vivre vraiment). Rien ne cesse, avec ces sites : ils se prolongent à l’infini. Non dans l’espace, mais dans le sentiment qu’ils donnent d’une étrangeté discrète, non théâtralisée (au contraire des points de vue, des « panoramas »), sans contours véritables, sans limites bien nettes.
Ces bouts-du-monde-là sont surtout d’une grande banalité : zéro pittoresque, aridité au bord du moche. Quelque chose d’usé, presque d’accablant. Mais qui émeut précisément pour cette raison : plus besoin de s’extasier, on s’abandonne au plaisir paresseux de ne pas savoir pourquoi on est tout d’un coup si ému par du qui ne semble a priori pourvu d’aucun pouvoir d’émouvoir.
*
11/09 [Lascaux en vrai]
Rêve de la nuit. Je suis devant Lascaux. La porte métallique, en partie masquée de broussailles moches, est glaciale (aux deux sens : objectivement froide, subjectivement rébarbative).
J’y fus en 1952 ou 53, avec mes parents (la grotte, qui sera fermée en 1963, était alors ouverte à la visite).
Je me souviens du vestibule : silence sonore à force d’être recueilli, l’humidité saisit les épaules, on se sent en lieu interdit, au moins secret, en tout cas maussade, ostensiblement dérangé.
Ensuite : déception de n’avoir pas le droit (trop petit, mon ami) de descendre comme les grands dans le puits de l’homme blessé.
Enfin : la lourde porte (vert bronze, un peu de rouille) refermée derrière nous, l’écart brutal de température (retour au soleil) et le silence méditatif de mon père, en short, l’œil sur ses godasses, peu disposé à la pédagogie.
Du reste (l’essentiel : les peintures) : aucun souvenir. C’est que se sont superposées, au point d’effacer toute image de ce moment et de ce lieu, les reproductions consultées depuis et plusieurs visites à Lascaux II (le fac simile de la grotte).
Mais je descends souvent la nuit dans le puits. Il est profond, quasi sans fond. Nulle vérité n’en sort que celle, sans figures ni mots, de l’entièreté massive du souvenir qui fait se répéter sans cesse le rêve. L’homme mort, c’est mon père désormais : son silence était de mort, déjà, dans ce lointain. Mais il est le bison aussi, sans doute : cette masse d’opposition au monde bavard, sa façon de regarder de haut les petits hommes à la fois agités et distraits. Et s’il perd sans fin ses entrailles, c’est comme un faisceau de signes pour moi incompréhensibles, pour lui impartageables. Alors il est l’artiste paléolithique, accroupi dans le noir et traçant au mur des images sans presque les voir, sans vouloir que qui que ce soit les voie : ne pensant, ne parlant, ne peignant pour aucun humain, élevant seulement sa prière à l’exaltant, à l'effrayant sur-humain — et, précisément pour cette raison, d’un seul coup et tout entier humain.
*
13/09 [home cinéma : James Dean en bonobo]
Elia Kazan, À l’est d’Éden (1955). Les épaules au-dessus des oreilles, James Dean fait tout au long du film des écarts de singe souple, balancé de biais, chaloupant de statures tétaniques en larmes à plat-ventre. Quelque godillot qu’il porte, sur quelque sol d’herbe, de planches ou de graviers qu’il se déplace, il glisse, lourd-léger, sur pattes de velours comme un bonobo oblique sous les feuillages.
Avec lui, une sorte de sauvagerie passe dans la raideur paternaliste et puritaine qui ferme autour l’espace. Son corps animal, ses rictus de jeune bête dolente, ses gémissements plissés, ses timidités gloussantes, ses surexcitations soudaines, même ses silences sous les grands arbres, ses recueillements dans les sillons, ses prières aux haricots, sa douceur têtue, sa force d’inertie, bref : tout ce qui émane de lui, faciès, gestes, jeu, fait souffler un vent d’animalité non domesticable.
Sous le Sinaï d’idéal positivé qui surplombe les familles d’Amérique, leurs églises pastel, leurs harmoniums dominicaux, leurs gestes industrieux et leur probité frugale, il incarne, voué à la recherche d’une mère prostituée, la part maudite : le négatif, l’autre qui ne peut décidément pas être de la tribu des hommes aux tempes glabres tirés vers le ciel par leurs oreilles bourrées de versets bibliques.
*
26/09 [home cinéma : Hitchcock, Les Oiseaux]
Pourquoi tous ces oiseaux deviennent-ils meurtriers ?
Ils sont noirs (corbeaux — oiseaux de malheur) ou blancs (mouettes emplumées de probité candide). Mais tous, les blancs (le Bien ?) comme les noirs (le Mal ?), de funeste augure.
Comme l’augure, ils laissent, narquois, le sens terriblement ouvert : le funeste de l’augure est qu’on n’y comprend rien.
Hitchcock n’explique rien, ne dessine aucune allégorie, éteint les symboles, retient méticuleusement la signification d’ensemble de l’histoire. Il fait du cinéma comme on faisait les contes anciens, ceux d’avant la résolution du genre en moralisme édifiant (Grimm, Perrault).
Le sens (caché — absent ?) est dans le sac à main de Tippi Hedren.
Quand elle file en canot à moteur vers le lieu du drame, ce sac est posé ostensiblement, énorme, au premier plan. L’héroïne est derrière, indécise, dans le flou d’arrière-plan.
Elle n’abandonne jamais son sac, ne l’ouvre jamais non plus[2].
Son ersatz (vu le contexte, c’est d’un comique goguenard) est le pochon du nécessaire acheté pour passer la nuit chez l’institutrice Annie Hayworth. Ce pochon trivial, lui, s’ouvre. Mais sur rien d’autre qu’une chemise de nuit en pilou, enveloppante, collet-monté : cache-nez mémère et clownesque de la vie onirique.
Ça fait rire.
Le film est ce sac obstinément clos ET ce pochon burlesque qui ne déballe que de l’insignifiant.
Mettons sur cela le mouchoir et passons à autre chose, dit Hitch : faisons du cinéma.
Il pose l’archétype : au revers du strict coordonné vert amande et des maquillages impeccables de Tippi Hedren (l’avers WASP puritain), il y a le grondement irrationnel, l’animalité vengeresse, peut-être la sorcellerie, la sauvagerie apocalyptique, l’effroi du fantastique — et donc, comme effet retour, l’obsession morale, le besoin de signification.
Mais on laisse à des seconds rôles occultistes, théologiens, moralisateurs ou scientistes (en tout cas affamés de sens et tous pris la main dans le sac[3] ) le soin de s’en soucier.
Au choix du spectateur, s’il veut (s’il ne peut résister à son désir d’interpréter), de rejouer ces rôles.
Le cinéaste, lui, fabrique ironiquement sa fable pastel, fraîche comme une rose d’innocence, quelle que soit la cruauté sur-jouée de telle ou telle « scène », vite crayonnée d’une main dédaigneuse : never explain, never complain.
Quelle élégance ! Quelle légèreté ! Quelle heureuse « distanciation » ! Quel hommage, par-delà le Bien et le Mal des interprétations sensées, aux pouvoirs ludiques du cinéma !
[1] Jules Verne savait remplir des pages avec cette vacuité d’action : suspens du narratif, héros désœuvrés dans des paysage de bout du monde sans qualités notables sous une météo accablante de sérénité. « Parcours sans encombre », « traversée rapide », « lointains dépourvus de tout pittoresque », « complète banalité du voyage », « aucun incident de quelque importance », etc. — et les pages tournent, dring le tiroir-caisse du feuilleton (voir Les Naufragés du Jonathan, Le Phare du bout du monde…).
[2] Vanda me fait remarquer que si, une fois : quand Tippi en sort des cigarettes, assise sur le banc devant l’école tandis que les oiseaux se regroupent derrière elle. Comme si le sac ne contenait que… de la fumée.
[3] Ainsi l’ivrogne prophétique qui a lu L’Apocalypse, la péremptoire dame ornithologue, la mère obsessionnelle.…