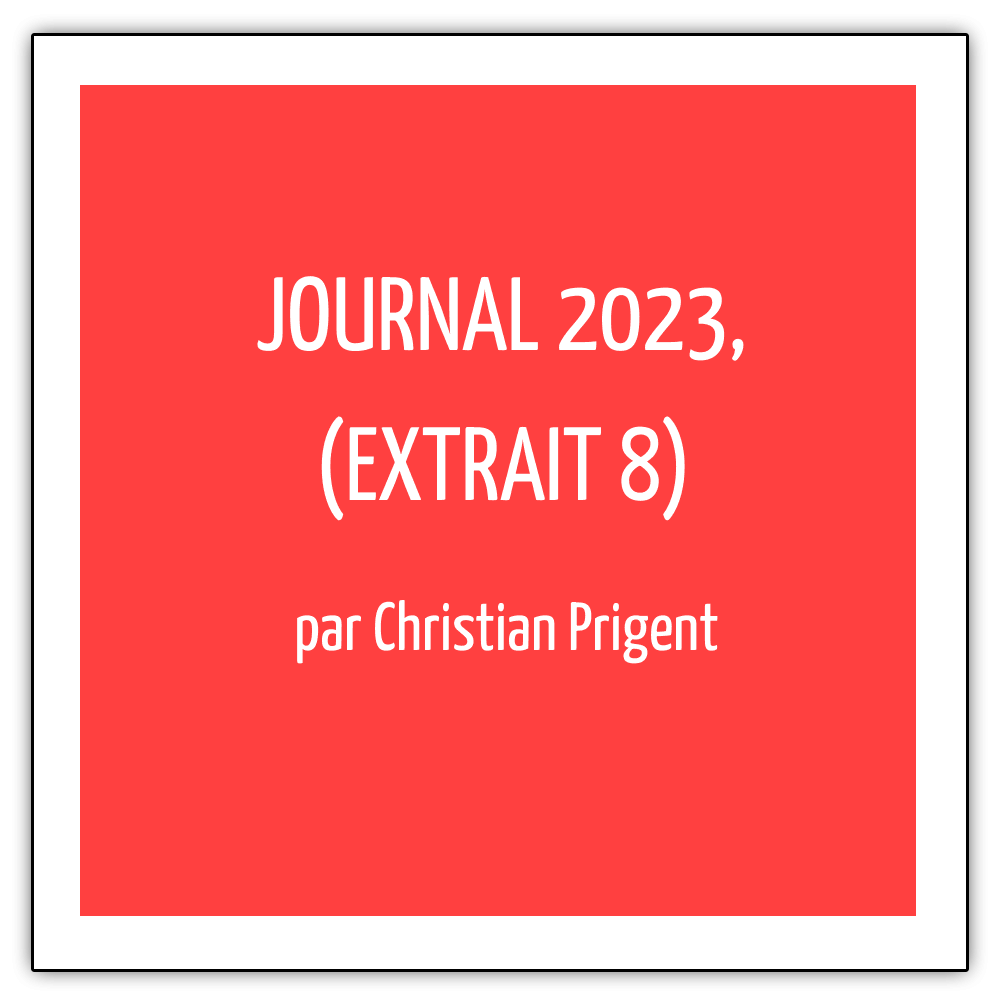JOURNAL 2023, (extrait 8) par Christian Prigent
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
10/11 [nel mezzo del cammin]
stop soulier sincère arrête
tes cochonneries humaines
sur le sentier pourri tu traînes
la mort plus que sabots sale bête
que ne mortifient tes talons
le fond gras du pré sans culotte
pauvre gazon des boutoirs t’ont
foui le poil des mottes
seul lombric sauf mais tordu
en ressort boudin d’ombilic
porte ou je t’écrase aux cliques
humiliées du sous-sol mon salut
*
18/11 [home cinéma : ex-fan des sixties]
The Chase, d'Arthur Ripley (1946) : Michèle Morgan (alors en phase Hollywood) y joue un rôle central.
Cette présence me distrait du film, m’empêche de m’y intéresser vraiment.
Car la voilà sous mes yeux, M. M., longtemps avant ou, comme on veut, un peu plus tard.
C’est en 1962 ou 63. Je suis « monté », en stop, à Paris.
Dans les salons de la gare d’Orsay, c’est la vente annuelle du CNE[1].
Les vedettes des lettres sont derrière leurs étals de chefs d’œuvre. Assises à leur côté, légèrement en retrait mais ostensiblement ornementales, des stars du cinéma populaire leur passent la pommade et les bouquins à dédicacer au peuple.
Michèle Morgan trône entre Elsa Triolet et Aragon.
Elle a de beaux yeux, tu sais.
Elsa aussi.
Les miens sont écarquillés d’un émoi de midinet poétolâtre à peine veiné d’acidité chafouine et rageuse : anch’io, bientôt…
Ce n’est pas l’actrice que je regarde énamouré.
Mais le grand écrivain cravaté et bien peigné, « l’ingénieur des âmes » qu’on vénère au fond de ma province bretonne, dans la maison où mon père lit religieusement Les Lettres Françaises.
Vus du fond du canapé devant lequel passe le vieux film hollywoodien (gangsters, smokings, la blonde Morgan en robe longue, bagnoles à chromes, palmiers de Floride et boites de nuit cubaines), tous les auteurs plus ou moins communistes, muses, poètes, comédiennes, sont, dans la distance du temps, des figurines dont je sens au bout de mes doigts la minceur de carton si je les saisis entre index et pouce pour les changer d’étagère dans la maison de poupée crânienne où tout cela désormais se passe, et passe, et s’efface : comme la figurine nommée Aragon, par exemple, ne fut plus, très vite, pour moi, qu’une poupée de vieux papier, un soldat perdu au fond du grenier aux jouets démantibulés !
*
23/11 [sous l’orage]
crrrrac ! l’air plein 1985
d’acides obliques a
zébré d’eau forte un sein
nul sinon moi ne le voit
dès que la pluie toute la
pluie du monde aura fait
tomber ses cheveux ras
mon parquet je l’aimerai
scoop : un sperme automate eût
voulu qu’un émOi de bouche
le bave mais allons à du
sec qu’on (d’abord) s’y mouche
puis le soleil du sous-bois
face aux peaux que gercent
de moche les mouches perce
mes os tremblants : vita nova !
attends je me dis de ses crâne
& con (nus) que de l’âne
(moi) ils calment l’asthme
car tentants question spasmes
mais c’est vite que s’use
le sexe (amants ils se pâment
connement nommant âme
un pneu de fébrilité confuse)
— et ssshhhh ! le bleu d’oubli éteint
l’orage obscène aux lointains
*
30/11 [question de la poésie : coda]
Position symétriquement inverse à celle des restaurateurs néo-lyriques[2] : celle de Justine Huppe dans La littérature embarquée[3].
L’auteure réfléchit sur l’engagement politique des textes littéraires contemporains (= post-avant-gardistes). Ses références : surtout des « poètes » (le post-objectivisme français : Gleize ; puis Cadiot, Quintane ; puis Hanna, Quintyn, Martinez…).
Une chose frappe : cet essai théorise sur du théorique. Pas d’analyses de textes « littéraires ». Comme s’il n’y en avait plus. Ou plutôt : comme si cette spécificité ne faisait plus sens. Comme si les textes de poésie et de fiction, c’étaient désormais les formes pensives (manifestes, programmes, analyses) ou les enquêtes sur les conditions d’apparition et les effets socio-politiques de la poésie (la poésie identifiée non plus à des formes stylistiques, voire à une certaine posture dans la langue, mais à ce programme politique et à ces façons d’intervenir socialement). Problèmes théoriques d’une part, reportages, chroniques et analyses sociologiques d’autre part sont explicitement traités comme « poésie » (comme faisant fonction de poésie — la poésie s’identifiant à ces fonctions, de pensée critique et d’utilité pratique).
Ainsi, également soucieux que la poésie ait « pour but la vérité pratique », le Ducasse de 1870 intitulait-il Poésies un manifeste fait de réflexions philosophiques, de maximes morales et d’aphorismes détournés. Le geste était exemplaire. Depuis le surréalisme, ça a beaucoup fait penser les « modernes ». On sait que ça a été à l’origine de quelques congés spectaculaires donnés au lyrisme poétique (Bataille, Ponge, D. Roche) et de commentaires un peu exaltés sur la fin toujours recommencée de la littérature (Blanchot…).
Pour autant ça n’a évidemment mis fin à rien d’autre qu’à une certaine innocence : celle de la poésie pavlovienne, impensée, abrutie de naissance et intuable d’autant.
Reste toujours ouverte la question de la spécificité du langage poétique comme pratique à but artistique, manie d’invention de langues, obsession des formes, non identifiable au méta-poétique et (au moins relativement) distinct, en tant que genre littéraire, de tous les autres.
*
10/12 [la langue sur le billard[4]]
Chaque jour, Pierre Le Pillouër a avec lui-même un rendez-vous galant dans une maison genre de poupée. Il s’y assoit sous un parapluie de poche, déployé contre la bave des opinions et l’ondée lyrique. Puis, sur une table à dissection miniature, il dispose ses outils : loupe à grossir les caractères, cutter pour scinder les phonèmes, aiguille à faufiler les syllabes à l’envers et la petite machine à recoudre.
Il observe ce qu’il y a sur la table et dit : « Oh mon d?ieu, c’est ma langue ».
Hop, bistouri !
Liste des procédures : coupes sèches (mor/-du) ; sutures homophoniques (Πaντα pεi ? / Pente à raye) ; approximations (Vers boiteux / verboten) ; hoquets de rimes (d’éner- / des nerfs) ; inversions (rêve / vers) ; bégaiements (atteint, teint) ; devinettes (TAPIedS : se les prendre dans) ; tmèses (marre (je suis) à bout) ; ratés calculés (merde noire / merle noir) ; marabouts-bouts-d’ficelles (gag / gage / gageure) ; craductions d’Apollinaire (Et tu niquEs Bardot en trempettE d’urine) ou Rimbaud (passim)…
La mécanique est de précision. Mais sans malice virtuose. Si drôlerie il y a, elle est sombre, pas « commode ». L’auteur assiste à ses propres trouvailles, éberlué que sa langue accouche de galopins verbaux qui donnent illico une vie nouvelle aux significations : surprise ! surprise !
Ces aventures verbales microscopiques constituent un « journal ». Unité de lieu : une chambre, avec dame + l’auteur. Elle éclate en facettes : split screen. Unité de temps : une journée. Elle suit son cours, mais à sauts et gambades. On passe du chou nostalgique (ô, « enfant sain » ! « temps des billes » !) à la chèvre in situ (ô nourricière « amphore » ! « déesse » tutélaire !) ; du raisin des pensées justes (un peu de gnomique[5]) à la triste figue des mots défigurés par le tremblé du sens.
Ça rappelle que plus on tente de gaver de significations la vie (dans des récits, des explications, des descriptions), plus le fond des choses (matière ? nature ?) n’en fait qu’à sa tête : débordé du temps, sans mesure d’espace, excessif aux paroles. Autant regarder directement les mots vivre leurs petits drames.
Toujours le peuple fébrile du nommé s’agite dans nos décors. La matière, elle, la vaste vie, se poursuit sans histoires et sans noms, n’ayant rien à cirer des mesures que prennent nos paroles pour affronter son défi.
À chaque ligne du texte de Pierre, on voit cet écart se creuser comiquement.
Mais il y a ceci : charcuter la langue fait vaciller les mondes qu’elle construit (les représentations qu’elle forme en phrases). Au moins la possibilité, du coup patente, que ça vacille (qu’on puisse provoquer cette vacillation) jette-t-elle un doute sur la vérité et la solidité de ce que, pour y tenir le coup sans trop d’affolement, nous appelons « monde ».
Ce n’est pas rien : qui touche à la langue touche à des fictions de monde ; qui bouge la langue bouge ces fictions ; qui découpe dans les mots tranche des liens mondains, refuse le leurre des « apparences actuelles », renâcle à la domination idéologique. C’est déjà un pas vers des actions pour le changer en vrai, le monde.
*
15/12 [nuage]
Au fur et à mesure des relectures qu’il me faut faire pour préparer le désormais proche « séminaire » briochin[6], s’épaissit sous le plafond de mon bureau le beau nuage orageux (cuivres feu, charbons) duquel je sais que sont tombées la plupart des pluies qui m’ont dès mes quinze ans à la fois abreuvé et transi.
Je n’aurai écrit que pour tenter de comprendre pourquoi et comment ceux-là (Ducasse, Rimbaud…) m’avaient fait écrire — et pourquoi eux, et fort peu d’autres (sinon, plus tard, quelques étrangers : Maïakovski, Khlebnikov, Hölderlin, Pound, Cummings… — mais une fois les choses déjà jouées).
Jamais, au fond, ne se seront différenciés ce que j’avais, sans trop le savoir, à dire (de « moi », de « ma » vie, de « la » vie) et ce que j’avais à dire de ces poètes qui me frappaient parce que ma vie et la vie ne se formaient en figures justes que dans ce que je lisais chez eux d’obscurément illuminant.
—————————
[1] Le Comité national des écrivains, organisme issu du Front national des écrivains, créé par les communistes en 1941.
[2] Mais renvoyant également aux poubelles le « textualisme » avant-gardiste (positions théoriques et inventions « poétiques ») : évitant d’en parler, le censurant délibérément.
[3] Éditions Amsterdam, 2023.
[4] Pierre Le Pillouër, Scènes d’esprit (Fidel Anthelme X).
[5] Ou, en vitesse, quelques mimes des aphorismes amers (le charbon des non-dupes) façon Cioran, La Rochefoucauld…
[6] « Révolutions poétiques : 1870/1970 » ; trois séances organisées à l’Hôtel de ville de Saint-Brieuc (février/mars 2024) par mon ami Michel Guyomard, que je remercie vivement.