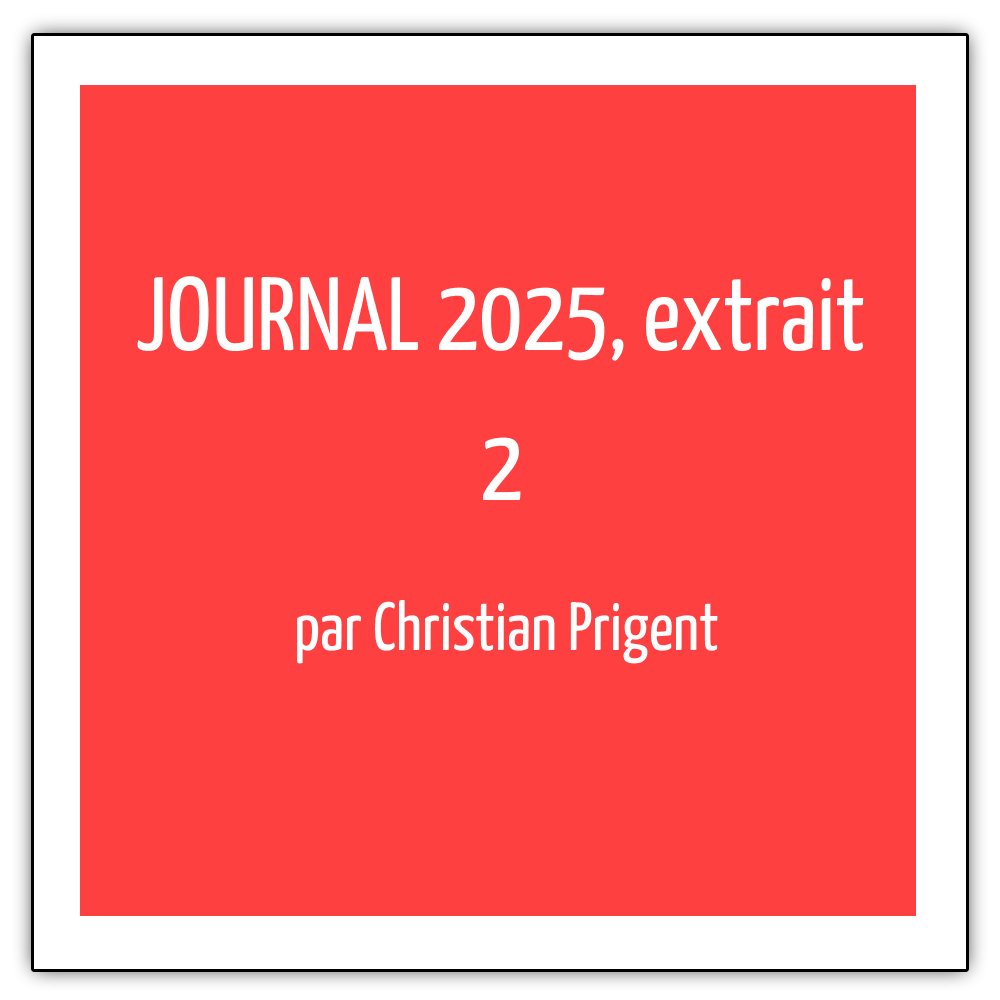JOURNAL 2025, extrait 2 par Christian Prigent
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
01/02 [l’infigurable]
Sur les photos d’Olivier Roller, je vois une figure (la mienne) vouée au défiguré, au défigurant — bientôt à l’infigurable.
Ces portraits sont des images de décomposition.
Moins au sens de défection morbide des chairs que de progressive dislocation des figures (l’assemblage tenu par des contours qu’est le visage d’un homme).
L’obscur y croît, plus visible à mesure.
Dire qu’il s’agit du travail de la mort est une banalité.
Roller la ravive : il montre le devenir matière de tout corps rattrapé par le temps.
C’est cette imminence de l'indifférenciation qui diffuse dans la mesure de l’image ; et qui, quand je la regarde, donne cette sensation de texture terriblement perméable au démesuré.
*
04/02 [ne me touche pas]
Je n’oublie pas que ces photos, quelque valeur « documentaire » qu’elles aient, sont des œuvres d’art.
Comme des tableaux, à force de suggérer des matières (ici : des textures de peaux), elles appellent au toucher.
Mais, plus encore que des peintures, elles disent : noli me tangere.
Ce n’est pas que le toucher soit interdit (sacré, tabou) : il serait simplement inepte, ridicule. La surface de la photo se soustrait au sensoriel et se réduit à un glacis ironique, abstrait, purement symbolique : zéro effet tactile.
Comme j’aimerais toucher, cependant (court-circuiter l’écart symbolique) ! Et comme au bout du compte me touche (me fascine, m’effraie) le fait que rien ne se peut en vérité toucher !
Quelle émotion comporte ce geste incrédule et maladroit qu’on fait malgré tout en effleurant la surface de l’image pour vérifier qu’il n’y a rien à toucher !
Comme ça nous en dit long sur les défis du symbolique et sur les ambiguïtés du pouvoir d’impact sensoriel des œuvres d’art !
*
05/02 [adieu]
Le vieil âge venant, nul ne peut faire qu’il ne voie son visage s’enfoncer peu à peu dans la tapisserie du monde.
C’est ainsi qu’à la « nature » on retourne, en effet.
De son vivant, paraît-il, l’homme « habite en poète » : c’est pour autant qu’à sa nature de chair, stricto sensu humiliée, il ne cède pas — énervé d’on ne sait quel « instinct de ciel ».
N’y cédant pas, n’ayant en vérité pas le choix d’y céder, il peut, pour la nommer et la figurer, s’en distinguer.
Puis il ne s’en distingue plus, son image s’y absorbe : adieu les vivants.
*
08/02 [le poids des mots]
Qui s’est voulu poète mais se découvre in fine peu apte au sublime peut en concevoir du dépit.
Pour attirer l’attention, reste l’effet sale gosse : narcissisme hâbleur et grenouillages façon « pousse-toi de là que je m’y mette », avec coups de pieds d’âne aux supposés amis.
Une fois savourée la volupté des trahisons on fait volontiers comme si de rien n’avait été : « j’ai dit cela ? vraiment ? l’ai écrit ? — soit, mais c’était pour rire : n’en parlons plus… »
Rien n’avait donc d'importance.
Et hop ! : tout est pardonné.
Pour ce genre de gens, les mots, en somme, n’ont aucun poids.
Voilà pourquoi qui agit ainsi ne pouvait être un écrivain (un qui prend les mots au sérieux).
*
15/02 [commencement].
Selon J.-L. Caizergues, j’aurais dû couper les cinquante premières pages de Demain je meurs[1] pour entrer directement dans la narration (l’action des communistes de Saint-Brieuc au temps de la guerre d’Indochine).
Cette remarque concerne la possible réception du livre. Elle suppose une stratégie : comment appâter des lecteurs et ne pas les perdre en route ?
Je n’en avais cure : je ne faisais, écrivant, qu’observer l’apparition progressive de ce qu’au début je ne savais pas être mon sujet (le passage de mon père dans l’époque, la synthèse fantasmatique qu’écrire le livre peu à peu formait de cette époque et de cette vie).
Le début du livre sort d’un rêve nocturne[2] : l’inscription de la figure paternelle parmi les présidents américains sculptés au Mont Rushmore.
Le texte reconstruit cette vision. Il prend du temps pour le faire. Trop, sûrement.
Mais non sans signification : l’écriture (toute écriture ?) commence avant le réveil, avant le lever du rideau. On est dans la fosse d’orchestre. Les instruments s’accordent, lentement, dans un temps non encore sorti de la nuit. Un phrasé s’harmonise. Puis une phrase monte vers le jour, s’enroule peu facilement (d’abord empêtrée et obscure, forcément), trouve à mesure sa stylisation, son aisance. Une forme non a priori calculée se forme avant même qu’une histoire (intrigue, figures, personnages) ne coagule, distingue des protagonistes et sertisse des scènes : avant que la pièce ne commence.
Mallarmé parle en ces termes du prologue « extra-scénique » de Macbeth[3] : on voit une action fantasmagorique (la scène des sorcières, leurs manigances nocturnes) avant même que n’ait débuté le drame (« le rideau, dit Mallarmé, s’est levé, une minute trop tôt »).
Bref, tel qu’il est, le livre est bien ce qu’à mesure que je l'écrivais je voulais qu’il fût : à la fois capable de « raconter » quelque chose (la vie de mon père dans un moment historique et politique précisément décrit), à la fois témoin de la façon dont il fut effectivement écrit et susceptible de dire, par l’exemple, quelque chose de ce toujours très mystérieux travail appelé écriture.
*
16/02 [Mallarmé, encore]
Mallarmé ne se contente jamais de moins que d’une volonté de savoir ce qu’il en est de la poésie. Il aide toujours à en admettre l’énigme fondamentale et à en connaître mieux les façons d’opérer.
Exemple : « Don du poème ».
Un résumé du contenu peut réduire le texte à une scène (c’est le génitif subjectif du titre : quelqu’un fait à quelqu’un le don d’un poème) : le poète a travaillé toute la nuit ; au matin il observe la piètre « relique » enfantée à grand peine ; puis l’apporte à une femme qui allaite une petite fille (comme enfantement, ce fut du plus sérieux…) : retour à la vie domestique.
Reconnaître qu’il ne s’agit pas (que) d’un prologue romanesque pose la question de ce qui est propre à la poésie dans le texte qui s’est produit sous nos yeux.
Cette fois le génitif est objectif : le poème fait à quelqu’un un don. Ce don, c’est une question sur ce qui fait la poéticité d’un poème ; et une réponse : le texte lui-même comme incarnation de cette poéticité.
La différence tient à un transfert d’initiative : ce n’est pas le vouloir dire qui règne (le tracé d’une ligne narrative, efficace d’être monosémique) ; mais l’initiative laissée à la langue : aventures sémantiques (connotations instables, abîme étymologique[4]), sonores (la partition)[5] et prosodiques. Soit : polysémie maintenue et matérialité dynamique.
Là est le sens (l’expérience effectivement « représentée » par le poème) ; et la réussite : une forme se forme, dont la densité interne dépend de l’effort fait non pas pour dessiner son objet (son pré-texte) mais bien plutôt pour le dissoudre et pour tirer de cette dissolution (de cet échec) une capacité à sensoriellement émouvoir (une réussite)
*
18/02 [incroyable incroyant]
L’incroyable densité des poèmes de Mallarmé impressionne. Quelque chose, pourtant, me retient à leur seuil : décorum d’époque (lexique fin de siècle), dévotion à l’esthétisme, effet de pose plastique (la statue du littéraire).
Mais la pensée : quelle offrande faite, sans réticence ni pseudo connivence (sans pitié, donc), à qui essaie de comprendre de quoi, quand on parle de poésie, il s’agit !
Personne qui ait cru moins que lui à la possibilité d’un contact direct avec le monde, d’un lien im-médiat avec les choses, les pensées, les corps ; personne qui ait été plus attentif au fait que la langue n’est jamais transparente aux objets qu’elle cherche à faire voir.
Il savait cependant qu’aucun corps social ne tient si ne le lie une religion[6]. Ça n’allait pas sans une certaine naïveté : le lien religieux (mais sans « Dieu »), il pensait que l’avenir des sociétés le (re)trouverait dans la musique ; ou dans la poésie ; ou dans les deux. Ce pourquoi il crut un moment au culte wagnérien. Pas longtemps.
Coda : qu’est-ce qui nous lie aujourd’hui sinon un fort sentiment d’impuissance face à la profanation du liant universellement humain par des pragmas individualistes (cynisme du marché, illibéralisme triomphant) et des particularismes relativistes (intégrisme bigot, communautarisme tribal, repli dans des niches genrées) ?
Ça complique la question du souci poétique originé à Mallarmé : comment maintenir dans cette érosion générale du lien une posture poétique négative (déliant les représentations verbales qui font lien) ? Mais aussi bien : qu’est-ce qui pourrait justifier qu’on y renonce — pour autant que le lien au jour le jour incarné en représentations idéologiquement formées ne cesse évidemment jamais d’être une puissance d’aliénation, l’arme même de la domination ?
[1] Ou c’est l’éditeur, dit J.-L. C., qui aurait dû me faire supprimer ce début (il risquait de dissuader de poursuivre la lecture). Mais Paul Otchakovsky-Laurens n’a jamais demandé aucune modification dans les livres de moi qu’il a publiés. « C’est l’écrivain qui a raison », me disait-il toujours.
[2] Il avait déjà donné le poème « Glas », dans Ecrit au Couteau (P.O.L, 1993).
[3] « La fausse entrée des sorcières dans Macbeth » (Crayonné au théâtre, 1897).
[4] Dans Chêne et chien, Queneau transcrit ainsi le premier vers : « Je t’apporte l’enfant d’une nuit bitumée ». Gag ? Pas que : l’Idumée, c’est en Judée (d’où : palmes, aromates…) ; les peintres d’autrefois, pour mettre de l’ombre à leurs tableaux, usaient du bitume de Judée. Après cela (Judée, ange, bitume) on voit, comme on dit, le tableau. Et ceci : l’Idumée est le pays des édomites, sauvages ennemis d’Israël, reproduits sans femmes (auto-enfantés) ; et celui d’Hérodiade, le monstrueux poème à jamais avorté.
[5] Un exemple : rejeté du v. 5 au 6, le poétiquement connoté « palme » est une anagramme du plus trivial « lampe ». Une base de labiales et liquides (ParLe / BrûLé / aroMates / Par Les / gLacés / héLas / Mornes / déPLuMés / angéLique…) forme le groupe PLM, qui engendre LaMPe et PaLMes : c’est un chiffrage concerté de lettres (une musique verbale) qui produit le sens.
[6] Voir les « Offices » de Variations sur un sujet.