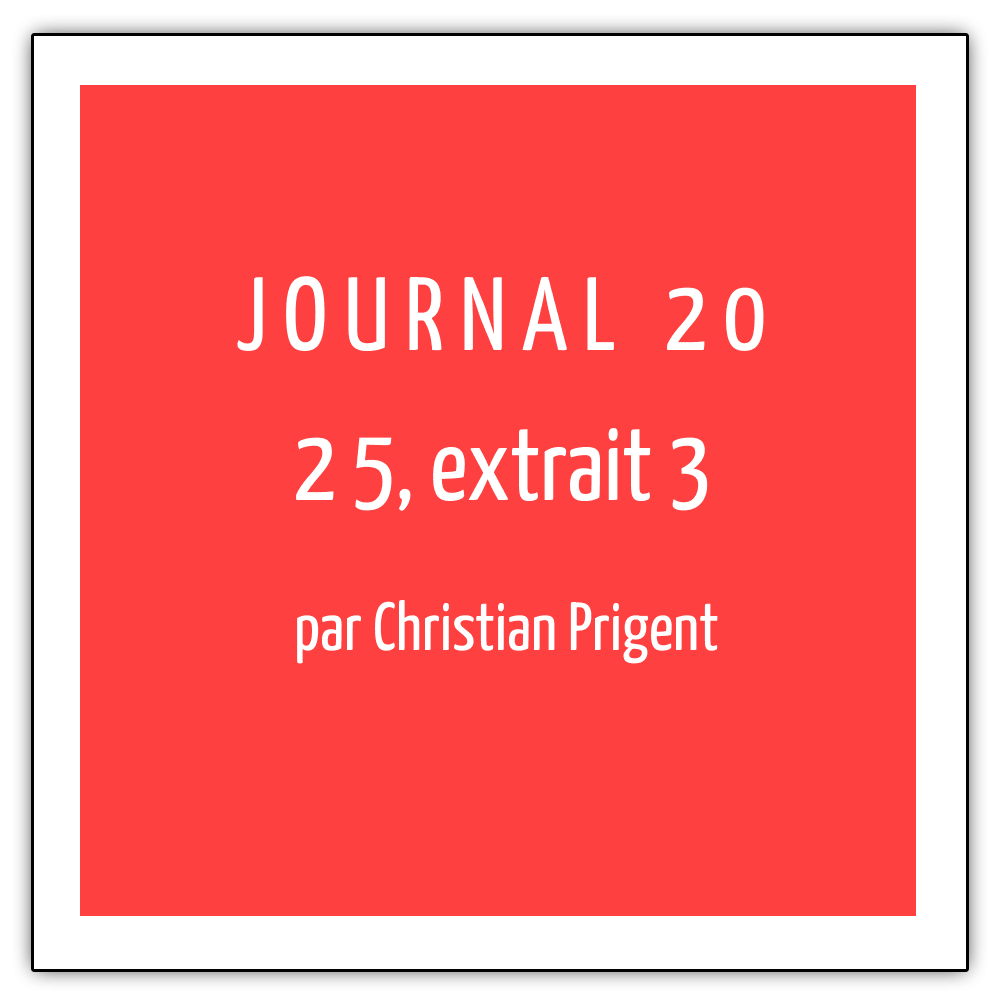JOURNAL 2025, extrait 3 par Christian Prigent
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
01/03 [le mal]
Une revue m’interroge sur l’obsession du « mal » dans mes livres.
Cette obsession[1] n’est pas la mienne — c’est celle de l’art[2], de la littérature.
Mal, malheur, ça obsède la vie : normal qu’on en fasse des livres.
Plus crucial : écrire, c’est représenter.
Quoi de plus intéressant à représenter que ce qui défie la représentation ?
Ainsi le mal — qui peut ne provoquer qu'un cri.
Grand sujet, par exemple : la guerre, insensée.
Seuls les dieux (non les hommes) dotent de sens les combats de l’Iliade.
Balzac renonce à écrire La Bataille (Wagram) : « livre impossible ».
Fabrice, à Waterloo, ne comprend rien.
Bardamu : « la guerre, c’était ce qu’on ne comprenait pas ».
Des Aurès, Guyotat ramène un oratorio sauvage, quasi idiolectal.
Même défi : les jouissances violentes, le destin meurtrier des pulsions — Sade, Genet…
Ou les frayeurs devant le ciel trop plein ou trop vide de divin : psaumes, lamentations, litanies, glossolalies…
Ou tel aperçu sur l’impasse où le parlant gémit : « je ne peux pas ne pas dire le monde mais aucune des paroles mises à ma disposition ne fait effet satisfaisant de monde ».
Pour l’art littéraire le mal est moins un thème que l’innommable même — aux deux sens : l’ignoble (la pire barbarie, l’impensable réalisé) ; et ce-qu’on-ne-peut-nommer : l’expérience du réel comme excès aux langages[3].
Cette expérience est celle de ceux dont le but est de représenter quand même ce qui semble a priori ne pas pouvoir l’être : quelques « poètes ».
C’est même cette passion d’apparence peu justifiable qui explique qu’il y a de la poésie — et pas seulement les autres façons d’utiliser la langue pour nous raconter ou nous expliquer la vie.
*
03/03 [la poésie]
Les livres ne manquent pas qui disent que le monde va mal : nature mutilée, patriarcat dominateur, marché omnipotent, illibéralismes et néo-colonialismes, poussées terroristes et cynismes génocidaires.
Ne font pas non plus défaut les récits où l’on se plaint d’avoir été maltraité, exploité, discriminé, racisé, harcelé, incestué, violé.
On a raison d’écrire ces livres : les souffrances qu’ils disent sont réelles, les causes qu’ils défendent sont justes.
Même la poésie peut faire ça.
Pour autant, ce n’est pas en tant qu’elle le fait qu’elle est utilement la poésie.
Ce qu’elle seule peut faire et qui donne sens à ce qui porte ce nom, c’est affronter la question du mal en tant qu’expérience ontologique de l’innommable : défi à l’expression elle-même. En faisant consister sa réponse à ce défi dans des formes excentriques. Et pas qu’en des récits listant en langue discursive des sujets d’indignation.
*
04/03 [la douleur]
Rien ne peut faire qu’en parlant on n’exprime pas des chagrins.
Et l’actualité pousse à décrire des horreurs (avec l’idée que le faire est une façon de les combattre).
Mais si c’est de poésie qu’on parle, ces évidences n’épuisent aucune question.
Écrire n’a pas pour source la seule expérience personnelle des peines.
On souffre aussi du mal de l’espèce parlante : qu’elle soit la seule qui sache la mort et fasse l’épreuve douloureuse que ce savoir la sépare de l’inconscience naturelle.
Il n’est pas d’art qui ne soit à la fois hanté et stimulé par cette épreuve et ne cherche pas à traiter la question ainsi posée à la socialité humaine.
Mallarmé : « en poésie, il s’agit avant tout de faire de la musique avec sa douleur, laquelle, directement, n’importe pas[4]».
Soit : la douleur fait naître le poème ; mais l’objectif du poème n’est pas de l’exprimer directement (avec le moins possible d’intermédiaire symbolique). Le but du poète est de se donner les moyens d’assister personnellement, en soi-même, au drame de l’espèce souffrante, d’accepter d’être par ce drame essentiellement fasciné — non pour y céder mais pour lui répliquer, dans la langue, par des actes de formalisation poétique : pour le convertir en une musique formelle dépersonnalisée, objectivée.
Autre remarque : la capacité de faire le mal, la jouissance qu’il y a à le faire, la fascination que les conduites inhumaines peuvent exercer, c’est inscrit au fond de l’humain[5]. Nul être humain qui ne soit impliqué, au moins par les manigances de son inconscient, dans des tentations abjectes, aucun qui ne soit, les circonstances y invitant, capable de cruauté.
Conséquence : la sauvagerie déchaînée, la vilénie perverse, toutes les formes du racisme, ça n’est pas le seul fait d’autrui. C’est en nous, en chacun de nous. Que ça nous occupe nous met chaque jour au défi de trouver les moyens d’éviter que ça ne passe, dans nos vies, à l’acte. Il nous faut travailler sur nous-mêmes pour que ces cris de revendication barbare rentrent au fond de nos propres gorges. Les sociétés humaines ont inventé pour nous y aider ou nous y contraindre des directives morales et des lois punitives. Que partout et toujours il ait fallu ces dispositifs dit à quel point la tentation du mal est au fond même de la nature des hommes.
*
05/03 [le bond]
On voit aujourd’hui devenir hégémoniques (à force de se parer des fausses évidences de l’inéluctable) des programmes politiques agressivement communautaristes.
Il leur faut d’abord récuser les valeurs éthiques et culturelles « universelles » et intimer à chacun de rester campé sur son pré d’enracinement spécial, dans son clan, dans sa tribu, dans son culte, dans son folklore, dans sa couleur, dans son sexe, dans son genre.
On réactive ensuite les réflexes prophylactiques. La volonté d’homogénéité a besoin d’incarner l’hétérogène dans des ennemis et des exclus : il faut des boucs émissaires. On extro-jecte donc les figures du Mal : le Mal est dans l’autre, c’est l’autre.
Alors la géo-politique invente des « axes du Mal » ; plusieurs épicent leur vie domestique avec des fantasmes de « grands remplacements » ; on s’obsède névrotiquement de frontières, cordons sanitaires, digues contre les submersions pouilleuses, murs à barbelés, douanes ; et les paranoïas d’homogénéité finissent inéluctablement en décisions sanglantes : nettoyages ethniques, épurations, déplacements, déportations.
Ces façons d’assigner le mal à l’autre (à l’autre que le « nous » lui-même assigné à une identité communautaire hygiéniquement distinguée de l’ensemble contaminant dit « humanité »), l’expérience ontologique, historique, culturelle et linguistique de l’art la conteste et la dénonce : elle sait que ce n’est que folie, délire paradoxalement hors-sol, holocaustes toujours imminents.
S’inquiéter de poésie, avoir la curiosité du sens historique revêtu par « l’action restreinte » qui porte ce nom, tenir compte de ce qu’elle nous apprend de l’inhumanité propre à l’humanité, essayer de composer des textes qui ne soient pas ignorants de ce sens, de cette histoire et de son enseignement, c’est ne pas vouloir céder à la folie du monde et essayer de faire hors du rang des millions de meurtriers que cette folie engendre le fameux « bond », le bond furtif mais essentiel, dont parlait Kafka.
*
07/03 [l’imagination]
L'expression d’affects dans une forme stéréotypée (la routine du vers libre), ornementée d’analogies imagées, c’est toujours l’ordinaire de la poésie réflexe.
Critiquer cette façon de faire poète, ce n’est pas qu’en récuser les formes. C’est refuser son idéalisme : idéal de transfusion im-médiate des sensibilités ; mystique d’adhésion aux choses, à la « nature », au « monde » ; rêve d’une réconciliation sans reste (sans différence) entre réel et symbolique.
Cet idéalisme pense le poème en terme d’expression sensible et d’imagerie et ne voit dans la construction verbale qu’un outillage commode, possiblement enjolivé, capable de faire marque personnelle, label, « style ».
Il oublie qu’un écrit, de quelque « imagination » qu’il fasse preuve, n’a lieu (n’apparaît comme lieu lisible : « œuvre ») que pour autant qu’une langue travaillée en invente et en formalise les images.
Si cet oubli domine, ce qui commande la fiction, c’est la norme de langue : la trame de la parole commune, le tissu des contenus partageables et des figures familières (les « clichés »).
Et peu importe que l’auteur se veuille témoin objectif (de son propre vécu ou de l’événement socio-politique) ou rêveur subjectif (surexcité par l’imaginaire) : le résultat littéraire est en l’occurrence le même.[6]
[1] Elle concentre une mythologie (le Mal originel), une anthropologie (le « malaise dans la civilisation »), une morale (bien / mal), un souci politique (la violence dans l’histoire), une passion subjective (la douleur éprouvée par chacun) et une question logique (comment nommer le mal ?).
[2] La peinture (martyres, massacres) ; le cinéma (monstres, tueurs, guerres).
[3] L’Innommable : titre de Beckett. C’est ce que cet auteur a en vue et qu’il fait : dire mal, dire le mal, « dire désormais pour que soit mal dit », « rater mieux, rater plus mal encore ».
[4] 1894. Je souligne.
[5] Beaucoup de sirops idéologiques (les uns produits par une religiosité bigote, les autres confectionnés à base de recettes plutôt naïvement hédonistes) s’efforcent de faire passer cette pilule de vérité empoisonnante. C’est pour que se poursuive le rêve d’une socialité heureuse, soignée par la science positive et l’art bienveillant, réconciliée dans la jouissance consommatrice, indemne de violence et d’angoisse (Mikhaïl Gorbatchev disait cela, il n’y a pas si longtemps) — bref : une humanité protégée de tout, à l’abri du mal, voire même ignorante de la mort.
[6] Rabâchons : nul n’écrit au contact im-médiat d’un « réel » conçu comme une réserve de décors à décrire ou d’épisodes à raconter ; on écrit inclus dans une réalité faite de « l’ensemble des médiations qui constituent la conscience concrète » (Hegel) ; écrire consiste à tenter de retrouver un accès vers le « sentiment immédiat » (Hegel, bis) : à nommer un réel pourtant en tant que tel innommable. Rien de cette opération ne se déroule dans un face à face entre « réalité » et « imagination » : tout a lieu au cœur du drame spécifiquement humain de la médiatisation (la langue, la parole,) et ne sort jamais de la scène où ce drame, pour l’espèce, se joue.