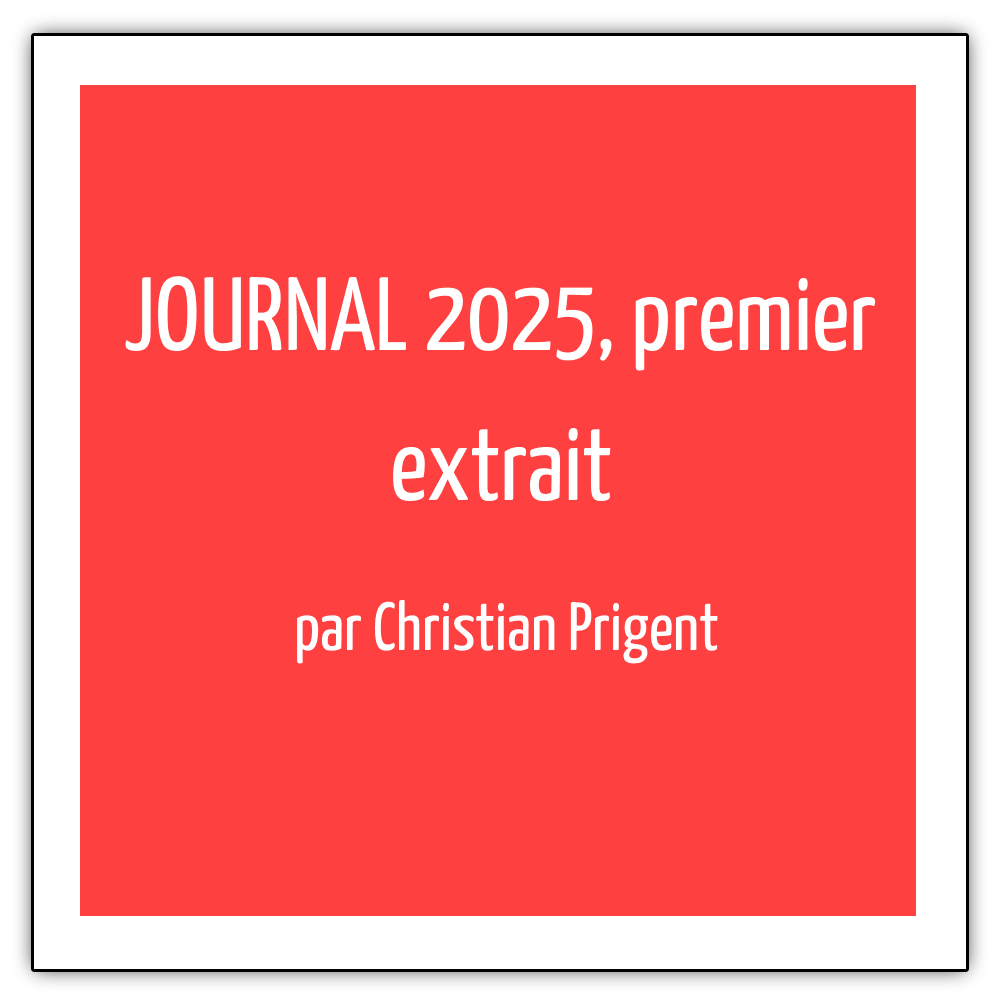JOURNAL 2025, premier extrait par Christian Prigent
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
02/01 [coup de poing]
Olivier Roller, m’envoyant une photo qu’il a prise de moi au début du mois dernier, m’écrit : « j’espère que tu n’auras pas envie de me mettre ton poing dans la gueule ».
Mais non : c’est à soi-même qu’on a envie de mettre le poing sur les i de la figure quand on regarde de telles photos : elles montrent à quel point on est traversé par la violence des choses de la vie.
Ça s’appelle vérité — celle de l’image (quand elle ne fait pas mine de « faire » vrai, mais l’est).
*
04/01 [grimoire]
Céline disait qu’à partir d’un certain âge on est « responsable de sa gueule ». En effet. On en a bavé, on a joui ; on a eu honte, envie, besoin ; on a rusé, menti, masqué, tenté des poses, tonitrué des opinions, gesticulé des émois. Ce vécu nous a tatoués.. Notre visage est son grimoire. Tout s’y est écrit. Ça y parle par déliés de creux et pleins de bosses, empâtements, plissements, effondrements, grumeaux.
Ce qui fait « vrai » dans une photo, c’est ce modelé maladif, signé de traits torturés, de traces de gnons, de gravures aigres.
*
05/01 [figure, profondeur]
L’image de soi qui pousse au pire l’effet de vérité est forcément la plus récente : la plus marquée par le vieillissement.
Ce qui y fascine : qu’à mesure la figure se défasse. Qu’on ne voie plus qu’une texture : la peau, accidentée (lichens, pelades, spots de gras).
Rien n’a plus lieu qu’elle, qui expose le travail du temps. Elle occupe tout (l’espace, la surface, la méditation, la signification).
Et la profondeur (ce dont elle pourrait être à la fois le voile, l’enveloppe, la figure et le mode d’expression) toujours plus nous échappe[1].
*
06/01 [l’insulte]
Pour autant, ça ne concerne pas que des visages de vieillards.
Roller aime l’hyperréalisme de l’image. Il n’épargne rien des accidents de l’épiderme. Du coup, de quelque âge de la vie qu’ils traitent, ses portraits font apparaître l’inacceptable (on se fait « horreur », on ne se « retrouve » plus).
C’est pourtant bien moi que je suis forcé de reconnaître sur ces images. Mais moi comme remonté d’en deçà de moi ou projeté au delà de moi ; comprenant ce qui n’est pas, dans l’instant, moi : inscrivant le temps en moi, faisant de moi une œuvre de l’action et de la distraction (de l’indifférence) du temps.
Bref : cette représentation insultante de moi, c’est plus que jamais moi. Moi creusé d’un moins ou gonflé d’un plus que je savais si peu être un aspect de moi que ce moi n’y reconnaît rien de ce qu’il se représentait grosso modo de lui.
*
09/01 [singerie]
Réaction courante devant un portrait photographique : « c’est tout à fait lui ! ».
Si ce n’était pas « lui », qui serait-ce ?
Que serait ce « lui » qui ne serait pas « tout-à-fait » sur la photo ?
Qu’est-ce qu’une photo aurait saisi de « lui », qui étant pourtant lui, ne serait pas ajusté à ce que l’on savait a priori de lui ?
Une photo qui n’aurait pas provoqué en moi cette sensation qui m’a fait dire « c’est bien lui », bien qu’étant d’évidence aussi une image de « lui », en quoi ne serait-elle pas tout-à-fait « lui » ?
Bref : à quoi de « lui » s’est ajustée la photo qui me fait dire « c’est bien lui » (dont je trouve qu’elle donne de lui une image juste).
La réponse est : c’est tout-à-fait lui, maintenant ; mais pas ce qu’il fut avant, qu’il sera après.
L’image ne retient du temps qu’un présent. Or, quel vivant n’est que son présent ?
La mémoire (le temps) est ce qui manque à la photo. Ce-qui-est-lui n’est pas co-extensif au bien-lui que dans l’instantané la photo retient, fixe.
Un photo (un portrait), de ce fait, n’est jamais qu’une parodie de face humaine, une singerie du visage.
*
10/01 [peinture, photo]
Bien des artistes d’aujourd’hui peignent des portraits d’après des photos : ils ne portraiturent pas des gens mais déjà des images de gens. Comme les primitifs (Sienne, etc.) ne représentaient pas des apôtres, des anges, des saints mais l’idée qu’ils en avaient (qu’avait formée en eux la connaissance du récit biblique).
Mais si l’image d’une personne est, comme chez Roller, une photographie aux contours fuyants, dépecée de ses vernis, mangée de moisissures et prolixe en suggestion de multiples textures, alors la représentation picturale ne gagne que peu de confort dans le fait de choisir, plutôt que le toujours décontenancé et décontenançant « réel », le calme aplati et serti de l’image photographique : le sens en fuit au moins aussi vite, aussi violemment, ça ne simplifie guère l’effort de figuration des vies, le défi (la provocation de l’impossible) ne cesse pas d’agir.
*
13/01 [hasard, as art]
Relecture de Mallarmé pour le deuxième séminaire briochin[2]
Ce qu’à mon sens dit le Coup de dé : le « hasard » (la totalité physique indifférente à la logique, étrangère à nos langues) n’est jamais effacé par le coup de dé d’un agencement des mots.
Le « livre » est une représentation agencée, ouvrée en tout point : lexique, syntaxe, disposition typographique, espaces vides, échos sonores. Ce dispositif démonstratif enregistre un coup du dé logique. Coup de langue pensée comme matière d’art : as art — poésie : art de la langue.
En roulant sur les feuilles (c’est d’un voyage qu’il s’agit : écume, clapotis, horizon, tempête, naufrage), le dé compose un objet de langue (pas qu’une représentation de ceci ou de cela qui serait du « monde »).
Toute œuvre humaine (toute œuvre de langage, toute manifestation du parlant) aboutit là : en ce lieu seul (qui seul a lieu). Ce lieu (le « livre ») ne touche en rien le « hasard », ne l’abolit jamais. Le « hasard » : le « réel » in-signifiant, in-fini, im-mense, dif-férent (indifférent à nos logiques, en différant constamment la coagulation en messages, en discours).
*
16/01 [monde]
J’y reviens sans cesse (c’est que c’est la base, l’énigme qu’affronte qui veut faire poète) : une évidence dit qu’un poème devrait ressembler au monde ; là serait la condition de sa lisibilité et de son utilité.
Cela suppose que l’on sache ce que l’on dit quand on prononce le mot « monde ».
Le « monde » c’est
— les gens (emmerder le monde = emmerder les gens)
— la réalité (l’ensemble articulé des représentations dont nous disposons pour les choses, les êtres, la vie)
— le réel (la totalité physique) défini seulement en tant qu’in-définissable (infini) : excessif à toute représentation.
Pas étonnant qu’on s’éprouve y être peu, au monde, être le moins possible à lui.
Quant à ressembler (= représenter avec le plus d’exactitude possible, être ajusté au réel que l’on s’escrime à figurer)… L’histoire des formes « poétiques » inciterait plutôt à soutenir que ces formes ont pour souci de dissembler au monde (aux façons courantes qu’on a d’époque en époque de le représenter).
*
17/01 [don du poème]
Le poème constitue une image de monde — mais en tant que le monde en cette image s’efface : que l’image rate le monde et, le ratant, ne représente en fait que l’absence du monde dans le geste fait pour le représenter.
Le poème qui représente l’échec du poème doit d’une certaine façon être un poème en échec (c’est en gros ce qu’Artaud dit à Rivière).
La question est celle de cette « certaine façon », justement : ce qui fait éprouver l’échec sans y identifier entièrement le texte.
Ce qui est mis en échec : la stabilité des significations ; la pseudo naturalité (la transparence de la langue à son objet) ; la réduction de la langue à une messagerie (vs chant, incantation).
*
20/01 [Orphée]
Mallarmé dit que le but de sa poésie est une « explication orphique de la terre ».
La terre : l’étant, les « aspects de l’existence », la « nature » (natura rerum), le « réel », etc.
On n’en sort pas.
Ni du fait d’expérience qu’elle (la terre, donc) ne peut se décrire, se figurer, etc, en langue rationnelle, discursive.
Ni du fait qu’elle ne peut que se « chanter » : être représentée par des rythmes homologues à sa matière en mouvement : par le « dépliement » (l’ex-plication) poétique (orphique).
*
21/01 [dépliement]
Mallarmé évoque le « primordial instinct placé au secret de nos replis » (1887). Je mets cette dernière formule en rapport avec ce qu’il dit du projet de la poésie : « explication orphique de la terre ».
Ex-plication = dépli du repli ; le poème cherche à découvrir une nudité du monde, quelque chose de sa vérité ; mais pas dans le discours (qu’il soit scientifique, philosophique, théologique, mystique…) — dans la duplication rythmique, l’incantation, le chant : Orphée (il s’agit de rejoindre les « motifs rythmiques de l’être », le « nœud rythmique » de chaque « âme »).
Sinon, la formule « explication orphique » ne peut s’entendre. C’est un oxymore, inévitablement.
Et je ne jurerais pas que Mallarmé ne l’ait pas proposé comme tel : « explication » (rationalité, discours — « le livre explicatif et familier ») vs « orphique » (poétique, chant).
*
25/01 [aucun mot ne sait se tenir]
Dès que dans mon poème je glisse un mot (je voulais dire quelque chose : de ce mot j’avais besoin), ce mot m’offre toutes les chances (d’effet et de sens) dont il est chargé (et qui excèdent de loin le rôle qu’en le choisissant je lui avais assigné).
Laisser jouer ces chances (au moins certaines d’entre elles), id est laisser l’initiative aux mots (par rapport au vouloir-dire), c’est ce qui est particulier à la poésie, au hasard effrayant et bienheureux du langage poétique.
*
26/01 [poème comme réponse]
Quelque chose force à écrire à quoi il n’est pas question de se dérober (sauf angoisse, fébrilité malade). Ce qu’est ce quelque chose fait question. A cette question il n’est aucune réponse qui puisse se formuler en savoir et raison. La seule réponse est le poème lui-même, qui s’est formé selon l’impulsion, pour en relever le défi. Au moins cette relique apprend-elle (puisque sa forme s’analyse — se dissout possiblement), sinon ce que c’est que la poésie, du moins en quoi elle est autre chose qu’un dispositif de savoir, l’exercice d’une rationalité, une tentative d’expliquer le monde par ces voies-là.